Avertissement
Vous avez entre les mains le cours par correspondance en Philosophie sur « La question et la réponse ». Il est conçu comme une introduction à la philosophie par le biais d’un exercice des formes élémentaires du questionnement, et d’une histoire de quelques-unes des grandes figures de l’interrogation philosophique, de Platon à Wittgenstein.
Vous ne savez cependant pas très bien comment vous y prendre, vos souvenirs de la philosophie ne sont pas toujours très encourageants, et cette masse de lectures apparemment ardues tend à vous tomber des mains ! Rassurez-vous… D’abord ce parcours a été conçu pour être divisé en autant de parties qu’il le faut pour être « digéré » lentement. Ensuite il ne s’agit pas de les faire tous, d’étudier les cinquante textes donnés en appui, ni de rédiger tous les exercices proposés. Ce sont là plutôt des matériaux pour des libres-parcours que vous pouvez choisir selon vos inclinations propres pour les thèmes ou auteurs rencontrés.
Ce cours a une brève histoire, puisqu’il est la reprise d’un polycopié de 1986 puis de 1994 à l’intention des étudiants en première année. En m’arrêtant à cette version–là du cours, j’ai renoncé à y intégrer toutes les remarques bourgeonnées en marge depuis, et que l’on trouve bien plus développées dans mon livre sur L’éthique interrogative (Paris: PUF, 2000), qui est le complément de ce manuel, même s’il comporte aussi une visée d’introduction à l’éthique.
En effet, en rapprochant la pragmatique du questionnement ordinaire (par laquelle les contemporains mesurent avec passion leurs accords et leurs désaccords), et l’herméneutique interrogative (par laquelle les générations successives entrent dans la conversation humaine et la réinterprètent tour à tour), j’ai voulu y proposer une éthique de notre condition langagière. Cette éthique d’interrogativité, contrepoint nécessaire à toutes les formes de la responsabilité, jette les bases d’une philosophie du droit et de la civilité. Il s’agit de penser ensemble la ressemblance et la différence d’humains d’autant plus heureux de se distinguer qu’ils s’effacent les uns devant les autres. Et l’interrogation n’ouvre la question de savoir « qui » nous sommes qu’en nous retournant vers un monde commun.
Dans le polycopié, il s’agit surtout de donner aux étudiants un équipement commun dans le maniement des questions rencontrées, et une sorte d’ « entrée » méthodologique: pour les disciplines de la pratique et de l’éthique en les axant sur le partage de la parole et la pragmatique, pour les disciplines bibliques et historiques en les axant sur la lecture et l’herméneutique, pour les disciplines philosophiques et de théologie générale (dogmatique) en les axant sur la dissertation ou la méditation écrite. Cette entrée méthodologique est double : « On ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question », disait Gadamer. Meyer ajoute: « la question à laquelle la réponse renvoie diffère de celle qu’elle résout ».
Ces deux citations énoncent à leur manière deux principes de méthode, des gestes simples pour aborder un problème (1ers éléments), une intelligence de la conversation ordinaire (2nds éléments), mais aussi des règles de lecture pour des textes dont on ne sait plus à quelles questions ils répondaient (3èmes éléments) et une oscillation profonde dans l’histoire des idées entre un principe plus critique et un principe plus dialectique (4èmes éléments). Finalement elles désignent ces lisières où nous ne savons plus si nous interrogeons ou si nous répondons, et sur lesquelles Kierkegaard avait osé un rapprochement entre Socrate et Jésus (5èmes éléments).
Entre la pragmatique (2nds éléments) et l’herméneutique (3èmes éléments) l’interrogation est aujourd’hui au carrefour de traditions hétérogènes (anglo-saxonnes pour la première et plus continentales pour la seconde). Il ne s’agira pas de proposer un impossible synthèse entre ces traditions mais de faire valoir leur complémentarité. Et d’élargir les usages de ce que nous croyons être la philosophie —on peut se reporter au petit plaidoyer que je propose à la fin de la leçon 9 pour l’indulgence aux examens de philosophie !
La philosophie est-elle ce que l’on fait au café de la République[1], en cherchant à parler de la même chose, sachant que ce n’est pas forcément le cas, et interdisant à l’un de nous de dire que sa question ou sa problématique est la seule ? Est-elle ce que l’on fait dans son atelier, avec un outillage et un soin d’artisan très spécialisé, en s’attachant sans polémique à contribuer modestement aux communes connaissances ? Est-elle ce que l’on fait en conversant avec un enfant, lorsqu’une petite question ébranle le monde et le remet en jeu ? C’est un peu tout cela, mais de toute façon c’est d’abord un exercice élémentaire de l’interrogativité.
Exercices et textes :
Accompagné de « Travaux Pratiques » sur des textes, ce cours peut être lu et pratiqué comme n’importe quel « Manuel » (j’ai mis en italique ce qui en relevait directement, mais tout en relève, car ne compte ici que l’exercice), au sens exact où il est proposé aux étudiants de faire l’équivalent manuel du travail intellectuel, par une série de petites opérations (souligner ce qu’on lit, le recopier ailleurs en le distribuant autrement, couper aux ciseaux, monter, coller les idées comme des figures de couleur, essayer plusieurs plans, plusieurs configurations avant d’arrêter la ligne du Commentaire ou de la Dissertation, etc).
Les exercices sont regroupés à la fin de chaque leçon, accompagnés généralement de textes choisis soit pour leur rapport au développement de la réflexion sur la question et la réponse, soit pour leur importance dans l’histoire de la philosophie. Cela fait une cinquantaine en tout, sans compter la trentaine de textes que l’on trouve cités à l’intérieur du cours[2]. Ces textes ayant été le plus souvent scannés pour ce polycopié, ils peuvent comporter des fautes qui n’ont pas encore été repérées : je vous serais très reconnaissant de bien vouloir les signaler
Auteurs des textes donnés en TD : 1 : Merleau-Ponty . 2 : R. Rorty. 3 et 4 : Platon. 5 : M. Meyer. 6 : Platon. 7 : Aristote. 8 : Descartes. 9 : Kant. 10 : S. Kierkegaard. 11 : Merleau–Ponty. 12 : E. Jabès. 13 : J. L. Austin. 14 : GW Leibniz. 15 : N. Frye. 16 : Wittgenstein. 17 : J.P Vernant. 18 : Augustin. 19 : Schopenhauer. 20 : R.G. Collingwood. 21 : HG Gadamer. 22 : Heidegger. 23: P. Ricoeur. 24 : Gadamer. 25 : W. Benjamin. 26 : RW Emerson. 27 : Nietzsche. 28 : H. Arendt. 29 et 30 : P. Ricoeur. 31 et 32: Kant. 33 : Wittgenstein. 34 : P Bayle. 35 : Leibniz. 36 : Kant. 37 et 38: Rousseau. 39 : Karl Marx. 40, 41 et 42 : Hegel. 43, 44 et 45 : Nietzsche. 46: P.Tillich. 47 : M. Serres. Sans parler donc des textes donnés à même les leçons, comme ceux de Kierkegaard et de Arendt dans la dernière.
En annexe j’ai placé un Index des auteurs, philosophes et autres, que vous rencontrerez le plus fréquemment au cours de vos études. On utilisera plus aisément ce manuel en le pratiquant à deux ou trois, comme une suite de promenades sur des parcours plus ou moins difficiles. Bonnes promenades.
Premiers éléments.
Enfances de l’interrogation
L’interrogation est d’abord une « méthode », une technique pour se comporter devant un discours ou une situation : en effet savoir interroger, c’est percevoir l’invisible, les questions auxquelles les faits, les paroles et les comportements répondent ; c’est comprendre que ces questions ne sont pas forcément les nôtres. Et c’est comprendre que ces réponses peuvent ouvrir de nouvelles questions, auxquelles elles ne répondent pas. L’apprentissage de l’interrogation est aussi une intelligence: l’intégration progressive des questions d’autrui et des autres points de vue à notre perception et à notre conception du monde.
Leçon 1
La simplicité des principes du questionnement
Nous allons examiner le langage de la question et de la réponse à partir de deux principes, auxquels tous les autres peuvent plus ou moins se ramener. La philosophie ici ne suppose pas des connaissances préalables: c’est un double–geste à attraper. Comme on va le voir, le « principe de question implicite » permet de distinguer le sens des réponses (« on ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question » Gadamer[3]), et le « principe de différence problématologique » permet de distinguer celui des questions (« la question à laquelle la réponse renvoie diffère de celle qu’elle résout » Meyer[4]).
1.1) Principe de question implicite
Exemple 1: Se reporter à la planche de Tintin à la page suivante (Les bijoux de la Castafiore): « bonjour, Professeur… », jusqu’à « plus un mot sur ce chapître ». Dans ce cas, le malentendu vient de ce que les mêmes énoncés (dans les images 6 à 10 de la page) répondent implicitement à des questions différentes. Les présuppositions des journalistes (le mariage Haddock–Castafiore) et celles de Tournesol (sa nouvelle rose) ne sont pas les mêmes. Le phénomène est évidemment théatralisé par la surdité du professeur, mais les journalistes, jusqu’au bout, ne se rendront pas compte qu’ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde que lui. Le malentendu est évidemment comique, mais pour le lecteur seulement, et on imagine sur le mode shakespearien le comique que doit représenter pour Dieu le monde humain (par exemple les théologiens). Antisthène, un philosophe de l’Antiquité, disait que les gens discutent de toutes façons pour rien, parce qu’en fait on ne parle jamais de la même chose; il exagérait probablement un peu.
Cf. Tintin(par Hergé), Les bijoux de la Castafiore, p.23

Exemple 2: Dans une conversation apparaît l’énoncé « il fait bien gris ». Selon le contexte d’interlocution, qui détermine ce qui est implicitement en question, cet énoncé peut vouloir dire : « il faut prendre un parapluie »; ou bien : « bonjour »; ou bien : « changeons de sujet de conversation »; ou bien « tu devrais allumer le plafonnier, on n’y voit plus rien ». Dans le contexte, le sens se comprend tout de suite, même si ce dont il est question reste implicite. Dans la mesure où le contexte est équivoque ou bien a disparu (c’est le cas avec les textes), il faut expliciter ce dont il est question pour comprendre le sens de l’énoncé. L’énoncé « je crois en Dieu » est susceptible du même traitement, et n’a pas le même sens dans la bouche de Voltaire et dans celle de Calvin.
Exemple 3: On parle souvent, en histoire de la philosophie et de la théologie, de « dualisme ». On en parle pour Platon, pour Plotin et toutes les synthèses médiévales, pour Descartes..etc. Mais quand bien même l’énoncé de la doctrine serait le même (ce n’est pas vraiment le cas), elle ne répond pas aux mêmes questions. Chez Descartes la séparation du corps (qui est géométrie) et de la pensée (qui est volonté) sert à fonder la science. Chez Plotin et les néo–platoniciens, le dualisme de l’esprit et de la matière sert à ne pas compromettre Dieu avec le mal. Chez Platon enfin les dualités servent à ne pas effacer le multiple dans l’Un. La même doctrine ainsi, que nous interprétons tout naïvement par rapport aux questions implicites que nous lui posons, a répondu historiquement à des questions très différentes ; et donc pris des sens très différents.
Enoncé du principe de question implicite :
Le sens d’une proposition est fonction de la question implicite à laquelle elle répond.
| Q1 | 3 | |
| Q2 | R | 2 |
| Q3 | 1 |
1.2) Principe de différence problématologique
Exemple 1 : Se reporter à la planche de Tintin (L’affaire Tournesol, p.8 images 6 à 12): « Où se trouve la victime? –C’est moi, Monsieur le Gendarme… » Dans ce cas, on s’aperçoit que chaque énoncé (ici il s’agit des réponses de Séraphin Lampion et du Capitaine Haddock) répond à une question mais permet d’en poser une autre, possibilité que le gendarme semble exploiter au maximum, sous l’oeil perspicace de son adjoint. Le quiproquo vient de ce qu’à chaque réponse on espère avec le Capitaine Haddock commencer à progresser vers les conclusions à tirer de la situation, alors que la question suivante nous fait régresser vers des choses que l’on savait déjà, des « réponses antérieures ». Les questions deviennent alors une forme d’obstruction, elles renvoient en arrière au lieu de faire avancer le débat : l’enquête policière remonte jusqu’à la définition de chaque terme ! On perçoit combien cette manière de briser le fil du récit (qui permettrait d’en venir au fait) peut être odieuse : Socrate particulièrement fut détesté pour cette pratique de la question. On perçoit également ce qu’il y a de comique dans cette volonté de clarifier tous les termes, volonté qui s’empare parfois des intellectuels et très souvent des anti–intellectuels! Vouloir tout expliciter, c’est empêcher les vraies questions de se poser, et les questions « clarificatrices » embrouillent tout. Poursuivant la vraie question soulevée par la situation, Tintin agit.
Cf. Tintin, L’affaire Tournesol, p. 8

Exemple 2 : Dans une conversation apparaît l’énoncé « je vais manger ». Dans le contexte d’interlocution, cette phrase répondait à la question : « où vas–tu ? ». Or cette réponse pose à l’interlocuteur ou lui permet une autre question, qui pourrait d’ailleurs aussi s’énoncer : « où vas–tu ? », mais qui est différente de la première. L’interlocuteur marque alors souvent la différence en modifiant l’énoncé : « où ça? » ; ce qui permet à celui qui répond de comprendre qu’il s’agit d’une question différente, et d’y répondre alors : « je vais au restaurant universitaire »,..etc. La compréhension réciproque dans le dialogue suppose donc d’accepter que l’interlocuteur puisse tirer de mes réponses d’autres questions, différentes de celles auxquelles je répondais. Plus globalement, une réponse n’a de sens « vérifiable », c’est à dire compréhensible, que si elle permet l’éventualité d’une autre question, c’est à dire si elle respecte l’apparition d’un interlocuteur.
Exemple 3 : Un mouvement religieux (le Protestantisme) ou politique (le Communisme) répond à des questions : le cercle infernal de la damnation et de la justification pour le Protestantisme, l’exploitation du travail et des besoins humains pour le Communisme. Mais ces mouvements posent à leur tour d’autres questions auxquelles ils ne répondent pas : le sentiment de l’absurdité humaine devant la Grâce, pour les protestants ; l’incapacité à prendre au sérieux les règles du Droit, pour les communistes. De manière générale, une doctrine, une théorie, une rationalité, ne peuvent pas résoudre les problèmes qu’ils posent : il y a en elles une incomplétude qui leur fait soulever d’autres questions que celles auxquelles elles répondaient.
Enoncé du principe de différence problématologique :
La question a laquelle la réponse répond n’est pas la même que celle a laquelle la réponse renvoie.
| Q1 | — | R1 | ||||
| Q2 | — | R2 | ||||
| Q3 | — | R3 etc. |
_______________
Textes & Exercices 1:
- Pour 1.1 et pour 1.2, expliquez l’un de ces exemples à un ami
- Pour 1.1 et pour 1.2, trouvez vous même un exemple
- Lire les textes 1 et 2 (Richard Rorty et Maurice Merleau–Ponty). Ces deux textes ont une manière d’argumenter commune ; laquelle ?
- Sachant que le « père » de la philosophie, Parménide, écrivait : « Il faut dire et penser que l’être est ; il est en effet l’être et le non–être n’est pas », et qu’ « on ne peut ni dire ni penser le non–être », en quoi à votre avis Parménide « protégeait »-il les sophistes, et que cherche à établir Platon dans le texte n°3 tiré du dialogue Le Sophiste ?
- Voici deux fragments du Ménon de Platon, dont le premier expose un paradoxe, une impossibilité, et dont le second expose la solution, le fait que l’on sache des choses dont’on ne sait pas qu’on les sait. Quel est le rapport chaque fois avec l’interrogation ?
Texte 1 : Merleau-Ponty, Signes, Paris : Gallimard 1980, p.387.
Quant aux philosophes, il y en a de très grands, comme Kant, qui passent pour avoir été aussi peu érotiques que possible. En principe, comment resteraient-ils dans le labyrinthe de Sade et de Masoch puisqu’ils cherchent à comprendre tout cela ? En fait, ils y sont, comme tout le monde, mais avec l’idée d’en sortir. Comme Thésée, ils emportent avec eux un fil. Écrivains eux aussi, leur liberté de regard ne se mesure pas à la violence de ce qu’ils sentent, et il arrive qu’un morceau de cire leur en apprenne beaucoup sur le monde charnel. La vie humaine ne se joue pas sur un seul registre: de l’un à l’autre, il y a des échos, des échanges, mais tel affronte l’histoire qui n’a jamais affronté les passions, tel est libre avec les mœurs qui pense de manière ordinaire, et tel vit apparemment comme tout le monde dont les pensées déracinent toutes choses.
Texte 2 : Richard Rorty, dans la revue Critique, Juillet 1988.
Habermas et Bernstein ont tendance à penser que si tant est qu’un philosophe peut servir à quelque chose, il doit servir des objectifs politiques, que si son oeuvre a quelque valeur, celle-ci sera d’ordre politique: une pertinence eu égards aux controverses politiques contemporaines et aux besoins sociaux actuels. C’est la raison pour laquelle ma «célébration» est, pour Bernstein, « quelque chose de plus que l’apologie idéologique d’une version démodée du libéralisme de la guerre froide déguisée en un discours « postmoderne de bon ton» (25). Et c’est pourquoi Habermas pense qu’il est important de souligner les liens entre le nazisme de Heidegger et son néo-nietzschéisme, ainsi que d’interpréter Derrida et Foucault comme de jeunes conservateurs (Jungkonservative).
Il me semble en revanche que nous devrions plus ou moins considérer la philosophie comme une branche de la littérature (26). Certains philosophes (Mill, Dewey, Rawls, Habermas) ont écrit des livres pertinents pour la pratique politique actuelle, au même titre que certains romanciers (Hugo, Zola, Dickens, Soljenitsyne, Orwell…). Ce n’est pas le cas en ce qui concerne d’autres philosophes (Nietzsche, Heidegger, Derrida, Wittgenstein), tout comme ce n’est pas le cas pour d’autres romanciers (Virginia Woolf, Proust, Nabokov…) (27). Les philosophes dont les écrits n’ont pas d’incidence sur la politique actuelle ne sont pas pour autant systématiquement «irresponsables », pas plus qu’ils ne doivent être systématiquement classés à droite sur l’échiquier politique.
Texte 3 : Platon, Le Sophiste 240–241–249.
É : Tu crois donc qu’il faudrait pouvoir dire que penser faux, c’est penser ce qui n’est pas ?
T: : Nécessairement.
É : Est‑ce penser que ce qui n’est pas n’existe pas, ou que ce qui n’est en aucune façon, existe en quelque façon ?
T : Il faut certainement penser que ce qui n’est pas existe en quelque façon, si l’on veut que l’erreur soit possible si peu que ce soit.
É : Et de même que ce qui existe absolument n’existe absolument pas.
T: Oui
É : Et que c’est encore là une fausseté.
T: C’en est encore une.
É : On jugera de même, j’imagine, qu’un discours est faux s’il affirme que ce qui est n’est pas et que ce qui n’est pas est.
T: En effet, de quelle autre manière pourrait‑il être faux ?
É : Je n’en vois guère d’autre. Mais cela, le sophiste n’en conviendra pas. Et le moyen qu’un homme raisonnable en convienne, quand il a été reconnu précédemment que les non‑êtres sont imprononçables, inexprimables, indéfinissables et inconcevables ? Comprenons‑nous bien, Théétète, ce que peut dire le sophiste ?
T: Comment ne pas comprendre qu’il nous reprochera de dire le contraire de ce que nous disions tout à l’heure, quand nous avons eu 1’audace d’affirmer qu’il y a de l’erreur dans les opinions et dans les discours ? Nous sommes en effet constamment obligés de joindre l’être au non‑être, après être convenus tout à l’heure que c’était la chose du monde la plus impossible.
É : Tu as bonne mémoire. Mais voici le moment de décider ce qu’il faut faire au sujet du sophiste; car tu vois que si, continuant à le scruter, nous le plaçons dans la classe des artisans de mensonges et des charlatans, les objections et les difficultés se présentent d’elles-mêmes et en foule.
T: Je ne le vois que trop.
É : Et encore n’en avons‑nous passé en revue qu’une petite partie : elles sont, pourrait‑on dire, infinies.
T: Impossible, ce semble, de saisir le Sophiste, s’il en est ainsi.
É : Quoi donc! Allons‑nous perdre courage à présent et quitter la partie ?
T: Mon avis à moi, c’est qu’il ne le faut pas, si nous pouvons avoir tant soit peu prise sur notre homme.
É : Tu seras donc indulgent et, comme tu viens de le dire, tu seras content, si nous trouvons moyen de nous libérer tant soit peu de l’étreinte d’un si fort argument.
T: Tu n’as pas à en douter.
É : Maintenant j’ai encore une prière plus pressante à t’adresser.
T: Laquelle ?
É : De ne pas me regarder comme une sorte de parricide.
T: Qu’est‑ce à dire ?
É : C’est qu’il nous faudra nécessairement, pour nous défendre, mettre à la question la thèse de notre père Parménide et prouver par la force de nos arguments que le non‑être est sous certain rapport, et que 1’être, de son côté, n’est pas en quelque manière.
(…)
É : Eh quoi, par Zeus, nous laisserons‑nous si facilement persuader que le mouvement, la vie, l’âme, la pensée n’ont vraiment pas de place en l’être universel, qu’il ne vit ni ne pense, et que, vénérable et sacré, dénué d’intelligence, il reste planté là sans pouvoir bouger?
T: Quelle effrayante doctrine nous accepterions là, étranger !
Texte 4 : Platon, Le Ménon 80 et 85.
MÉNON : Et comment chercheras‑tu, Socrate, ce dont tu ne sais absolument pas ce que c’est? Laquelle en effet, parmi ces choses que tu ignores, donneras‑tu pour objet à ta recherche? Mettons tout au mieux : tomberais‑tu dessus, comment saurais‑tu que c’est ce que tu ne savais pas?
SOCRATE : Je comprends, Ménon, à quoi tu fais allusion. Aperçois‑tu tout ce qu’il y a de captieux dans la thèse que tu me débites, à savoir que, soi‑disant, il est. impossible à un homme de chercher, ni ce qu’il sait, ni ce qu’il ne sait pas? Ni, d’une part, ce qu’il sait, il ne le chercherait en effet, car il le sait et, en pareil cas, il n’a pas du tout besoin de chercher; ni, d’autre part, ce qu’il ne sait pas car il ne sait pas davantage ce qu’il devra chercher.
(…)
S : Ton avis, Ménon? Y a‑t‑il une réponse de ce garçon, où il ait exprimé une pensée qui ne vînt de lui‑même?
M : Non, mais elles étaient bien de lui.
S : Et il est très certain, ainsi que nous l’affirmions un peu auparavant, qu’il ne savait pas.
M : C’est la vérité.
S : D’autre part, elles existaient en lui ces idées, n’est‑ce pas?
M : Oui.
S : Ainsi donc, chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant telles choses qu’il se trouve ne pas savoir, des pensées vraies concernant ces choses mêmes qu’il ne sait pas?
M. Évidemment.
S : Et à présent, ces pensées, elles viennent de se lever en lui, à la façon d’un rêve.
Leçon 2
Archipel de remarques pratiques
dérivées de ces principes
2.1) Sur l’impossibilité de séparer la réponse et la question
Ces deux principes, qui permettent de distinguer le sens d’une « réponse » en fonction de la question qui lui est posée, et la pointe d’une « question » selon que l’on considère la réponse qu’elle problématise ou celle qu’elle appelle, sont indissociables. Question et réponse n’ont de sens que l’une par rapport à l’autre, et le même énoncé qui peut être considéré par un interlocuteur comme une réponse peut être considéré par un autre interlocuteur comme une question.
On peut d’ailleurs dire que plus il y a des réponses, plus il y a des questions, et réciproquement (un peu comme dans la progression des sciences). Globalement il y a toujours à peu près autant de réponses que de questions. Peut– être n’y a–t–il pas de discours ni d’énoncé qui « réponde » là où l’on n’a pas su poser de question ; peut–être également n’y a–t–il pas de question là où l’on n’a pas la moindre idée de la réponse : on ne se pose guère que les questions que l’on pourrait résoudre. Les « vraies » questions, les questions non–traitables, ne s’inscrivent d’ailleurs sur aucun agenda, intellectuel ni politique.
Même lorsqu’on a la chance ou le rare honneur de pouvoir poser une question vraiment sans réponse, cet acte de simple interrogation est encore, et plus que tout, un acte de pure confiance. En un sens on peut dire qu’à la limite ici on ne sait pas si on interroge ou si on répond. Ainsi le but de ce cours n’est pas du tout d’affirmer la primauté de la question sur la réponse, ni l’inverse. Chercher, ce n’est pas forcément être dans le doute perpétuel ; et trouver, ce n’est pas forcément avoir « la » réponse.
2.2) Sur l’implicitation de la question
Pourquoi parler de question « implicite » ? parce qu’une réponse ne répète pas la question à laquelle elle répond. Si le sens des énoncés dépend de ce dont il y est question, on peut dire que la question antérieure est toujours implicite dans l’énoncé, qu’elle est simplement « impliquée » par lui. Car une réponse ne répète pas la question à laquelle elle répond : dans la plupart des cas elle n’en a pas besoin, puisque précisément elle la résout, elle suppose cette question acquise, elle la refoule dans le non–dit. Or ce phénomène, tout naturel dans une conversation orale, pose des problèmes d’interprétation dans le cas de textes, notamment anciens: on ne sait plus de quoi il était question exactement. Il n’est pas inutile non plus d’observer que dans cette démarche de retour, de « remémoration » il est tout à fait impossible de prétendre tout expliciter, de prétendre dégager toutes les questions implicites.
« La réponse (…) n’a donc pas pour mission de renvoyer aux questions qui l’ont fait naître, de s’indiquer comme réponse, c’est à dire comme un tel renvoi, mais de dire autre chose. Le caractère-réponse de la réponse est refoulé dans la réponse, elle possède en elle la capacité de référer, de traiter d’une question, c’est à dire de ce qui est question, mais elle a cependant une référence effective ailleurs qu’en elle-même. Elle ne peut que l’indiquer. La réponse dit ce qu’elle dit sans dire qu’elle le dit (…). Si mon problème par exemple, est de savoir ce que vous faites demain, l’assertion « je vais en ville » y répond. Je ne demande pas que vous me disiez « l’assertion ‘je vais en ville’ répond à votre question »[5].
Dans la plupart des cas en effet le contexte est suffisamment clair, c’est à dire que la question implicite est suffisamment présente à l’esprit, proche encore, même si elle est littéralement absente de la réponse, pour que la réponse soit compréhensible comme telle. Alors la question peut disparaître et s’effacer dans la réponse, qui ne se présente pas comme une réponse mais comme une affirmation. Ce phénomène d’implicitation n’entrave en rien la facilité d’une conversation orale ordinaire. On pourrait même dire au contraire qu’il permet cette facilité, qu’il l’autorise. Sans lui, nous serions obligés de traîner au fur et à mesure de nos conversations l’ensemble de toutes les prémisses communes adoptées, de les répéter explicitement à chaque reprise, au risque de devoir les allonger indéfiniment pour nous entendre sur le moindre énoncé. Or comme le remarque Wittgenstein, pour nous entendre, « nous ne pouvons pas être tombés au préalable d’accord sur tout ce qui serait nécessaire »[6]. Et pourtant, dans la plupart des cas on se comprend à peu près, et l’implicitation des prémisses autorise cette tranquillité. Elle nous permet au moins de faire comme si nous nous comprenions, et de trouver ainsi les moyens de nous comprendre. Et cette confiance autorisée exerce un effet sur la disposition mentale dans laquelle nous dialoguons: de faire en sorte que nous nous comprenions.
Il est toutefois des cas où ce phénomène d’implicitation complique la communication, la retarde, l’intrigue, et parfois l’empêche. Cette proportion de cas où la communication est marquée par l’écart sensible des questions implicites, des points de vue, des présuppositions en jeu, ne doit pas être minimisée. Si on veut alors continuer à faire croire qu’on se comprend, ou faire en sorte qu’on se comprenne, il en résultera plutôt une communication forcée, violentée, tordue. Or dans ces écarts de questions implicites nous n’avons pas affaire à des communications ratées, ou pathologiques. Ce sont peut-être d’ailleurs des cas où la communication, ainsi intriguée et retardée, est d’autant plus vive qu’elle se fait au travers d’une résistance. Ce sont des anomalies normales du dialogue, si l’on peut dire, et c’est là que l’on rend tangible le jeu de la question implicite, qui fonctionne généralement sans que l’on s’en aperçoive. L’expérience centrale est d’abord ici celle de la méprise, c’est à dire de la mécompréhension et de la différence qui peut se glisser entre deux interlocuteurs sans qu’ils y croient, et jusqu’à ce que l’écart des points de vue devienne irrémédiable. Si la même réponse, entendue sous l’optique de la question A et sous celle de la question B, peut rendre un son aussi différent, il ne sert à rien de continuer à répondre! Il faut accepter l’écart des points de vue, non pour le mépriser mais pour l’honorer. On verra que c’est le commencement de la courtoisie ou de la civilité, et les différentes répercussions éthiques de ces observations formeront un axe important de notre propos.
2.3) Sur la figurativité
« La rhétorique est la négociation de la distance entre des hommes à propos d’une question (…) qui peut aussi bien les réunir que les opposer »[7]. La brève analyse précédente permet justement de distinguer deux sortes de désaccords, et donc deux sortes d’accords qui leur correspondent. Nous laissons ici de côté un accord simple où l’on partage la même réponse à la même question, ainsi que le désaccord total où l’on ne partage ni la question ni la réponse. On peut apporter des réponses différentes à la même question. Il y a alors litige. Mais parce qu’on partage la même question implicite, même si on l’interprète différemment, il y a alors une sorte de consensus sur la question, et les réponses différentes se comprennent les unes les autres: elles répondent à la même question. C’est la raison pour laquelle un accord s’effectue davantage en travaillant à trouver la question commune qu’en cherchant une réponse commune. On peut également avoir la même réponse sans partager la question, et ne pas être d’accord sur ce qui est en question. Il y a alors différend. Mais la réponse aura à ce moment-là une sorte d’épaisseur et d’obscurité qui lui permettra de répondre à la fois à ma question et à celle de mon interlocuteur, et c’est cette épaisseur de la réponse que nous appelerons sa figurativité. La figurativité, qui permet à une proposition de prendre sens dans deux configurations (Q/R) différentes, qui permet à une réponse d’être interprétée différemment, constitue une sorte de compromis, de boîte noire où la communication est maintenue dans l’écart même entre les questions en présence.
On distingue souvent dans un texte entre la « lettre » et l' »esprit », ou bien entre le sens littéral et le sens figuré. Cette distinction épouse en partie celle que nous sommes en train d’étudier entre le sens explicite d’un énoncé, qui est littéralement univoque, et son sens implicite ou figuré, qui n’apparaît qu’en regard de la question silencieuse à laquelle il « répond », et qui est sous– entendu. Un symbole ou un mythe est un énoncé ou une suite d’énoncés susceptibles de répondre à de multiples questions implicites, qui font surgir en eux une profusion de sens figurés. La richesse sémantique des grandes oeuvres littéraires ou poétiques (mais aussi des grandes théories scientifiques) tient à cette capacité figurative qu’elles ont de pouvoir répondre, dans des contextes neufs, à des questions neuves.
2.4) Sur l’impossibilité de répondre à tout
Mais dans le même temps on peut dire qu’il n’y a pas d’énoncé qui réponde à toutes les questions, et qu’un énoncé qui aurait réponse à tout, qui serait chaque fois « le cas », ne répondrait aussi à rien véritablement ; ce ne serait pas une réponse. Par exemple : « Jésus est la réponse »! Un énoncé ne « répond », ne prend un sens précis, qu’en réponse à une question précise. Par ailleurs une « réponse » qui exclurait l’éventualité d’une autre réponse ne serait pas une réponse soumise à sa vérification par la question ; ce serait une réponse pour laquelle la question n’est qu’un prétexte, et qui ne répondrait au fond à rien (à rien en dehors d’elle–même) : ce serait peut–être un « symbole », mais ce ne serait pas une réponse.
2.6) Sur la problématisation des réponses
Si tout énoncé permet ou produit des questions ultérieures, différentes de celle à laquelle il répondait, on peut dire que cette ou ces nouvelles questions ne sont que la problématisation de l’énoncé. Le même énoncé, qui répondait à une question, en pose une autre. Le même énoncé, qui était réponse dans une problématique, est question dans une autre. Cette différence entre la question qui est en amont de l’énoncé et celle qui est en aval fonde la possibilité du dialogue, et de manière plus générale la possibilité d’argumenter. Le circuit question-réponse n’est pas réflexe (stimulus- réponse) ni automatique (de forme Q-R). Loin de se borner à des réponses conditionnées, le véritable jeu question-réponse commence lorsque la réponse est à son tour interrogée, avec l’apparition d’une seconde question (de forme Q1-R-Q2). Dans ce jeu, une vraie question ne préjuge pas de la réponse, ni réciproquement une réponse ne préjuge pas de la question qu’elle autorise ou soulève : on ne peut déduire ni la réponse de la question, ni la question de la réponse. Autrement dit, tant que l’on a affaire à des questions implicites que l’on pourrait expliciter, on peut faire équivaloir le sens d’une question à la classe de ses réponses possibles, ou le sens d’une réponse à la classe des questions auxquelles elle est susceptible de répondre. Mais avec l’invention[8] d’une question inédite, comme avec la découverte de l’implicite irréductible à la formulation d’une question, il se produit quelque chose d’autre.
La différence problématologique permet de faire voir le procès par lequel un sens littéral devient sens figuré. En effet dans la « lecture » littérale, la réponse à une question ne fait pas de question : elle répond, elle a son sens. La lecture figurative réside dans une problématisation de la réponse : la réponse ne répond littéralement plus, elle ne répond qu’au sens figuré ; mais la nouvelle question n’est pas encore explicite, elle aussi n’est que figurée dans la réponse. Le même énoncé n’est ni simplement réponse, ni purement question. Disons qu’il est une métaphore : dans le travail de métaphorisation, la réponse est grosse d’une question. Dans la plupart des cas d’ailleurs la réponse ne « recouvre » pas totalement la question. Mais la réponse aide la question à se débarasser de ce qui en elle « n’est pas la question ». En ce sens on peut dire que ce qui justifie une réponse, ce qui la rend selon le cas légitime, vérifiable, compréhensible, « déceptible », c’est la question qu’elle permet de poser.
2.7) Et sur leur autonomisation
Le phénomène par lequel une réponse est perçue comme soulevant un autre problème correspond à l’autonomisation des réponses par rapport aux questions qui leur ont donné le jour et qu’elles ont cherché à résoudre. Par là une réponse échappe aux intentions de son locuteur ou de son auteur, ainsi qu’aux traits pertinents du contexte dans lequel elle répondait. Par la problématisation que l’interlocuteur y exerce, le sens premier est suspendu, ainsi que la référence au contexte initial. Ici encore ce phénomène permet de rendre compte de manière relativement simple de problèmes pragmatiques ou herméneutiques spécifiques. Mais justement cette autonomisation n’est pas un automatisme du langage : une réponse à une question n’énonce pas forcément par là-même une autre question, car pour cela il faut que soit problématisé ce qui était hors-question, l’évident, ce qui n’était pas le problème. Pourquoi est-ce qu’une question ne peut pas complètement être déduite ou réduite sans autre à la classe de ses réponses, ni le sens d’une réponse réduite à la classe des questions auxquelles elle répond? Parce qu’un autre interprète toujours peut se lever, qui voit un problème là où l’on n’en voyait pas, ou qui voit une autre réponse que toutes celles qui avaient été jusque là apportées. La question véritable vient toujours d’ailleurs, d’un autre « monde« , d’un interlocuteur capable, parfois à son insu, de déplacer le contexte, de le bouleverser. Meyer écrit:
« Problématiser une assertion qui n’était que réponse (…) est affaire de contexte. (…) le contexte comporte nécessairement deux questionneurs au moins. L’un pour lequel la réponse est réponse, sans plus, l’autre pour lequel elle fait problème »[9].
Changer de question, c’est changer de règle (régime) du discours. Si dans le dialogue un sujet c’est un point de vue, une dramaturgie du dialogue pourrait montrer comment un sujet c’est une question. Passer d’une question à une autre, c’est passer d’un angle de subjectivité à un autre, c’est déjà développer en soi une sorte d' »intersubjectivité ». Mais cela suppose l’intervention de l’autre, parce que dans la posture dialogique où je me trouve, ma question en dissimule d’autres qui échappent à ma conscience, même si ce sont elles qui l’autorisent. Et le travail qu’il faut pour déplacer ma question me dépasse.
On peut définir l’argumentation comme la technique ou l’art d' »épouser » les présupposés de nos auditeurs ou interlocuteurs, afin de se faire comprendre d’eux ; c’est aussi éventuellement l’art de les manipuler en obtenant, à partir de leurs valeurs ou présuppositions implicites et au moyen d’arguments explicites, leur adhésion à une conclusion. De ce point de vue le principe de différence problématologique permet de comprendre pourquoi énoncer une thèse revient le plus souvent à rendre possible sa problématisation ; c’est pourquoi la persuasion préfère suggérer la conclusion par une question, sans l’expliciter : ainsi l’adhésion de l’auditoire est obtenue sur une réponse mentale, implicite, plus difficile à problématiser. La question et la réponse échangent leur rôle !
2.8) Sur les carrés problématologiques
Il arrive que la réponse à une question pose une deuxième question dont la réponse était à l’origine de la première question. Deux problématiques accrochées, un carré problématologique:
| Q1 | R1 |
| R2 | Q2 |
Ce sont des problématiques dont on ne parvient pas à sortir, qui bornent le théâtre du débat, et où tout se passe comme si on était renvoyé d’un problème à un autre, dans un cercle vicieux où les deux problèmes se renforcent l’un l’autre. Ces problématiques décrivent des situations relativement fréquentes, devant lesquelles on peut apprendre à se comporter. On pourrait donner de nombreux exemples de ces « carrés problématiques », comme le malentendu entre le souci de l’universalité face aux dangers du nationalisme, des tribalismes, et le souci des différences face aux dangers du marché et de la communication planétaires.
2.9) Sur le danger d’instrumentaliser le dialogue en sous-estimant les questions des interlocuteurs
Pour que le dialogue soit possible et que l’interaction ne soit pas instrumentalisée, pour que toute question permette à la réponse de lui répondre, pour que toute réponse permette de poser une autre question, il faut bien que chaque interlocuteur puisse déconcerter l’autre, répondre de façon inattendue et néanmoins pertinente, interroger de façon inattendue en prenant la réponse par un biais surprenant. Cela suppose de chercher sincèrement à comprendre les questions de l’interlocuteur, et comme le dit Gadamer de ne pas prétendre
« détenir un savoir préalable sur les préjugés dont l’autre est captif. Il s’enferme alors dans ses propres préjugés. L’entente dialogique est en principe impossible si l’un des partenaires ne s’ouvre pas vraiment au dialogue. Un tel cas se produit par exemple lorsque quelqu’un joue au psychologue ou au psychanalyste dans les relations sociales et ne prend pas au sérieux, dans leur sens propre, les affirmations d’autrui et qu’il prétend plutôt les démasquer »[10].
Ricoeur propose des rapports entre sciences sociales et idéologie une analyse très voisine, lorsqu’il dit:
« L’idéologie, c’est la pensée de mon adversaire (…) Il ne le sait pas, mais moi je le sais (…) Un argument courant est de dire que l’idéologie est un discours de surface qui ignore ses propres motivations réelles. L’argument est plus impressionnant encore lorsqu’on oppose le caractère inconscient de ces motivations réelles (…) Le changement de plan de l’illusoire au réel, du conscient à l’inconscient, a certes par lui-même un grande puissance explicative. Mais c’est cette puissance explicative elle-même qui constitue un véritable piège épistémologique »[11].
2.10) Sur le danger d’abstraire les énoncés des questions qui les sous-tendent
Essayons maintenant de lire une page de Tintin (ou de n’importe quelle BD qui vous plaise) à l’envers, en cachant à chaque fois l’image précédente ; ou pire encore : en essayant d’isoler les « bulles » de leur contexte dialogal et figural, de tout ce qui précède, de tout ce qui accompagne, et de tout ce qui suit. On s’aperçoit dans cette tentative de lecture que les énoncés deviennent absurdes, insensés. Imaginez que nous en fassions autant pour un dialogue de Molière ! Et pourtant c’est souvent ce que nous faisons avec les dialogues de Platon, et avec les textes bibliques ! Et c’est aussi ce que nous faisons parfois les uns pour les autres, d’une manière fort peu charitable car nous privons les énoncés de nos interlocuteurs du sens qu’ils voulaient leur donner, dans un contexte d’élocution précis.
Remarquons toutefois que certaines phrases, ou suites de phrases, si on les isole ainsi et si on les imprime avec une belle écriture sur une page blanche, prennent une sorte de résonance « poétique ». Comme si elles avaient un sens, mais que nous ne savions pas lequel ! Nous pouvons donc parfois nous permettre d’isoler ainsi des énoncés qui nous « parlent », à condition : 1) de savoir que le sens qu’ils prennent alors n’a pas grand rapport avec la question à laquelle ils répondaient primitivement ; 2) de savoir que ce nouveau sens réside plutôt dans la « proposition » de monde, de perception ou d’action, que nous tirons de ces énoncés (sous notre entière responsabilité).
_______________
Textes & Exercices 2 :
- Expliquez à un ami pourquoi il est difficile de prétendre tout expliciter
- Expliquez à un ami dans quels contextes peut apparaître une « figure » de rhétorique
- Appliquez à un essai que vous avez lu récemment les conseils de lecture donnés ici. Pouvez-vous résumer le livre, ses questions implicites, ses déplacements et les questions soulevées en 20 lignes ?
- Trouvez vous même un exemple d’autonomisation d’une réponse ou d’un discours par rapport à la question-contexte antérieurs
- Discutez avec un ami d’un sujet compliqué, puis construisez-en le carré problématologique —extrêmement utile pour attraper les problèmes (voir le traitement de la question conjugalité-filiation à la fin des quatrièmes éléments).
Conseils pour la lecture et l’audition
- Pour comprendre un livre (un interlocuteur aussi, mais l’exemple du livre est plus visible), il faut partager la question qui est la sienne. Sans quoi on n’est ni capable de le comprendre, ni autorisé à le juger. Cette question (ou ce paquet de questions) est toujours et pour la plus grande partie implicite, et non pas donnée avec le texte. Et même si elle est donnée, il faut encore la partager. La question est en même temps la perspective d’intelligibilité du texte, l’espace dans lequel il prend son sens, et le critère qui permet d’en juger, de vérifier jusqu’où le texte couvre la question.
- Pour comprendre un livre, il faut chercher la différence entre les questions qu’il résout et celles qu’il pose. On peut considérer un livre comme un système de transformations et de déplacements tel qu’on part d’une situation où se pose telle ou telle question, et qu’on arrive à une situation où les questions premières ont été résolues ou transformées en d’autres questions (qui sont, pour le système en question, les « vraies » questions, celles qu’il ne peut pas résoudre).
- Pour généraliser la remarque, on peut dire qu’il n’y a pas de théorie, de doctrine, de système qui, précisément parce qu’il résout certains problèmes, puisse résoudre les problèmes qu’il pose. Il y a, du fait de la différence problématologique, une incomplétude de principe des réponses. Mais il faut aussi remarquer qu’il faut avoir compris le livre ou le système pour comprendre vraiment les problèmes qu’il pose ou qu’il laisse.
- Devant un problème, il est inutile de rester les bras croisés et de croire qu’une pensée va tomber du ciel ! Il faut activement faire le tour du problème. La pensée est une affaire de comportement, et il s’agit de trouver une problématique, un angle d’attaque. Le principal ennui que rencontre un étudiant débutant, c’est d’être « censé savoir » des tas de choses que personne ne lui a appris; il lui semble être débordé par tous ces présupposés implicites. Mais si déjà il « sait » qu’il y a des choses qu’il ne sait pas, il peut se mettre à chercher celles qui lui semblent les plus importantes, et faire « comme si » il savait les autres.
- Il ne faut pas croire que l’on puisse « tenir compte de tout », de tout ce qu’on a appris, etc. Car tout ce qu’on a appris ou trouvé sur un sujet ne répond pas forcément ni exactement à la même question : en tenant compte de tout on mélange les problématiques, on force tous les discours à répondre à la même confuse question, et tout devient plus ou moins incompréhensible. Tabler les règles de son discours, c’est annoncer le plus possible de quoi on parle, quelle est la question, et c’est ce qui fait que son discours est « vérifiable » ou « décevable »: son angle d’interrogation est sa limite. Sinon soit on identifie tout, et l’analogie où tout revient au même est l’opium de la pensée, soit on sépare tout parce qu’il n’y aurait pas de question ni donc de vérité commune, et on dissout tous les problèmes.
- Cela suppose des lecteurs attentifs, c’est à dire aussi résolument « négligents » quant à ce qu’ils ne comprennent pas. Si vous disposez de toute votre attention au départ, et que vous en laissez une partie sur une phrase vraiment difficile, puis une autre sur un nom que vous ne connaissez pas, puis sur une idée dont vous ne voyez pas le rapport avec ce qui précède, vous continuerez votre lecture avec très peu d’attention disponible et vous buterez sur chaque mot. Pour bien comprendre quelque chose, il faut tant que possible bien mettre les parenthèse dans son esprit, pour laisser résolument de côté ce qu’on ne comprend pas, suspendre les doutes, et n’y revenir qu’à la fin.
Textes 5 : Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Paris Hachette 1982, p.97sq. et 122sq. De la problématologie, Bruxelles Mardaga 1986, p.12 et 88.
Le recours au langage s’inscrit dans le cadre général de l’action humaine. Les hommes agissent en fonction des problèmes qui se posent à eux et qu’ils se doivent de rencontrer du simple fait qu’ils existent. A ce titre, l’usage du langage est résolution de problèmes. Il n’y a que deux manières d’affronter un problème à l’aide du langage : soit on l’exprime parce que la résolution dépend d’autrui, soit on en donne la solution à un autrui qui s’intéresse à la question ou que l’on intéresse eo ipso à la question traitée. (…)
La dualité fondamentale du langage est la différence question-réponse, que j’ai appelée ailleurs différence problématologique. Elle est à la source du langage en ce que ce dernier répond à la problématique humaine, dont l’interaction dialogique est une dimension essentielle sur laquelle viennent se greffer le problème d’informer, de communiquer, de persuader, etc. A ce niveau, la différence problématologique se matérialise dans l’opposition de l’explicite et de l’implicite : la marque de certaines réponses est d’être explicites. D’autre part, si les problèmes ne se disent pas, ils se laissent exprimer, et cela laisse la place à une manière de répondre proprement problématologique. Tout discours, de la simple phrase au grand texte, peut ainsi assurer a priori la double fonction du langage : traiter des problèmes qui s’y posent en en proposant la solution ou en en exprimant la nature. Dès lors, une proposition, un discours, peuvent aussi bien marquer la question que la solution. Une expression apocritique (‑ caractérisant une réponse), quoique apocritique par rapport à la question qu’elle résout ‑ c’est là la définition du caractère apocritique d’une proposition ou d’un discours ‑ est donc également problématologique (= expressive d’une question). De quelle question une réponse est‑elle le renvoi ? A première vue, de la question qu’elle résout. Si elle la résout, et que c’est là le seul renvoi possible, elle n’a alors qu’une fonction possible, la fonction apocritique. Ou bien, la duplication problématologique de la question serait sa solution, ce qui va à l’encontre de la distinction question‑réponse : on ne va pas résoudre une question en simplement la répétant. Dès lors, la question à laquelle la réponse renvoie (problématologiquement) diffère de celle qu’elle résout (apocritiquement). La réponse, en tant qu’unité apocritico‑problématologique, définit deux questions au moins, et c’est par là que se trouve fonder, la possibilité dialogique du langage en même temps que l’autonomisation des réponses par rapport aux questions qui les ont fait naître. (L.L.A. p. 122 sq).
A une description j (a, m) répond un individu particulier dans m, et à a correspond cet individu pour x = a. Cela veut dire que le rapport à un monde quel qu’il soit est interrogation. C’est ainsi que l’on découvre et trouve la référence. La relation au monde est questionnement. Le langage naturel est éloquent à ce propos, puisqu’il n’existe pas de termes définissables sans l’intervention d’interrogatifs : « Napoléon est le vainqueur d’Austerlitz » ou « le fauteuil est rouge » ne sont descriptions vraies d’états du monde que si quelque chose répond aux questions que ces propositions sont à l’égard du monde. Elles se lisent : « Napoléon est celui qui a vaincu à Austerlitz », « le fauteuil est l’objet qui a couleur rouge ». Et si l’on ignore ce qu‘est le rouge ou Austerlitz, on peut encore compliquer : « … la ville que l’on appelle Austerlitz », « … la propriété qui… ». Chacun de ces interrogatifs ouvre, comme mondes possibles, les réponses alternatives qu’elles admettent. Le nombre minimum est deux, puisque la question qui n’a que l’affirmation (« oui, … ») ou la négation (« non, … ») comme réponses possibles a l’alternative comme seules possibilités de réponse. La réponse réelle donne un monde réel parmi les réponses possibles. Bref, lorsque l’on cherche à identifier de quoi il est question dansun discours, on le fait explicitement à l’aide de particules interrogatives : « c’est l’homme qui a vaincu à Austerlitz qui aperdu à Waterloo » se réfèrent ainsi au même individu. Le langage naturel fait bien souvent l’économie de son rapport questionnant au monde, puisque, la plupart du temps, on sait et l’on comprend de quoi il est question lorsqu’on parle de ce dont on parle. (Ibid p. 97).
La réponse, qui en est le résultat, n’a donc pas pour mission de renvoyer aux questions qui l’ont fait naître, de s’indiquer comme réponse, c’est‑à‑dire comme un tel renvoi, mais de dire autre chose. Le caractère‑réponse de la réponse est refoulé dans la réponse, elle possède en elle la capacité de référer, de traiter d’une question, c’est‑à‑dire de ce qui est question, mais elle a cependant une référence effective ailleurs qu’en elle‑même. Elle ne peut que l’indiquer. La réponse dit ce qu‘elle dit sans dire qu‘elle le dit. Le propre d’une réponse n’est pas de se dire (comme réponse) mais de dire quelque chose qui n’est pas le fait qu’elle dise quoi que ce soit : elle dit ce dont il est question, et puisque réponse il y a, de le dire comme ne faisant plus question. Celle‑ci se manifeste comme l’absence nécessaire à la présence du discours. Si mon problème, par exemple, est de savoir ce que vous faites demain, l’assertion « je vais en ville » y répond, Je ne demande pas que vous me disiez « l’assertion ‘je vais en ville’ répond à votre question » car le fait que cette assertion soit présentée comme réponse, et préserve le sens de la réponse, n’implique en rien que vous alliez en ville. Je vous demande de me répondre sur une action et non sur une assertion. (Ibid p. 132)
Et c’est ainsi que la différence de nature entre science et philosophie, rendue plus aiguë par le recul accusé par celle‑ci, a fini par faire problème. Mais la philosophie s’ignorant toujours comme problématologie n’a pu se penser sur un autre modèle, rendant justice à sa propre spécificité, et permettant précisément d’accepter et même de préférer un mode de discours exprimant le problèmatique plutôt que voulant le résorber chaque fois dans la solution qui le supprime. La philosophie livre des réponses qui, si l’on y regarde de près, ne sont pas des réponses au sens du modèle propositionnel du langage, de la science, c’est‑à‑dire de la Raison. Les questions philosophiques, ne pensant pas la radicalité qu’elles mettent en oeuvre et qu’elles renferment, sont tournées vers autre chose qu’elles‑mêmes, et partant, déterminent la philosophie comme ontologie, la plaçant en rivalité avec la science, avec les conséquences que l’on sait. Pourtant, il y a une différence, qui se joue dans la conception qui sous‑tend le questionnement en science et en philosophie. Faute de disposer d’une problématologie qui rende justice à cette différence, on n’a vu, ici et là, que des propositions, susceptibles donc de vérité et de fausseté, opposables et comparables aux autres propositions. Mais là, on se heurte à la positivité et à l’efficacité de la science qui font défaut aux systèmes philosophiques. En réalité, ceux‑ci renvoient à une problématisation opérée au travers de propositions qui ont ceci de propre qu’elles sont problémato‑logiques, c’est‑à‑ dire qu’elles expriment la problématisation en même temps qu’elles y répondent. Cette double nature de réponse et d’expression problémato-logique laisse clairement apparaître que formuler un problème est, en philosophie,le résoudre, puisque problématiser est le but du discours philosophique. Dès lors, il devient absurde de s’étonner que la philosophie perpétue ses problèmes, car c’est ce en quoi elle y répond. Elle se démarque donc de la science qui supprime le problème, celui‑ci une fois résolu. Ce qui serait faiblesse en science fait au contraire la richesse de la philosophie. (Problématologie p. 13-15)
Le surgissement de l’interrogation, chez Socrate, faisait éclore la dualité de l’ignorance, qui se prend pour un savoir, et d’un savoir qui se sait ignorance. L’ignorance présente dans un savoir qui ne répond à rien est en fait une apparence de savoir, alors que le savoir qui est l’assertion de l’ignorance de Socrate est un savoir réel. L’interrogation socratique fait éclater l’apparence et le réel. Elle pose une pluralité, car la réponse s’inscrit dans un espace d’alternatives. L’interrogation naît toujours sur fond d’une multiplicité et le but de l’interrogation est d’avoir la réponse, c’est‑à‑dire une réponse. Supprimer la multiplicité par la réponse, supprimer l’apparence pour parvenir à l’unité, tel est le sens de l’interrogation chez Socrate. Le multiple est l’apparence posée par la question, et l’unité est le réel pensé par la réponse. Il en va ainsi pour toute question, car elle étale l’alternative et le multiple comme ce qui est à dépasser. (Ibid p. 88)
Leçon 3
Y a-t-il de simples questions?
Des questions pour rien?
Il est toujours un point où l’on ne parvient plus à savoir si on répond ou si on interroge, et en ce point il n’y a plus de méthode : il n’y a plus que de simples questions, pour rien. Nous y sommes aux extrémités du dialogue. Les quelques méditations un peu interrompues qui suivent sont à lire comme une préparation aux 5èmes éléments, et conjointement à eux.
3.1) L’intelligence comme questionnement
L’interrogation décentre mon monde. Elle m’oblige à suspendre mes questions propres, à les mettre entre parenthèses, pour reconstruire le sens des propositions, des textes, du monde, à partir d’autres questions possibles. La formation de l’intelligence correspond à l’intégration progressive des questions d’autrui, de la possibilité d’autres questions que les nôtres. Il y a ainsi une sorte de « réorganisation problématologique » nécessaire, qui me permet de tenir compte de toi, de lui, d’eux, etc.
La capacité à intégrer de nouvelles questions marque la possibilité d’augmenter notre schématisme: certaines interrogations ouvrent en nous de nouvelles possibilités d’être au monde. N’importe quel énoncé formulé ou entendu ainsi sur le mode étonné de « la première fois » peut être considéré comme une interrogation, en ce sens de l’ouverture d’un schème. Cette formation de l’intelligence est aussi une formation de la sensibilité, un élargissement de nos facultés de comprendre, de sentir et d’agir, qui nous permet de voir autrement les choses les plus ordinaires, que nous ne sentons plus ou que nous n’avons encore jamais senties.
La pensée interrogative sait que la réponse, l’invention, la trouvaille, ou l’atteinte est une chance et non un résultat que l’on puisse être sûr d’atteindre ni d’avoir acquis. C’est le risque de l’intelligence que de trop vite trouver des solutions, là où il faudrait attendre, repasser sur la question jusqu’à la trouer pour déplacer l’entière problématique.
3.2) Questions et enfances
A vouloir tenir compte de tout, travailler « en bout d’outillage », on perd le Nord, qui est que tout peut et doit recommencer simplement. En effet les grandes inventions « morales », au sens large (artistiques, politiques, spirituelles), à la différence des inventions techniques qui sont cumulatives, sont des inventions réitératives, des réinventions dans des générations différentes et dans des contextes divers. Des inventions qui demandent une expérience à chaque fois singulière et que nul acquis ne peut épargner; des inventions qui sont à chaque fois la première fois, simplement parce que des enfants grandissent qui nous sont à certains égards plus étrangers que nos contemporains les plus éloignés.
Et , parce qu’il y a des enfants qui grandissent, les vraies questions sont toujours neuves. Toute interrogation véritable nous donne une naïveté seconde, un « cogito » d’enfance[12]. Toute interrogation véritable est une enfance. C’est la vertu proprement poétique de l’interrogation, qu’elle peut suffire à engendrer un sujet. C’est le « qui suis–je? », ou le « qui dites–vous que je suis? » que toute question comporte. Comme si nos réponses étaient des interprétations de cette question.
Accepter d’être né, c’est accepter d’avoir des présupposés, d’être issu d’une situation, d’une « question » parmi d’autres qui auraient été non moins possibles, et en être content. Etre content d’interpréter cela. Il est une autre joie d’enfance, c’est l’envie de jouer, c’est à dire d’adopter d’autres possibilités d’être, d’essayer d’autres questions possibles, et d’autres interprétations. La vie oscille entre ces deux limites du plasir d’exister.
3.3) Y a–t–il de simples, de pures questions?
C’est à dire des questions qui ne contiennent absolument en rien la réponse? (par ex. à la deuxième page du Temple du Soleil, Tintin: « Oh ! Pour rien… Une simple question… » —enfant, cette phrase me plongeait dans des abîmes) Une question vraiment pour rien serait une question pour le plaisir, ou bien pour savoir, purement. Mais ce serait un plaisir qui ne se vanterait de rien devant personne, ou bien un savoir qui ne serait un moyen pour rien et contre personne.
Une telle question ne serait pas un chemin mais une extrémité, une impasse ou une atteinte. Mais une question qui ne serait pas un chemin serait–elle encore une question? La première question comme la dernière question ne nous appartiennent pas. Elles nous précèdent ou nous dépassent toujours. Elles deviennent une ouverture du langage, une ouverture de l’être parlant. En ce point l’interrogation est comme une confession: elle est en même temps une affirmation et une invocation.
_______________
Textes & Exercices 3 :
Lectures à loisir —mais un crayon à la main. Possibilité aussi d’aller lire les citations utilisées dans la leçon 11 :
Texte 6 : Platon, Apologie de Socrate 21.
Ensuite je m’efforçai lui faire voir qu’il croyait sans doute être sage, qu’il ne l’était pas cependant. (d) Or,, à partir de ce moment, je lui devins odieux, ainsi qu’à beaucoup de ceux qui assistaient à notre conversation. je me faisais du moins, tout en m’en allant, ces réflexions : « Voilà un homme qui est moins sage que moi. Il est possible en effet que nous ne sachions, ni l’un ni l’autre,, rien de beau ni de bon. Mais lui, il croit qu’il en sait, alors qu’il n’en sait pas, tandis que moi, tout de même que en fait, je ne sais pas, pas davantage je ne crois que je sais! J’ai l’air, en tout cas, d’être plus sage que celui‑là, au moins sur un petit point, celui‑ci précisément: que ce que je ne savais pas, je ne croyais pas non plus le savoir! » En suite de quoi, j’allai en trouver un autre de ceux dont la réputation de sagesse était plus grande encore que celle du précédent. (e) Ce fut aussi chez moi le même sentiment. Nouvelle occasion de me rendre odieux à celui‑là et à beaucoup d’autres. Après quoi, je continuais cependant d’aller les trouver les uns à la suite des autres, me rendant bien compte, non sans chagrin ni sans crainte, que je me rendais odieux. Malgré tout, je me jugeais forcé de donner l’importance la plus grande à la parole du Dieu! En avant donc! puisque j’examine ce que l’oracle veut dire, allons à tous ceux, sans exception, qui ont la réputation de savoir ! (a) Oui, par le Chien! (il faut en effet, Athéniens, que je vous dise la vérité) mon impression, je l’affirme, fut à peu près celle‑ci : au cours de l’enquête que je faisais suivant la parole du Dieu, peu s’en fallut que ceux qui avaient la plus belle réputation, ne fussent, à mon avis, ceux auxquels il manquait le plus, alors que d’autres, qui passaient pour valoir moins, étaient davantage des hommes convenablement doués sous le rapport du bon jugement.
Texte 7 : Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 1 première page.
Tout art et toute investigation et pareillement toute action à ce qu’il semble tendent vers quelque bien. Aussi a‑t‑on déclaré avec raison que le Bien est ce à quoi toutes choses tendent. Mais on observe, en fait, une certaine différence entre les fins . les unes consistent dans des activités, et les autres dans certaines oeuvres, distinctes des activités elles‑mêmes. Et là où existent certaines fins distinctes des actions, dans ces cas‑là les oeuvres sont par nature supérieures aux activités qui les produisent.
Or, comme il y a multiplicité d’actions, d’arts et de sciences, leurs fins aussi sont multiples : ainsi l’art médical a pour fin la santé, l’art de construire des vaisseaux le navire, l’art stratégique la victoire, et l’art économique la richesse. Mais dans tous les arts de ce genre qui relèvent d’une unique potentialité (de même, en effet, que sous l’art hippique tombent l’art de fabriquer des freins et tous les autres métiers concernant le harnachement des chevaux, et que l’art hippique lui‑même et toute action se rapportant à la guerre tombent à leur tour sous l’art stratégique, c’est de la même façon que, d’autres arts sont subordonnés à d’autres), dans tous ces cas, disons‑nous, les fins des arts architectoniques doivent être préférées à toutes celles des arts subordonnés, puisque c’est en vue des premières fins qu’on poursuit les autres. Peu importe, au surplus, que les activités elles‑mêmes soient les fins des actions, ou que, à part de ces activités, il y ait quelque autre chose, comme dans le cas des sciences dont nous avons parlé.
Si donc il y a, de nos activités, quelque fin que nous souhaitons par elle‑même, et les autres seulement à cause d’elle, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d’une autre (car on procéderait ainsi à l’infini, de sorte que le désir serait futile et vain), il est clair que cette fin‑là ne saurait être que le bien, le Souverain Bien.
Texte 8 : René Descartes, 1ère des Règles pour la direction de l’esprit
Les hommes ont l’habitude, chaque fois qu’ils découvrent une ressemblance entre deux choses, de leur attribuer à l’une et à l’autre, même en ce qui les distingue, ce qu’ils onc reconnu vrai de l’une d’elles, Ainsi, faisant une comparaison fausse entre les sciences, qui résident tout entières dans la connaissance qu’a l’esprit, et les arts, qui requièrent un certain exercice et une certaine disposition du corps, et voyant, par ailleurs que tous les arts ne sauraient être appris en même temps par le même homme, mais que celui qui n’en cultive qu’un seul devient plus facilement un excellent artiste, parce que les mêmes mains ne peuvent pas se faire à la culture des champs et au jeu de la cithare ou à plusieurs travaux de ce genre tous différents, aussi aisément qu’à l’un d’eux, ils ont cru qu’il en est de même pour les sciences elles-aussi, et, les distinguant les unes des autres selon la diversité de leurs objets, ils ont pensé qu’il faut les cultiver chacune à part, sans s’occuper de toutes les autres. En quoi certes ils se sont trompés. Car, étant donné que toutes les sciences ne sont rien d’autre que la sagesse humaine qui demeure toujours une et toujours la même, si différents que soient les objets auxquels elle s’applique et qui ne reçoit pas plus de changement de ces objets que la lumière du soleil de la variété des choses qu’elle éclaire, il n’est pas besoin d’imposer de bornes à l’esprit : la connaissance d’une vérité ne nous empêche pas en effet d’en découvrir une autre, comme l’exercice d’un art nous empêche d’en apprendre un autre, mais bien plutôt elle nous y aide.
Texte 9 : Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, §40.
Les maximes suivantes du sens commun n’appartiennent pas à notre propos en tant que parties de la critique du goût; néanmoins elles peuvent servir à l’explication de ses principes. Ce sont les maximes suivantes: 1. Penser par soi-même ; 2. Penser en se mettant à la place de tout autre; 3. Toujours penser en accord avec soi-même. La première maxime est la maxime de la pensée sans préjugés, la seconde maxime est celle de la pensée élargie, la troisième maxime est celle de la pensée conséquente. (…) En ce qui concerne la seconde maxime de la pensée nous sommes bien habitués par ailleurs à appeler étroit d’esprit (borné, le contraire d’élargi) celui dont les talents ne suffisent pas à un usage important (particulièrement à celui qui demande une grande force d’application). Il n’est pas en ceci question des facultés de la connaissance, mais de la manière de penser et de faire de la pensée un usage final; et si petit selon l’extension et le degré que soit le champ couvert par les dons naturels <die Naturgabe> de l’homme, c’est là ce qui montre cependant un homme d’esprit ouvert <von erweiterter Denkungsart> que de pouvoir s’élever au-dessus des conditions subjectives du jugement, en lesquelles tant d’autres se cramponnent, et de pouvoir réfléchir sur son propre jugement à partir d’un point de vue universel (qu’il ne peut déterminer qu’en se plaçant au point de vue d’autrui).
Texte 10 : Soeren Kierkegaard, 1ère page du chap.1 des Riens philosophiques, et chap.5-1-a :
L’ignorant qui pose la question ne sait même pas ce qui l’amène à la poser.
CHAPITRE 1
Hypothèse fictive
A quel point la vérité peut‑elle s’apprendre ? Ce sera notre première question. Une question socratique, ou qui l’est devenue par celle que posait Socrate : si la vertu peut s’enseigner? Ne la définissait‑il pas en effet comme un savoir? (voir le Protagoras, le Gorgias, la Ménon, l’Euthydème). Mais, si tant est qu’elle s’enseigne, il faut bien présupposer qu’elle n’existe pas ; voulant donc l’apprendre, on la cherche. Ici l’on bute alors sur cette difficulté que Socrate dans le Ménon (à la fin du § 80) signale comme une « proposition batailleuse » à savoir qu’il est également impossible à un homme de chercher ce qu’il sait, et de chercher ce qu’il ne sait .pas ; car ce qu’il sait, comment le sachant, peut‑il le chercher? et ce qu’il ne sait pas, comment peut‑il le chercher ne sachant même pas quoi chercher? (…)
La première génération
De disciples secondaires
Celle‑ci a bien l’avantage (relatif) d’être plus voisine de la certitude immédiate, d’être plus près d’obtenir une exacte et sûre information sur ce qui est arrivé, de gens dont la véracité peut se contrôler d’autres manières peut se contrôler. Nous avons déjà au chapitre IV calculé cette certitude immédiate. Être quelque peu plus près d’elle, n’est‑ce pas une illusion? car n’être pas près de l’immédiate certitude au point d’être immédiatement certain, c’est en rester éloigné d’une distance absolue. Supputons cependant cette diversité relative (qui distingue la première génération de disciples secondaires en face des postérieurs) ; à combien l’estimer? Nous ne le pouvons jamais naturellement que par rapport à l’avantage du contemporain ; mais celui‑ci (la certitude rigoureusement immédiate) n’en avons‑nous pas déjà au ch. IV défini l’ambiguïté (anceps ‑ aléatoire)? et nous y reviendrons plus amplement au paragraphe suivant. — Ou bien supposons dans la génération la plus proche un homme joignant à la puissance la passion d’un tyran, et qu’il ait eu l’idée, de ne s’occuper qu’à établir la vérité sur ce point, eût‑ce suffi pour qu’il fût le disciple? Mettons qu’il se saisît de tous les témoins contemporains encore en vie et de leurs proches, qu’il les fît interroger isolément avec la pire rigueur, qu’il les mît en cellule comme les 70 Juifs d’Alexandrie, les affamât pour leur arracher la vérité, les soumît aux confrontations les plus insidieuses, rien que pour s’assurer à tout prix une information sûre… toute cette information ferait‑elle de lui le disciple? Ne porterait‑il pas plutôt le dieu à sourire de lui, pour avoir voulu ainsi usurper ce qui ne se laisse point acheter pour de l’argent, mais non plus prendre de force ?
Texte 11 : Maurice Merleau–Ponty, Le visible et l’invisible, Paris : Gallimard, 1964, coll. TEL, p.137sq.et 175.
La manière de questionner du philosophe n’est donc pas celle de la connaissance: l’être et le monde ne sont pas, pour, lui de ces inconnues qu’il s’agit de déterminer par leur relation avec des terme connus, les uns et les autres appartenant par avance au même ordre des variables qu’une pensée prenante cherche à approcher au plus près. La philosophie n’est pas davantage prise de conscience: il ne s’agit pas pour elle de retrouver dans une conscience législatrice la signification qu’elle aurait donnée au monde et à l’être par définition nominale. De même que nous ne parlons pas pour parler, que de quelque chose ou de quelqu’un, et que, dans cette initiative de la parole, est impliquée une visée du monde et des autres à laquelle tout ce que nous disons est suspendu, de même la signification lexicale, et même les significations pures, reconstruites à dessein, comme celles de la géométrie, visent un univers d’être brut et de coexistence auquel nous étions déjà jetés quand nous avons parlé et pensé et qui, lui, par principe, n’admet pas la démarche d’approximation objectivante ou réflexive, puisqu’il est à distance, en horizon, latent ou dissimulé. C’est lui que la philosophie vise, qui est, comme on dit, l’objet de la philosophie ‑ mais ici la lacune ne sera.jamais comblée, l’inconnue transformée en connu, l' »objet » de la philosophie ne viendra jamais remplir la question philosophique, puisque cette obturation lui ôterait la profondeur et la distance qui lui sont essentielles. L’être effectif, présent, ultime et premier, la chose même, sont par principe saisis par transparence travers leurs perspectives, ne s’offrent donc qu’à quelqu’un qui veut, non les avoir, mais les voir, non les tenir comme entre des pinces, ou les immobiliser comme sous l’objectif d’un microscope, mais les laisser être et assister à leur être continué, qui donc se borne à leur rendre le creux, l’espace libre qu’ils redemandent, la résonance qu’ils exigent, qui suit leur propre mouvement, qui donc est, non pas un néant que l’être plein viendrait obturer, mais question accordée à l’être poreux qu’elle questionne et de qui elle n’obtient pas réponse, mais confirmation de son étonnement. Il faut comprendre la perception comme cette pensée interrogative qui laisse être le monde perçu plutôt qu’elle ne le pose, devant qui les choses se font et se défont dans une sorte de glissement, en deçà du oui et du non.
Notre discussion sur le négatif nous annonce un autre paradoxe de la philosophie, qui la distingue de tout problème de connaissance et interdit qu’on parle en philosophie de solution: approche du lointain comme lointain, elle est aussi question posée à ce qui ne parle pas. Elle demande à notre expérience du monde ce qu’est le monde avant qu’il soit chose dont on parle et qui va de soi, avant qu’il ait été réduit en un ensemble de significations maniables, disponibles; elle pose cette question à notre vie muette, elle s’adresse à ce mélange du monde et de nous qui précède la réflexion parce que l’examen des significations en elles‑mêmes nous donnerait le monde réduit à nos idéalisations et à notre syntaxe. Mais, par ailleurs, ce qu’elle trouve en revenant ainsi aux sources, elle le dit. Elle est elle‑même une construction humaine, dont le philosophe sait bien, quel que soit son effort, que, dans le meilleur des cas, elle prendra place à titre d’échantillon parmi les artefacts et les produits de la culture. Si ce paradoxe n’est pas une impossibilité, et si la philosophie peut parler, c’est parce que le langage n’est pas seulement le conservatoire des significations fixées et acquises, parce que son pouvoir cumulatif résulte lui‑même d’un pouvoir d’anticipation ou de prépossession, parce qu’on ne parle pas seulement de ce qu’on sait, comme pour en faire étalage, – mais aussi de ce qu’on ne sait pas pour le savoir -, et que lelangage ce faisant exprime, au moins latéralement, une ontogénèse dont il fait partie. Mais il résulte de là que les paroles les plus chargées de philosophie ne sont pas nécessairement celles qui enferment ce qu’elles disent, ce sont plutôt celles qui ouvrent le plus énergiquement sur l’être, parce qu’elles rendent plus étroitement la vie du tout et font vibrer jusqu’à les disjoindre nos évidences habituelles.
Texte 12 : Edmond Jabès, Le livre du Dialogue, Paris : Gallimard, 1984 p.9, 17, 37, 64–67.
L’interrogation ne débouche pas sur le dialogue: elle en est l’avant‑mont.
(…)
À la question soulevée : « Y a‑t‑il un dialogue et comment peut‑il s’établir entre deux étrangers? », il répondit: « 11 y aurait un avant‑dialogue qui serait notre lente ou fébrile préparation au dialogue. Nous ignorons, sans doute, comment il se déroulera ni quelle forme il prendra, mais sans pouvoir, cependant, l’expliciter nous avons d’avance la conviction que celui‑ci s’est, déjà, engagé : dialogue silencieux avec un interlocuteur absent.
Il y aurait, ensuite, un après‑dialogue ‑ ou après‑silence. Ce que nous aurions pu dire à l’autre, au cours de notre échange de paroles ‑ qui est, plutôt, un apprentissage de paroles ‑ ne disant virtuellement que ce silence; silence auquel nous renvoie toute parole insondable, creuse, en vain creusée, centrée sur elle‑même.
(…)
« Lorsque nous lançons une balle contre un mur, que se passe‑t‑il? Le mur nous la renvoie; mais le geste de ramasser la balle et de la relancer ensuite, selon les règles du jeu, varie. Nous passons de l’aisance à la difficulté, de l’acharnement à la mollesse sans l’avoir, au préalable, recherché. Ainsi en est‑il du dialogue», disait‑il.
Le cœur du dialogue est empli des battements de la question. Il y aurait deux silences en chaque silence, comme il y a deux paroles en chacune.
Si ma question appelle, de ta part, une réponse; celle‑ci pourrait‑elle prétendre, à elle seule, avoir épuisé la question? Si ta réponse appelle, de ma part, une question; celle‑ci pourrait‑elle prétendre, à elle seule, s’être débarrassée de la réponse?
Tout se passe comme si la réponse mourait de la question introduite et la question, de la mort prématurée de la réponse. « On n’interroge que le néant », avait‑il noté. La question est la plus longue mort : elle est la vie.
(…)
LA QUESTION
Juive est la question qui, indéfiniment, se questionne dans la réponse qu’elle provoque.
(…)
Il disait que lorsqu’on se pose une question on est, d’une certaine manière, juif parce que le juif s’est déjà, plus d’une fois, posé la même question.
Il disait que lorsque, à la place de la question que l’on voulait se poser, on s’en pose une autre afin de pouvoir ensuite indirectement, à travers celle‑ci, se poser la première, C’est être aussi juif que peut l’être un juif.
Il disait que lorsqu’on n’a plus la force ni la volonté de se poser des questions, aspirant à jouir d’un repos bien mérité, on est encore juif parce que cela prouve que l’on a, autant que lui, tremblé avec la question.
(…)
La différence entre nous, disait‑il, est la suivante: Tu crois fermement en une vérité reconnue, alors que celle qui me fascine ne s’est jamais souciée de reconnaissance.
Exercices
- Lequel des deux principes Descartes utilise-t-il particulièrement dans le texte 8 ? Tentez de faire un commentaire composé de ce texte (cherchez la/les questions implicites, cherchez les transformations problématologiques, analysez les différents thèmes c’est-à-dire décomposez le texte selon ces thèmes, montrez bien l’intérêt de chacun d’eux, et recomposez ces thèmes dans l’ordre d’exposition que vous préférez. Laissez votre pensée et votre compréhension du texte vous suggérer le plan. Et amusez-vous !)
- Texte 9 : pourquoi un érudit peut-il être borné ?
- Kierkegaard dans le texte 10 pose la question de la différence entre les contemporains et les disciples de seconde main. En quoi cela concerne-t-il le principe de différence problématique ? Et quelle solution propose-t-il ?
- Relisez ces textes sans crayon, pour le plaisir (jusqu’à ce que ce soit un plaisir —ce qui implique de ne pas chercher tout de suite à tout comprendre : ni forcer la clarté de la compréhension, ni renoncer tout de suite face à la difficulté).
Seconds éléments.
Le langage de la question
Le jeu des questions et des réponses apparaît dans les conversations les plus simples, et situe les phrases ou les discours dans un contexte d’interlocution où les questions demandent et commandent, font faire. C’est cette fonction pratique du questionnement dans la communication que l’on peut nommer « pragmatique » (et qui prolongent les remarques de la leçon 2). Le travail du dialogue permet la production d’un langage commun, d’un réel commun. Et le pouvoir partagé de questionner est une condition de possibilité pour la communication, peut–être la première règle pour une éthique de la communication.
Leçon 4 La pluralité pragmatique du langage ordinaire, et de ses fonctions
La pragmatique brise la prétention de la logique classique (l’Organon d’Aristote, outil) ou néopositiviste à régler l’ensemble du langage humain. L.Wittgenstein explore la pluralité de ce qu’il appelle les « jeux de langage »: il y a différentes manières de jouer au langage, avec différentes règles. J.L. Austin, dans sa théorie des « speech–acts », distingue entre l’acte locutoire de dire quelque chose (qui a un sens), l’acte illocutoire effectué en disant quelque chose (qui a une force: de commandement, d’excuse, de démonstration, de promesse…), et l’acte perlocutoire de faire faire quelque chose (qui dépend aussi —et tente de tenir compte— de la manière dont l’interlocuteur reçoit ce que je dis). Voir le magnifique exemple de la lecture pragmatique des « Commentaires » bibliques de Calvin par Gilbert Vincent[13].
Ce n’est plus seulement l’organisation interne du message qui intéresse (code sémiotique), ni même son contenu descriptif (référence sémantique), mais son insertion dans un contexte, son utilisation par des locuteurs. Le sens d’un mot ou d’une phrase, c’est d’abord son usage. Le sens d’un énoncé c’est la réponse à la question de son sens, et cette réponse peut varier pour le même énoncé : le même énoncé peut avoir beaucoup d’usages. En reprenant une page de Tintin (le Temple du Soleil, p.7), nous allons étudier successivement quelques fonctions pragmatiques du questionnement.
4.1) Fonction métalinguistique
On parle de fonction métalinguistique lorsque, dans le langage, il est question du langage: c’est le moment où l’on se dit que l’on ne parle peut–être pas de la même chose. C’est ce qu’on trouve dans Le temple du soleil, image n°3, où Dupont demande au capitaine Haddock si le signal de la quarantaine veut dire que l’on fête l’âge du capitaine: on a une proposition de réponse, et la réponse de Haddock est une autre proposition de réponse à la même question. La question permet de passer d’une réponse à une autre, et on peut même définir une réponse comme une expression de la question, et définir une question par la classe de ses réponses possibles (une classe d’expressions). Quand une question est entièrement formulée elle est d’ailleurs souvent résolue.
Comprendre, c’est saisir le sens d’un terme ou d’une expression dans un contexte donné. Et dans un contexte donné l’univocité d’un mot est produite par le jeu des questions et des réponses. En effet « la polysémie des mots appelle pour contrepartie le rôle sélectif des contextes », remarque Ricoeur[14], et le maniement des contextes s’exerce dans un jeu de la question et de la réponse, seul capable de produire l’univocité relative à une situation donnée. Par le jeu des questions et des réponses, il se produit quelque chose comme une travail du concept: « un concept, c’est toujours un ensemble de questions qui ne se posent plus, donc d’individus qui en sont tributaires, que l’on regroupe indifféremment comme X, et de réponses que l’on ne met plus sur la table, c’est à dire de traits et de propriétés diverses dont on fait l’économie »[15]. Le sujet et le prédicat, en ce sens, arrêtent l’interrogation qui pourrait courir en tous sens, et placent hors-question ce qui entraînerait trop loin de ce qui n’est proprement en question. La polysémie des mots appelle donc le rôle sélectif des contextes, et dans un contexte donné cette sélection s’opère par le jeu du questionnement.
Cf. Hergé, Tintin, Le temple du soleil p. 7
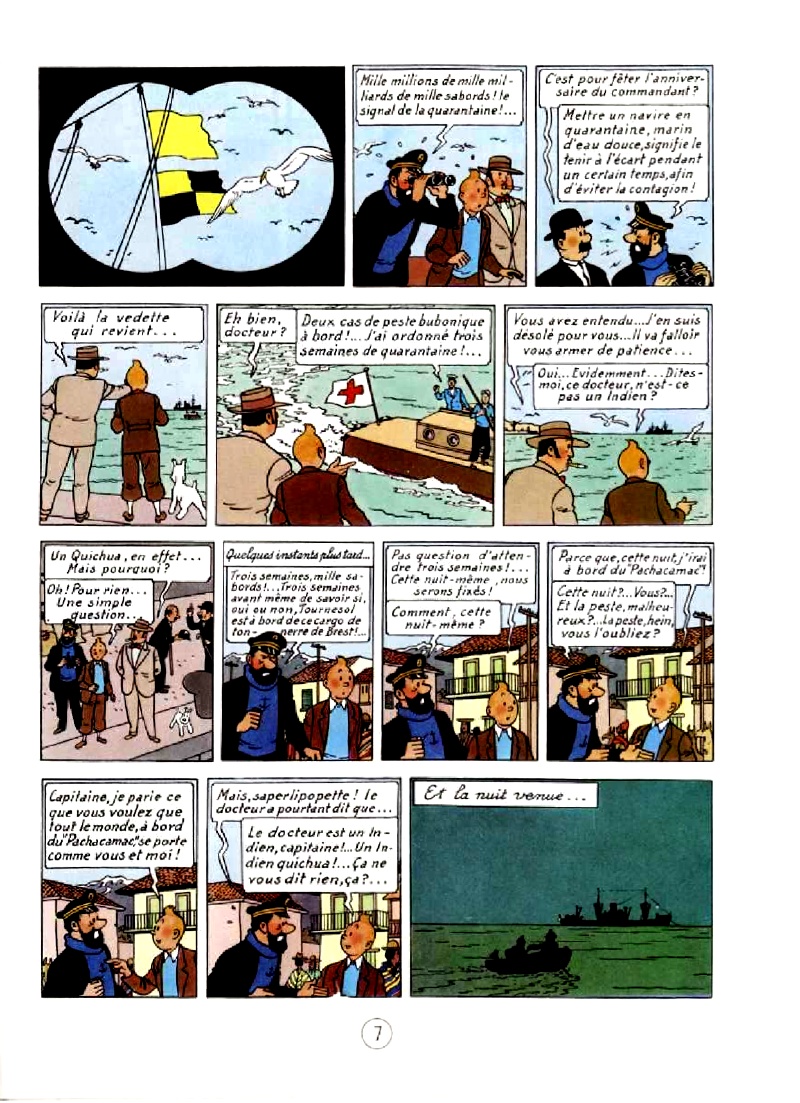
4.2) Fonction référentielle
Le logicien Hintikka a montré le rôle de la question dans la construction de la référence, à partir des résultats de Frege et de Wittgenstein: une proposition p décrit un monde possible, et le monde réel est un monde parmi d’autres mondes, celui où la proposition est vérifiée. Dans un monde possible, p est vraie, ou bien non–p est vraie, et il n’y a pas de monde possible dans lequel p et non–p soient vraies ensemble (principe de non–contradiction). Si deux propositions ne sont pas contradictoires, alors elles sont compatibles dans le même monde, elles sont « compossibles ». La fonction « vainqueur d’Austerlitz » est un descriptif possible de X, tel que f(X). Mais pour le même X (Napoléon), d’autres descriptifs (moins glorieux !) restent possibles: un individu est un X que l’on retrouve dans plusieurs mondes possibles. La référence répond ainsi toujours à une question possible du genre « Qui », « Quoi » (cf. Le temple du soleil, images n°5, 6 et 7).
Le rôle des interrogatifs est un rôle de « quantificateur », de sélectionneur individualisant: la référence est « produite » au cours du dialogue, par le travail de l’interrogation. Il ne faut donc pas sous estimer le caractère dialogal de la référence : nous avons besoin de l’écart entre plusieurs références, et de tenir ouverte la possibilité d’un écart inédit. Nous avons besoin d’interlocuteurs pour réidentifier autrement notre référent, le tenir sous d’autres profils ou dans d’autres mondes, et ce sont eux qui « exposent le tissu de nos croyances à une perpétuelle recomposition »[16].
4.3) Fonctions illocutoires, et rhétorique de la question
La question a la propriété d’être un message capable de produire un autre message, éventuellement mental. On le voit dans Le temple du soleil avec l’image n°12, la question fait se dire (au capitaine Haddock que le docteur a menti); elle fait se taire aussi parfois (image n°7); le plus souvent elle fait parler (image n°5: « eh bien, docteur? »); ou simplement elle fait faire. Nous avons rencontré aussi une fonction rhétorique de la question, qui permet de suggérer une proposition sans la dire, afin que l’interlocuteur ne puisse pas la problématiser. On peut dire que la question ouvre un espace verbal d’échange, de communication, qu’elle appelle, qu’elle demande. Mais il ne faut pas oublier que ce faisant elle enclôt cet espace. La question impose aux interlocuteurs l’obligation de répondre, et de répondre à la question, c’est à dire à l’intérieur d’un champ de présuppositions implicites. Devant la question : « Monsieur a–t–il cessé de battre sa femme ? » il serait logique (quoique imprudent dans certains contextes) de répondre « non », car répondre « oui » reviendrait à accepter le présupposé selon lequel il fut un temps où l’on battait sa femme!
C’est ainsi que le premier journaliste qui couvre une affaire en donne la problématique, l’angle d’attaque, dont il sera ensuite bien difficile de sortir. On peut alors imaginer que la question tente d’ébranler les présupposés et de rouvrir la problématique qui domine le débat ou l’esprit de l’interlocuteur. Il est des cas en effet où l’argumentation, laissant en place les prémisses admises, ne sert à rien. La question opère alors comme une fiction, qui élargit la perception et bouleverse les arrières-pensées. Le critique littéraire Northrop Frye écrit ainsi du véritable rapport interrogatif que le maître entretient avec l’élève qu’
« il brise les forces répressives de son esprit qui l’empêchent de savoir ce qu’il sait. C’est pourquoi ce n’est pas l’élève mais le maître qui pose la plupart des questions (…) Répondre à une question revient à consolider le niveau mental sur lequel la question est posée »[17].
On voit donc la gamme largement ouverte des usages rhétoriques de la question. Il y a des questions qui demandent que celui qui réponde réponde par un acte: ce sont en quelque sorte des questions impératives. Il y a des questions qui supposent que tout le monde connaît la bonne réponse: ce sont des questions rhétoriques, au sens classique, elles permettent de marquer un territoire rhétorique et visent à obtenir l’assentiment de l’auditoire entier. Il y a des questions qui supposent que celui qui pose la question connaît la bonne réponse (en ce sens une question pédagogique est toujours une question « dogmatique »). Il y a des questions qui supposent que celui à qui la question est posée sait la bonne réponse: ce sont des questions informatives, qui visent à savoir. Il y a enfin des questions qui supposent que personne ne connaît la bonne réponse: on pourrait les appeler des questions « pures », mais elles visent parfois à mettre en doute un prétendu savoir, à remettre tout le monde à équidistance de la question. Loin de vouloir des réponses toutes prêtes, une question demande d’abord à être questionnée (à être demandée): c’est la forme de la demande, elle veut être portée à sa plus haute valeur, juste avant la dernière réponse ; elle s’arrête d’ailleurs juste après la dernière réponse possible, là où sa valeur est nulle !
_______________
Textes & Exercices 4 :
Inventez trois petits dialogues illustrant ces trois fonctions de l’interrogation.
- Lisez le texte de Leibniz portant sur les « mondes possibles » et comparez la compossibilité métaphysique de Leibniz et la compossibilité langagière ici présentée.
- Allez chercher dans un bon dictionnaire ou une encyclopédie la présentation de Spinoza et comparez avec la métaphysique de Leibniz
Commentez le texte de N.Frye.
Texte 13 : John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, Paris Seuil 1970, p.(6)41-(10)44.
« Exemples : (Ea) « oui je le veux (c’est à dire je prends cette femme comme épouse légitime) » —ce oui étant prononcé lors de la cérémonie du mariage. (Eb) « je baptise ce bateau le Quenn Elisabeth » —comme on dit lorsqu’on brise une bouteille sur la coque. (Ec) « Je donne et lègue ma montre à mon frère » —comme on peut lire dans un testament. (Ed) « Je vous parie six pence qu’il pleuvra demain » Pour ces exemples il semble clair qu’énoncer la phrase (dans les circonstances appropriées, évidemment), ce n’est ni décrire ce qu’il faut bien reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le fais : c’est le faire. Aucune des énonciations citées n’est vraie ou fausse.
(…) Notre parole, c’est notre engagement.
(…) Supposez par exemple que j’aperçoive un bateau dans une cale de construction, que j’en approche et brise la bouteille suspendue à la coque, que je proclame « je baptise ce bateau le Joseph Staline » et que, pour être bien sûr de mon affaire, d’un coup de pied je fasse sauter les cales. L’ennui, c’est que je n’étais pas la personne désignée pour procéder au baptême »
Texte 14 : Gottfried Wilhem Leibniz, La Monadologie, Paris : Delagrave 1975, p.170 sq., prop.53 à 60, 61.
52. Et c’est par là qu’entre les créatures les actions et passions sont mutuelles. Car Dieu comparant deux substances simples, trouve en chacune des raisons, qui l’obligent à y accommoder l’autre; et par conséquent ce qui est actif à certains égards est passif suivant un autre point de considération : actif en tant, que ce qu’on donnait distinctement en lui, sert à rendre raison de ce qui se passe dans un autre; et passif en tant que la raison de ce qui se passe en lui, se trouve dans ce qui se connaît distinctement dans un autre.
53. Or, comme il y a une infinité d’univers possibles dans les idées de Dieu et qu’il n’en peut exister qu’un seul, il faut qu’il y ait une raison suffisante du choix de Dieu, qui le détermina à l’un plutôt qu’à l’autre.
54. Et, cette raison ne peut se trouver que dans la convenance, ou dans les degrés de perfection, que, ces mondes contiennent; chaque possible ayant droit de prétendre à l’existence à mesure de la perfection qu’il enveloppe.
55. Et c’est ce qui est la cause de l’existence du meilleur, que la sagesse fait connaître, à Dieu, que sa bonté le fait choisir, et que sa puissance le fait produire.
56. Or cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et de chacune à toutes les autres, fait que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres, et qu’elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l’univers.
57. Et, comme une même ville regardée de différents côtés paraît toute autre, et est comme multipliée perspectivement,; il arrive de même, que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d’un seul selon les différents points de vue de chaque Monade.
68. Et c’est le moyen d’obtenir autant de variété qu’il est possible, mais avec le plus grand ordre, qui se puisse, c’est-à-dire, c’est le moyen d’obtenir autant de perfection qu’il se peut.
59. Aussi n’est-ce que cette hypothèse (que j’ose dire démontrée) qui relève comme il faut la grandeur de Dieu : c’est ce que Monsieur Bayle reconnut, lorsque dans son Dictionnaire (article, Rorarius) il y fit des objections, où même il fut tenté de croire, que je donnais trop à Dieu, et plus qu’il n’est possible. Mais il ne put alléguer aucune raison, pourquoi cette harmonie universelle, qui fait que toute substance exprime exactement toutes les autres par les rapports qu’elle y a, fût impossible.
60. On voit d’ailleurs dans ce que je viens de rapporter, les raisons a priori pourquoi les choses ne sauraient aller autrement. Parce que Dieu en réglant le tout a eu égard à chaque partie, et particulièrement à chaque monade, dont la nature étant représentative, rien ne la saurait borner à ne représenter qu’une partie des choses; quoiqu’il soit vrai que cette représentation n’est que confuse dans le détail de tout l’univers, et ne peut être distincte que dans une petite partie des choses, c’est-à-dire, dans celles qui sont ou les plus prochaines, ou les plus grandes par rapport à chacune des Monades; autrement chaque monade serait une Divinité. Ce n’est pas dans l’objet, mais dans la modification de la connaissance de l’objet, que les monades sont bornées. Elles vont toutes confusément à l’infini, au tout; mais elles sont limitées et distinguées par les degrés des perceptions distinctes.
61. (…) Chaque corps est affecté non seulement par ceux qui le touchent, et se ressent de quelque façon de tout ce qui leur arrive, mais aussi par leur moyen se ressent de ceux qui touchent les premiers, dont il est touché immédiatement: il s’ensuit que cette communication va à quelque distance que ce soit. Et par conséquent tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l’univers; tellement que celui qui voit tout, pourrait lire dans chacun ce qui se fait partout, et même ce qui s’est fait ou se fera; en remarquant dans le présent ce qui est éloigné, tant selon les temps que selon les lieux: sumpnoia panta[18], disait Hippocrate. Mais une âme ne peut lire en elle-même que ce qui y est représenté distinctement, elle ne saurait développer tout d’un coup tous ses replis, car ils vont à l’infini ».
Texte 15 : Northrop Frye, Le grand code, La Bible et la littérature, Paris : Seuil 1984, p.27-28.
Le maître, comme on l’a reconnu au moins depuis le Ménon de Platon, n’est pas primordialement quelqu’un qui sait, enseignant à quelqu’un qui ne sait pas. Il est plutôt quelqu’un qui tente de recréer le sujet dans l’esprit de l’élève, et pour cela sa stratégie consiste avant tout à faire reconnaître à l’élève ce qu’il sait déjà potentiellement; cela comporte le fait qu’il brise les forces répressives de son esprit qui l’empêchent de savoir ce qu’il sait. C’est pourquoi ce n’est pas l’élève, mais le maître, qui pose la plupart des questions. Dans mes propres livres, l’élément professoral a été la cause d’une certaine mauvaise humeur chez mes lecteurs, souvent due à leur loyauté envers d’autres maîtres. Cela n’est pas sans rapport avec l’impression que je leur ai donnée d’être délibérément évasif, principalement parce que je ne me refuse pas à utiliser l’ironie que tous les maîtres depuis Socrate ont trouvée essentielle. Mais il n’y a pas que dans ce caractère évasif. Les paraboles de Jésus étaient elles-mêmes des ainoi , des fables ayant un caractère de devinettes. Dans d’autres domaines, comme le bouddhisme zen, le maître est souvent un homme qui montre sa capacité à enseigner en refusant de répondre à des questions, ou en les écartant avec un paradoxe. Répondre à une question (c’est un point sur lequel nous reviendrons plus loin dans ce livre) revient à consolider le niveau mental sur lequel la question est posée. À moins de garder en réserve quelque chose qui fait penser que des questions meilleures, plus pleines, sont possibles, le progrès mental de l’élève est bloqué.
Leçon 5
Rhétorique et éthique de la communication
Communiquez! C’est l’impératif technique ou divertissant qui « manage » notre société. Qu’il nous soit permis de lever quelques questions… La communication la plus ordinaire suppose en effet déjà l’existence d’un code commun; l’existence d’un référent vers « quoi » on puisse éventuellement se tourner; l’existence enfin d’interlocuteurs en présence. Il arrive toutefois que la communication ordinaire soit mise en échec. Dans les termes de Wittgenstein, on ne partage pas le même « jeu de langage », on ne parle pas de la même chose. Et ce qui avait été un langage commun peut ainsi se problématiser et se désintégrer. On doit alors accepter l’échec de la communication première: la violence, c’est de refuser cet échec, et de « forcer » la communication. Et la communication suppose d’accepter que nos interlocuteurs répondent non seulement de manière très éloignée à nos questions, mais à des questions qui sont très éloignées des nôtres.
5.1) Rhétorique et désaccord
C’est justement à cela que servent les figures, et la rhétorique entière. À entraver le conflit, la guerre civile, le déchirement de ceux qui ne supportent pas de trop se ressembler comme celui de ceux qui ne supportent pas d’être si différents. À entraver le désir de différence et de séparation en montrant ce qu’il y a de commun, en faisant voir le semblable dans le différent. À entraver le désir d’unanimité, d’identité enthousiaste, conformiste ou apeurée, en montrant ce qui diffère, en faisant voir la distance dans la proximité. Les deux tendances au conflit sont d’ailleurs concomitantes. Les figures de la rhétorique sont là pour les intriguer, les retarder, pour leur faire des chicanes, pour mettre des écrans qui compliquent la représentation, font voir le conflit où l’on ne voit que consensus, et la ressemblance où l’on ne voit que division. Elles augmentent la capacité à supporter l’un et l’autre. La figurativité du langage permet en effet à une proposition de prendre sens dans deux configurations différentes, d’être interprétée différemment. Elle constitue ainsi une sorte de compromis, de boîte noire, où la communication est maintenue dans l’écart même entre les points de vue en présence, et qui ne se comprennent pas forcément très bien l’une l’autre. On pourrait dire ainsi que la rhétorique cherche à penser le langage comme l’institution du compromis en dépit du différend et du conflit; qu’elle doit penser la conflictualité dans le langage; qu’il s’agit d’un conflit entre des égaux qui doivent négocier leur différence, la découvrir ensemble. Toute la rhétorique tient à la négociation du jeu ente cette distance, ces différences, et la ressemblance, les proximités :
« Les hommes négocient la distance entre eux en évaluant ce qui les sépare ou les rapproche sur un sujet donné. Ce sujet, qui est la matière dont ils débattent, peut être présenté directement, littéralement, mais cela ne laisse place qu’à l’alternative brutale du désaccord ou de l’adhésion pure et simple. Plus subtile est l’expression détournée de la solution; détournée, en grec, se dirait tropologique. Un trope, ou figure de style, est un détournement de sens »[19].
On peut comparer ce texte à celui-ci, qui porte sur la philosophie du droit :
« C’est cette juste distance entre les partenaires affrontés, trop près dans le conflit et trop éloignés l’un de l’autre dans l’ignorance, la haine ou le mépris, qui résume assez bien, je crois, les deux aspects de l’acte de juger: d’un côté trancher, mettre fin à l’incertitude, séparer les parties; de l’autre, faire reconnaître par chacun la part que l’autre prend à la même société que lui »[20].
5.2) Le travail de la communication
Ainsi, loin que l’on puisse assimiler la communication à un simple et identique échange où tout serait toujours et de plus en plus équivalent, il y a dans la communication vive un travail. C’est le travail de la question que de produire un code commun, que de construire la commune référence, que d’engendrer une intersubjectivité. Ce n’est pas parce que, au niveau de la communication première, nous ne partageons pas la même question, tous les mêmes implicites, que nous ne nous comprendrons jamais; le travail du dialogue peut engendrer une neuve question, qui nous sera commune.
Tel est le pouvoir de la question. On pourrait dire, en prolongeant les travaux de K.O.Appel et Habermas, que le « consensus » est produit en dépit de la plurivocité de départ, par le travail de l’interrogation; mais aussi que le « pluralisme » est produit en dépit de l’uniformité de départ, par ce même travail. Le questionnement travaille entre les deux situations limites du consensus et du différend, dont il opère le mixte. En ce sens, c’est le pouvoir partagé de questionner qui fait fonction de « transcendantal », de condition de possibilité, pour la communication. Une communauté peut être définie comme l’ensemble de ceux qui partagent la ou les mêmes questions. Et la logique de l’excommunication est celle par laquelle une communauté exclut ceux qui ne partagent plus sa question.
La communauté aurait donc avantage à être définie comme l’ensemble de ceux qui partagent la ou les mêmes questions. Une telle communauté peut apporter à cette question des réponses différentes, éventuellement exclusives. Ces diverses réponses sont intelligibles entre elles, dès lors qu’elles reviennent à la commune question. Ce qui est placé au centre de la communauté ce n’est pas une réponse, ni une synthèse de réponses, c’est la question. Et une communauté peut être rassemblée par une interrogation vive et neuve. C’est elle qui nous rend « contemporains« . C’est par elle que nous nous trouvons les uns les autres animés de la même problématique, dans un partage qui, si partiel soit-il, n’en est pas moins la base du vivre-ensemble. On s’aperçoit ainsi rassurés que le dialogue ne se perd pas toujours dans l’infini des malentendus, que l’on peut faire le tour d’une question, et qu’au bout d’un certain temps de travail de l’interrogation on repasse sur les mêmes endroits. Les chemins de la pensée ne sont pas infinis, et il est un point où nous butons tous, dans des langage éventuellement différents, sur les mêmes problèmes. Et on comprend alors que des personnes par des chemins si différents puissent soudain découvrir, étonnés, qu’ils avaient en même temps la même question.
_______________
Textes & Exercices 5 :
Texte 16 : Ludwig Wittgenstein, Leçons et conversations, Paris Gallimard 1971, p.107-115.
« Supposez un croyant qui dise: « je crois en un jugement dernier », et que je dise: « eh bien je n’en suis pas si sûr. C’est possible ». Vous diriez qu’il y a un abîme entre nous. S’il disait: « il y a un avion allemand en l’air » et que je dise: « C’est possible. Je n’en suis pas si sûr, vous diriez que nous sommes assez proches l’un de l’autre. En disant: « Wittgenstein, vous avez dans l’esprit quelque chose de complètement différent », vous pourriez exprimer par là non pas le fait que je sois plus ou moins proche de lui, mais que je me meus sur un plan complètement différent (…) Supposez un homme qui se donnerait pour cette vie la règle de conduite suivante: croire au jugement dernier (…) ce qu’il a c’est ce que vous pourriez appeler une croyance inébranlable. Cela ressortira non pas d’un raisonnement ou d’une référence aux raisons habituelles que l’on invoque à l’appui d’une croyance, mais bien plutôt que tout dans sa vie obéit à la règle de cette croyance (…) Vous diriez qu’il raisonnent faux dans le cas où ils raisonneraient d’une manière semblable à la nôtre et qui feraient pour nous ce qui correspond à une faute. Que quelque chose soit ou non une faute -c’est une faute dans un système particulier. Exactement comme tel coup est une faute dans un jeu particulier et non dans un autre ».
Texte 17 : Jean-Pierre.Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris Maspéro 1981, t.1 p.185–186 (texte ici transcrit sans les termes grecs)
Reprenant, après G. Vlastos et Ch. H. Kahn, l’étude de la cosmologie d’Anaximandre dans ses rapports avec la pensée politique, nous avons, dans divers travaux, souligné la parenté entre la conception géométrique de l’univers, qui s’affirme pour la première fois chez ce philosophe, et l’organisation, dans le cadre de la cité, d’un espace dont le Foyer commun, établi sur l’agora, constitue comme le centre. Ce qui caractérise en effet l’espace de la cité c’est qu’il apparaît organisé autour d’un centre. Par les significations politiques qui lui sont attribuées, ce centre revêt une importance exceptionnelle. D’une part il s’oppose, en tant que centre, à tout le reste de l’espace civique ; d’autre part il ordonne autour de lui cet espace, chaque position particulière se définissant à partir de lui et par rapport à lui. (…) Le meson, le milieu, définit donc, par opposition à ce qui est privé, particulier, le domaine du commun, du public. Si différents que soient, par la résidence, la famille, la richesse, les citoyens ou plutôt les maisons qui composent une cité, ils forment, par leur participation commune à ce centre unique, une communauté politique. Davantage, en dépit de leur diversité, voire de leurs oppositions, ils se trouvent définis par leur rapport à ce centre comme des égaux, des semblables. Symétriquement organisé autour d’un centre, l’espace politique, au lieu de former comme dans les monarchies orientales une pyramide dominée par le roi avec, du haut en bas, une hiérarchie de pouvoirs, de prérogatives et de fonctions, se dessine suivant un schéma géométrisé de relations réversibles, dont l’ordre se fonde sur l’équilibre et la réciprocité entre égaux. Déposer le pouvoir au centre, c’est arracher le privilège de la suprématie à tout individu particulier, pour que nul ne domine plus personne. Fixé au centre, le cratos échappe à l’appropriation pour devenir commun à tous les membres de la collectivité. Chacun commande et obéit, à soi et aux autres tout à la fois. Pour les citoyens d’une cité c’est une seule et même chose de déposer le cratos au centre et de s’affirmer libres de toute domination.
Hérodote raconte que, vers les années 510, à Samos, Maiandrios tenait en mains le pouvoir, qu’il avait reçu de Polycrate, Cependant, à la mort de ce dernier, Maiandrios fait élever un autel à Zeus Eleutherios, Zeus Libérateur, et convoque en assemblée tous les citoyens pour leur dire : « C’est à moi, vous le savez, qu’ont été confiés le sceptre et toute la puissance de Polycrate… Mais Polycrate n’avait pas mon approbation quand il dominait en maître des hommes qui étaient ses semblables. Je dépose donc le pouvoir au milieu et je proclame pour vous l’isonornie.
Texte 18 : Augustin, Les Confessions, Paris G.Flammarion, Livre 11 chap.14 et 29.
Qu’est‑ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais; mais si on me le demande et que le veuille l’expliquer je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n’y aurait pas. de temps passé; que si rien n’arrivait, il n’y aurait pas de temps à venir; que si rien n’était, il n’y aurait pas de temps présent.
Comment donc, ces deux temps, le passé et l’avenir, sont‑ils, puisque le passé n’est plus et que l’avenir, n’est pas encore? Quant au présent, s’il était toujours présent, s’il n’allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons‑nous déclarer qu’il est aussi, lui qui ne peur être qu’en cessant d’être? Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c’est qu’il tend à n’être plus. (…)
Maintenant « mes années s’écoulent dans les gémissements », et vous, ma consolation, ô Seigneur, mon Père, vous êtes éternel. Mais moi, je me suis éparpillé dans le temps, dont j’ignore l’ordre; de tumultueuses vicissitudes déchirent mes pensées et les profondes entrailles de mon Âme, jusqu’au jour où je m’écoulerai en vous, purifié et fondu au feu de votre amour.
Texte 19 : Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris PUF, p.392 sq.
Une morale non fondée en raison, celle qui consiste à « faire la morale aux gens » ne peut avoir d’action, parce qu’elle ne donne pas de motifs. D’autre part, une morale qui en donne ne peut agir qu’en se servant de l’égoïsme : or, ce qui sort d’une pareille source n’a aucune valeur morale. D’où il suit qu’on ne peut attendre de la morale, ni en général de la connaissance abstraite, la formation d’aucune vertu authentique ; Elle ne peut naître que de l’intuition, qui reconnaît en un étranger le même être qui réside en nous. (…)
Rappelons‑nous que, d’après nos recherches antérieures, à la vie est essentiellement et inséparablement unie la douleur ; que tout désir naît d’un besoin, d’un manque, d’une douleur ; que, par suite, la satisfaction n’est jamais qu’une souffrance évitée, et non un bonheur positif acquis ; que la joie ment au désir en lui faisant accroire qu’elle est un bien positif, car en vérité elle est de nature négative ; elle n’est que la fin d’un mal. Dès lors que faisons‑nous pour les autres, avec toute notre bonté, notre tendresse, notre générosité ? Nous adoucissons leurs souffrances. Qu’est‑ce donc qui peut nous inspirer de faire de bonnes actions, des actes de douceur? La connaissance de la souffrance d’autrui : nous la devinons d’après les nôtres, et nous l’égalons à celles‑ci. On le voit donc, la pure douceur (caritas) est, par nature même, de la pitié ; seulement la souffrance qu’elle s’efforce d’adoucir peut être tantôt grande et tantôt petite, elle peut n’être qu’un simple souhait déçu, Le concept seul est aussi impuissant à produire la vertu vraie qu’à créer le beau véritable ; toute douceur sincère et pure est pitié, et toute douceur qui n’est pas pitié n’est qu’amour de soi. Qu’est‑ce que l’amour, eros? De l’amour de soi. Qu’est‑ce que la douceur ? De la pitié. Certes les deux se mélangent souvent. Ainsi la vraie amitié est toujours un mélange d’amour de soi et de pitié : on reconnaît le premier élément au plaisir que nous donne la présence de l’ami, dont la personne correspond à la nôtre, ou plutôt dont la personne est la meilleure partie de la nôtre ; la pitié se montre par la part que nous prenons sincèrement à ce qui lui arrive de bien ou de mal, et aussi par les sacrifices désintéressés que nous lui faisons. Spinoza a dit en ce sens : « La bienveillance n’est qu’un désir né de la pitié.» À l’appui de notre paradoxe on peut encore invoquer ce fait, que dans le langage de la pure douceur, le ton, les paroles, les caresses sont tout à fait en harmonie avec ceux qui expriment la Pitié; et pour le dire en passant, en italien la pitié et la tendresse pure ont le même nom, pietà.
Troisièmes éléments.
S’orienter dans l’interprétation
L’exégèse des textes anciens nous enseigne que ces textes répondaient à d’autres questions que celles que nous nous posons; et l’historiographie des documents nous rend sensibles aux contextes et aux mondes dont ils sont issus: l’enquête historique recompose un questionnaire perdu plutôt qu’il ne compile des réponses. Mais l’herméneutique, c’est aussi l’interprétation du texte dans le monde ouvert par ce texte, sous la question posée par lui et qui diffère de celles auxquelles il répondait. Le texte ouvre des mondes possibles, des propositions de monde dont l’interprétation se déploie dans notre existence même.
L’herméneutique, théorie ou art de l’interprétation, a toujours affaire à des traces, à des traditions intentionnellement déposées dans des institutions, dans des oeuvres, faites pour durer, pour donner un cadre durable à l’apparition fugace des actes et des paroles, et pour assurer une transmission, une filiation. Mais elle a aussi affaire toujours à ce phénomène que les oeuvres et les traces du passé échappent à leurs intentions initiales et sont réempruntés, réinterprétés de manière inattendue, réaménagés différemment de génération en génération, comme si on redisposait à chaque fois la demeure autrement. Comme si chaque vie réinterprétait le palimpseste des interprétations antérieures. C’est le cas pour l’herméneutique des textes classiques ou canoniques (religieux), mais aussi pour l’herméneutique juridique, par exemple, qui ne peut réinterpréter le juste et suivre les traces des prédécesseurs qu’en ajoutant de nouvelles traces. L’herméneutique a donc intimement affaire à l’histoire, à la temporalité, à l’irréversibilité. Et on pourrait dire que l’herméneutique cherche à penser le langage comme l’institution de la transmission en dépit du décalage irréversible des générations. Comme l’écrit Ricoeur :
« En quel sens ce développement de toute compréhension en interprétation s’oppose-t-il au projet husserlien de fondation dernière? Essentiellement en ceci que toute interprétation place l’interprète in media res et jamais au commencement ou à la fin. Nous survenons, en quelque sorte, au beau milieu d’une conversation qui est déjà commencée et dans laquelle nous essayons de nous orienter afin de pouvoir à notre tour y apporter notre contribution »[21].
Leçon 6
Gadamer et la primauté herméneutique de la question.
Malgré un nom hermétique, l’herméneutique est une chose très simple, qui consiste en la théorie ou l’art de traduire, d’interpréter : un message, un rêve, un signe, un texte. Il faut au coup d’oeil herméneutique cette faculté d’interpréter les textes comme on interprète une carte géographique. Appelons donc cette faculté un « sens de l’interrogation », un sens de la différenciation des questions, la faculté pour un sujet d’imaginer d’autres points de vue possibles que le sien, d’autres questions. Cette différenciation des questions, si on se souvient que le sens d’un texte est fonction de la question implicite à laquelle il répond, se polarise entre deux directions opposées:
1) L’herméneutique sait la distance introduite dans la communication par les langages et par les temps, l’histoire (distance entre nos contextes et ceux auxquels répondaient ce texte).
2) L’herméneutique dit l’appartenance irréductible du sujet interprétant au monde qu’il interprète (appartenance du sujet interprétant à la même « question » que le texte interprété).
Si l’on parvient à maintenir la tension entre ces deux directions, on obtient une étonnante équation d’appartenance et de distance, qui est peut–être la « bonne distance » pour une véritable lecture. Le sujet herméneutique reconnaît modestement appartenir à une tradition, à un monde, et revendique fièrement l’exercice d’une critique universelle et sans entrave.
On peut ainsi distinguer d’une part 1) les méthodes herméneutiques développées par Schleiermacher (grammaire philologique comparée et congénialité psychologique) et Dilthey (expliquer et comprendre, notions de type idéal, de monde vécu), méthodes destinées à réparer le risque initial de mécompréhensions, et d’autre part 2) l’ontologie herméneutique développée par Heidegger. Ce dernier part de la découverte que le sujet se trouve dans un monde de la vie « toujours déjà » là (Husserl: lebenswelt). Cette structure de précompréhension permet d’élucider ce qui apparaît comme un échec dans la méthodologie des sciences de l’histoire ou de l’homme: le sujet est impliqué dans la connaissance de l’objet, et en retour il est déterminé à son insu par cet objet. Ce cercle vicieux de la méthode (énoncé en termes de sujet–objet), est en fait une structure ontologique indépassable du sujet comme appartenant à un monde : ce cercle herméneutique est constitutif de la compréhension, et une interprétation sans présupposition est impossible.
6.1) Vérité et méthode
Dans son ouvrage principal, intitulé Vérité et méthode, Hans–Georg Gadamer développe la primauté herméneutique de la question. Pour lui l’herméneutique concerne autant l’art du prédicateur ou du juge que la méthodologie des sciences humaines, et un traitement « méthodologique » introduit une distance aliénante qui ruine le rapport d’appartenance que nous avons avec la « vérité » en question[22]. Il le montre d’abord dans le domaine de l’art, où interpréter véritablement signifie « jouer », recréer, interpréter la création. Il le montre ensuite dans le domaine historique, où il raconte que c’est la lecture de Collingwood qui l’a conduit à considérer non seulement l’enquête historique comme un « questionnaire » (le comportement historique des individus et des sociétés pouvant être traité comme des réponses à des questions), mais de manière plus générale que l' »on ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question ». Cela peut paraître anachronique, mais dans le « classique » on éprouve le passé comme non passé, la question passée comme une question présente :
« Autrement dit, est classique, (…) ce qui dit au présent de chaque époque quelque chose qu’il ne semble dire qu’à lui seul. Ce qui s’appelle classique n’a pas besoin de vaincre d’abord la distance historique »[23].
Or il n’y a pas de méthode pour apprendre à questionner, et
« ce n’est pas dans la certitude méthodologique que la conscience herméneutique trouve son achèvement, mais dans la même disponibilité à l’expérience qui distingue l’homme expérimenté de l’homme emprisonné dans les dogmes »
6.2) Le dialogue platonicien
La véritable expérience, c’est l’ouverture à d’autres expériences possibles, autrement dit l’interrogation dont Socrate fut selon Platon le maître exigeant. La dialectique platonicienne consiste à dévoiler la chose dans toute sa problématicité, comme déjà Jan Patocka l’avait noté:
« Le mythe en général est dépourvu de problématicité car tout en lui est donné, achevé, tout a reçu une réponse; dans le mythe les réponses précèdent les questions. C’est dans la grande transformation qu’est la naissance de la philosophie, qui modifie du tout au tout la situation de notre existence, qu’émerge soudain la problématicité en tant que telle, notre propre problématicité, la problématicité du monde, l’absence de chemin, la question et la quête d’une réponse, quête qui s’adresse à nous–mêmes car, hormis nous et notre compréhension de ce qui se montre, il n’y a rien ni personne à qui nous puissions faire appel »[24].
En effet le mythe se trouve dans la présence du monde apparaissant, alors qu’interroger c’est se tourner vers l’absent, se tourner vers ce qui n’est pas là. Avec les mythes, les réponses précèdent toujours déjà les questions. Ce que Platon introduit de façon tout à fait unique, en osant inventer des mythes, c’est une sorte de jeu entre mythe et réflexion, entre tradition et critique[25].
Pour revenir à Gadamer, si Platon se méfie de l’écriture, c’est parce qu’elle ne répond pas aux questions: répondre, cela veut dire, dans l’entretien oral et infini, replacer les énoncés et les termes devant les questions. Comprendre un texte, cela exige de comprendre la question auquel le texte répond, et donc d’une certaine manière dépasser le texte: en effet la même question est susceptible de différentes réponses.
« Dans ses analyses inoubliables, Platon montre où réside la difficulté de savoir ce qu’on ne sait pas. C’est la puissance de l’opinion à laquelle il est si difficile de s’opposer pour arriver à s’avouer son ignorance. L’opinion, c’est ce qui réprime le besoin de questionner. Elle est animée d’une singulière tendance à la propagation (…) Comment donc peut-on en venir au besoin de questionner? (…) Nous voyons aussi comment Platon chercher à surmonter par la forme dialogale de la composition la faiblesse des logoï et en particulier celle des logoï écrits (…) Mais en se reportant en-deçà du texte, on l’a nécessairement dé-passé par la question adressée à la chose dite, on l’a nécessairement dépassé par sa question. En effet, on ne comprend le texte dans son sens qu’en acquérant l’horizon de la question qui, en tant que telle, englobe nécessairement d’autres réponses possibles »[26].
Comprendre un texte, cela exige aussi de le comprendre comme une réponse à une « vraie » question, à une question qui est aussi bien la nôtre. Les vraies questions dépassent les contextes particuliers, et l’acte par lequel nous venons dialoguer sous une question plus vaste que nos langages fait fusionner nos horizons historiques.
_______________
Textes & Exercices 6 :
Texte 20 : R.G. Collingwood, The idea of history, Oxford university press 1956, p.281.
It was a correct understanding of this truth that underlay Lord Acton’s great precept, ‘Study problems, not periods’. Scissors‑and‑paste historians study periods; they collect all the extant testimony about a certain limited group of events, and hope in vain that something will come of it. Scientific historians study problems: they ask questions, and if they are good historians they ask questions which they see their way to answering. It was a correct understanding of the same truth that led Monsieur Hercule Poirot to pour scorn on the ‘human bloodhound’ who crawls about the door trying to collect everything, no matter what, which might conceivably turn out to be a clue; and to insist that the secret of detection was to use what, with possibly wearisome iteration, he called ‘the little grey cells’. You can’t collect your evidence before you begin thinking, he meant: because thinking means asking questions (logicians, please note), and nothing is evidence except in relation to some definite question.
Texte 21 : Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main Suhrkamp Verlag 1979, p.49.
Es bedurfte dazu mannigfacher Hilfe. Die eine kam mir noch zur Zeit des zweiten Weltkriegs durch die Autobiographie von Collingwood, dem Schüler B. Croces und letzten Repräsentanten des englischen Hegelianismus. Dort fand ich, meisterhaft veranschaulicht an der Forschungserfahrung, die der große Entdecker der Limesführung im römischen Britannien gemacht hatte, als ‘logic of question and answer’ zum Prinzip erhoben, was mir aus meiner Praxis als Philologe und Interpret wohlvertraut war. Wie Collingwood den Verlauf des römischen Limes nicht durch den Zufall glücklicher Grabungsfunde aufgeklärt hatte, sondern durch die vorgängige Stellung und Beantwortung der Frage, wie eine solche Schutzanlage vernünftigerweise angelegt sein mußte, so wird auch der Umgang mit der philosophischen Oberlieferung nur sinnvoll, wenn sich die Vernunft in ihr wiedererkennt, das heißt ihr eigenes Fragen an sie richtet. Daß man einen Satz nur ‘versteht’, wenn man ihn als Antwort auf eine Frage versteht, ist von schlagender Evidenz.
Texte 22 : Martin Heidegger, Être et Temps, Paris Gallimard 1986, p.504-505.
La philosophie est l’ontologie phénoménologique universelle, issue de l’herméneutique du Dasein qui, en tant qu’analytique de l’existence, a fixé comme terme à la démarche de tout questionnement philosophique le point d’où il jaillit et celui auquel il remonte. Bien sûr, la thèse ne doit pas être érigée en dogme mais valoir comme formulation du problème fondamental encore largement « enfoui » : l’ontologie peut‑elle se justifier ontologiquement ou bien a‑t‑elle aussi besoin pour se justifier d’un soubassement ontique et à quel étant revient‑il d’assumer la fonction de la fondation?
Ce qui apparaît aussi évident que la différence entre l’être du Dasein existant et l’être de l’étant qui n’est pas de l’ordre du Dasein (l’être‑là‑devant par exemple) n’est cependant que le point de départ de la problématique ontologique, mais il n’y a rien là grâce à quoi la philosophie puisse se tranquilliser. Que l’ontologie antique travaille avec les « concepts de chose » et que subsiste le danger de « réduire la conscience à une chose », on le sait depuis longtemps. Cependant que signifie chosification? D’où sort‑elle? Pourquoi l’étant se « conçoit‑il justement « d’abord » à partir de l’étant là‑devant et non à partir de l’utilisable, alors que celui‑ci est tellement plus proche? Pourquoi cette chosification reprend‑elle toujours le dessus? Comment l’être de la « conscience » est‑il positivement structuré pour que la chosification reste incompatible avec lui? Suffit‑il donc de faire la «différence » entre « conscience » et « chose » pour avoir donné son développement original tout entier à la problématique ontologique? Les réponses à ces questions sont‑elles en vue? Et y a‑t‑ il seulement à chercher encore la réponse tant que la question du sens de être en général continue de n’être ni posée ni clarifiée?
Texte 23 : Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, Paris Seuil 1969, p.10 et 14.
Il y a deux manières de fonder l’herméneutique dans la phénoménologie. Il y a la voie courte, dont je parlerai d’abord, et la voie longue, celle que je proposerai de parcourir. La voie courte, c’est celle d’une ontologie de la compréhension, àla manière de Heidegger. J’appelle « voie courte » une telle ontologie de la compréhension, parce que, rompant avec les débats de méthode, elle se porte d’emblée au plan d’une ontologie de l’être fini, pour y retrouver le comprendre, non plus comme un mode de connaissance, mais comme un mode d’être. On n’entre pas peu à peu dans cette ontologie de la compréhension; on n’y accède pas par degré, en approfondissant les exigences méthodologiques de l’exégèse, de l’histoire ou de la psychanalyse: on s’y transporte par un soudain retournement de la problématique. A la question: àquelle condition un sujet connaissant peut‑il comprendre un texte, ou l’histoire? en substitue la question : qu’est‑ce qu’un être dont l’être consiste à comprendre? Le problème herméneutique devient ainsi une province de l’Analytique de cet être, le Dasein, qui existe en comprenant. (…)
Quelle que soit la force extraordinaire de séduction de cette ontologie fondamentale, je propose néanmoins d’explorer une autre voie, d’articuler autrement le problème herméneutique à la phénoménologie. Pourquoi ce retrait devant l’Analytique du Dasein? Pour les deux raisons que voici : avec la manière radicale d’interroger de Heidegger, les problèmes qui ont mis en mouvement notre recherche non seulement restent non résolus, mais sont perdus de vue. Comment, demandions‑nous, donner un organon à l’exégèse, c’est‑à‑dire à l’intelligence des textes? Comment fonder les sciences historiques face aux sciences de la nature? Comment arbitrer le conflit des interprétations rivales? Ces problèmes sont proprement non considérés dans une herméneutique fondamentale; et cela, à dessein : cette herméneutique n’est pas destinée à les résoudre mais à les dissoudre aussi bien, Heidegger n’a‑t‑il voulu considérer aucun problème particulier concernant la compréhension de tel ou tel étant : il a voulu rééduquer notre œil et réorienter notre regard; il a voulu que nous subordonnions la connaissance historique à la compréhension ontologique, comme une forme dérivée d’une forme originaire. Mais il ne nous donne aucun moyen de montrer en quel sens la compréhension proprement historique est dérivée de cette compréhension originaire. Ne vaut‑il pas mieux dès lors partir des formes dérivées de la compréhension, et montrer en elle les signes de leur dérivation? Cela implique que l’on prenne son départ au plan même où la compréhension s’exerce, c’est‑à‑dire au plan du langage.
Texte 24 : Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris Seuil 1976, p.207, 212 et 216.
C’est ici que se trouve le parallèle avec l’expérience herméneutique. Il me faut admettre la tradition dans son exigence, non au sens d’une simple reconnaissance de l’altérité du passé, mais en reconnaissant qu’elle a quelque chose à me dire. Cela aussi demande une forme fondamentale d’ouverture. Quiconque est ainsi ouvert à la tradition discerne que la conscience historiographique n’est pas du tout vraiment ouverte; au contraire, lisant ses textes « historiquement », elle a déjà préalablement, fondamentalement, nivelé la tradition de telle sorte que les normes de son propre savoir ne peuvent plus jamais être remises en question par la tradition. Rappelons‑nous la naïveté de l’assimilation familière à l’attitude historiographique. On lit, dans le vingt‑cinquième Lyceumsfragment de Friedrich Schlegel : « Les deux principes fondamentaux de ce qu’on appelle la critique historique sont le postulat du « commun » et l’axiome de « l’habituel », Postulat du « commun » : tout ce qui est vraiment grand, bon et beau est invraisemblable parce qu’extraordinaire et, pour le moins, suspect. Axiome de « l’habituel » : ce qu’il en est de nous et de ce qui nous entoure doit avoir été ainsi partout, car qu’il en soit ainsi est tout naturel. »
La conscience de l’efficience historique, en revanche, tourne le dos à la naïveté d’une telle assimilation et d’une telle comparaison en permettant à la tradition d’accéder à l’expérience et en restant ouverte à la requête de vérité qui se rencontre en elle. Ce n’est pas dans la certitude méthodologique que la conscience herméneutique trouve son achèvement, mais dans la même disponibilité à l’expérience qui distingue l’homme expérimenté de l’homme emprisonné dans les dogmes. Voilà ce qui distingue la conscience de l’efficience historique, comme nous pouvons désormais le dire avec plus de précision sur la base du concept d’expérience. (…)
Dans ses analyses inoubliables, Platon montre où réside la difficulté de savoir ce qu’on ne sait pas. C’est la puissance de l’opinion à laquelle il est si difficile de s’opposer pour arriver à s’avouer son ignorance. L’opinion, c’est ce qui réprime le besoin de questionner. Elle est animée d’une singulière tendance à la propagation. Elle voudrait toujours être l’opinion générale. C’est d’ailleurs ce que laisse entendre le mot qui, chez les Grecs, signifie opinion, doxa, et qui désigne en même temps la décision finale à laquelle parviennent l’ensemble des citoyens réunis en assemblée. Comment donc peut‑on en venir au non‑savoir et au besoin de questionner? (…)
La logique de la question et de la réponse.
Nous revenons donc à notre affirmation selon laquelle le phénomène herméneutique contient lui aussi le caractère originel du dialogue et la structure de la question et de la réponse. Le fait qu’un texte transmis devienne objet d’interprétation veut déjà dire qu’il pose une question à l’interprète. Dans ce sens, l’interprétation contient toujours une référence essentielle à la question qui vous est posée. Comprendre un texte veut dire comprendre cette question. Mais cela on le fait, comme nous l’avons montré, en acquérant l’horizon herméneutique. Cet horizon nous apparaît maintenant en tant qu’horizon de la question à l’intérieur duquel se détermine la direction de sens du texte.
Il faut donc, pour comprendre, se reporter par la question en deçà de la chose dite. Il faut la comprendre comme une réponse, sur la base d’une question dont elle constitue la réponse. Mais en se reportant en deçà du texte, on l’a nécessairement dépassé par la question adressée à la chose dite, on l’a nécessairement dépassé par sa question. En effet. on ne comprend le texte dans son sens qu’en acquérant l’horizon de la question qui, en tant que telle, englobe nécessairement d’autres réponses également possibles. Dans cette mesure, le sens d’une proposition est relatif à la question dont il constitue la réponse; mais cela signifie qu’il dépasse nécessairement ce qui y est énoncé. La logique des sciences humaines, comme il ressort de ces considérations, est une logique de la question.
Texte 25 : Walter Benjamin, Thèses sur le concept de l’histoire (V, VII, XVII), Écrits français, Paris Seuil 1991, p.341 sq.
L’image authentique du passé n’apparaît que dans un éclair. Image qui ne surgit que pour s’éclipser à jamais dès l’instant suivant. La vérité immobile qui ne fait qu’attendre le chercheur ne correspond nullement à ce concept de la vérité en matière d’histoire. Il s’appuie bien plutôt sur le vers du Dante qui dit : c’est une image unique, irremplaçable du passé qui s’évanouit avec chaque présent qui n’a pas su se reconnaître visé par elle.
Or, ceux qui, à un moment donné, détiennent le pouvoir sont les héritiers de tous ceux qui jamais, quand que ce soit, ont cueilli la victoire. L’historien, s’identifiant au vainqueur servira donc irrémédiablement les détenteurs du pouvoir actuel. Voilà qui [en] dira assez à l’historien matérialiste. Quiconque, jusqu’à ce jour, aura remporté la victoire fera partie du grand cortège triomphal qui passe au‑dessus de ceux qui jonchent le sol.
L’historien matérialiste ne s’approche d’une quelconque réalité historique qu’à condition qu’elle se présente à lui sous l’espèce de la monade. Cette structure se présente à lui comme signe d’un bloquage messianique des choses révolues; autrement dit comme une situation révolutionnaire dans la lutte pour la libération du passé opprimé. L’historien matérialiste, en se saisissant de cette chance, va faire éclater la continuité historique pour en dégager une époque donnée; il ira faire éclater pareillement la continuité d’une époque pour en dégager une vie individuelle; enfin il ira faire éclater cette vie individuelle pour en dégager un fait ou une oeuvre donnée. Il réussira ainsi à faire voir comment la vie entière d’un individu tient dans une de ses œuvres, un de ses faits; comment dans cette vie tient une époque entière; et comment dans une époque tient l’ensemble de l’histoire humaine. Les fruits nourrissants de l’arbre de la connaissance sont donc ceux qui portent enfermé dans leur pulpe, telle une semence précieuse mais dépourvue de goût, le Temps historique.
Exercices
- Pourquoi Gadamer relève-t-il davantage du pôle d’appartenance que du pôle de distance herméneutique ?
- Que pensez-vous de l’usage qu’il propose d’une sorte d’anachronisme en histoire ?En quoi cela est-il proche des thèses de Benjamin (texte 25) ?
- Allez chercher dans un bon dictionnaire ou une encyclopédie la présentation de Schleiermacher et de Dilthey
- Texte 23, expliquez ce que Ricoeur reproche à Heidegger, et imaginez une défense de Heidegger
- Imaginez un bref débat entre le Ricoeur du texte 23 et le Gadamer du texte 24.
Leçon 7
Ricoeur: Herméneutique et poétique, le monde du texte
Ricoeur s’est, entre autres choses, intéressé à l’autonomisation du texte qui, par son « inscription », se détache du contexte sémantique initial. Par cette autonomisation, le texte est « le paradigme de la distanciation dans la communication ». Et c’est pourquoi « l’interprétation est la réplique de cette distanciation fondamentale que constitue l’objectivation de l’homme dans ses oeuvres de discours, comparables à son objectivation dans les produits de son travail et de son art »[27].
Ce faisant, Ricoeur semble abandonner « le mouvement spontané de la question et de la réponse » au domaine de l’entente orale, désormais inaccessible pour qui travaille sur des textes anciens ou sur des contextes éloignés. C’est pourquoi il parle d’herméneutique critique (un peu comme on a pu parler de mécanique ondulatoire), cherchant à tresser ensemble l’appartenance herméneutique (vérité) et la distance critique (méthode).
Dans Du texte à l’action, toutefois, on voit cependant poindre aussi un autre mouvement : interpréter c’est imaginer un ou des mondes possibles déployés par le texte, et c’est « agir » ce monde, comme le musicien interprète la partition (et comme le prédicateur interprète le texte biblique). L’herméneutique se fait alors dans l’espace ouvert « devant » le texte, par son autonomisation, qui n’est pas seulement le détachement à l’égard du contexte initial, mais l’ouverture de nouveaux contextes possibles. L’autonomisation déploie la possibilité d’être du texte. La vérité du texte est alors en aval. Nous le savons déjà, la question à laquelle le texte répond n’est pas la même que la question ouverte par le texte, et à laquelle il renvoie. Ce principe permet de redéplier autrement les orientations herméneutiques, et :
1) de pointer les mondes possibles ouverts par le texte comme autant de propositions poétiques;
2) de pointer aussi l’obligation pour nos existences de faire de l’un de ces possibles notre propre interprétation (de la question de savoir ce que nous sommes), notre éthique car nous en sommes responsables, notre préférence, notre forme de vie.
Le sens du texte n’est pas seulement fonction des questions auxquelles il répond, mais des questions qu’il soulève et propose, et qu’il anticipe en quelque sorte par ses réponses. C’est ce qu’a bien montré Jauss dans son Esthétique de la réception.
7.1) Jauss et l’Esthétique de la réception
H.R.Jauss distingue l' »effet » de l’oeuvre, qui reste attaché à ses qualités propres, de sa « réception », qui demande un lecteur actif et libre d’y venir avec un questionnement inédit[28]. Il n’y a pas de transmission qui s’opère d’elle-même: elle suppose un texte dont la forme maintienne ouverte et donc présente la signification entendue comme la réponse implicite; et d’autre part un sujet présent qui y découvre cette réponse implicite à une question qu’il lui appartient, à lui, de poser maintenant[29]. Jauss s’oppose donc à l’idée que le texte nous interrogerait lui-même: son « potentiel d’interrogation » n’est que sa capacité à comporter des réponses implicites[30]; c’est le lecteur qui interroge.
Le modèle du genre de cette herméneutique de la question et de la réponse dans la réception, c’est l’étude de Jauss « De l’Iphigénie de Racine à l’Iphigénie de Goethe ». Observant que cette dernière pièce fut jadis très prisée et qu’elle est aujourd’hui oubliée, Jauss s’intéresse justement aux interprétations, déposées en « précompréhension », qui s’opposent à ce que la pièce soit de nouveau reçue par les lycéens d’aujourd’hui. Comment une oeuvre d’abord considérée comme une rupture et un scandale, a-t-elle pu devenir tellement familière et bourgeoise que l’on s’y ennuie? Pour cela, il la compare à l’Iphigénie de Racine, où le tragique affronte l’impuissance de la volonté humaine à la toute puissance arbitraire du Dieu. La question de Racine serait: « que reste-t-il à faire à l’homme quand il découvre que l’image paternelle de l’autorité n’est plus crédible ». Mais quand cette question se retire, personne ne comprend plus le drame de la révolte du fils qui veut quand même rester un « bon » fils. Jauss cherche donc du côté de la réception cet « horizon de la question et de la réponse » par lequel la question change, et le même drame doit être relu autrement. Venant après Racine, la question de Goethe serait plutôt: comment est-il « possible d’établir une nouvelle relation, un nouvel accord entre l’homme devenu majeur et l’autorité divine? ». D’où l’acte inouï d’une Iphigénie qui manifeste à la fois la liberté adulte, l’autonomie par laquelle les humains déchargent Dieu du mal dans le monde, et la féminité idéale. Jauss montre d’ailleurs ainsi la transformation de l’instance libératrice en un nouveau « mythe ».
7.2) Des mondes possibles
Ricoeur montre, aussi bien dans la métaphore vive que dans le récit de fiction, la suspension du monde de la référence littérale, et l’ouverture d’une référence métaphorique. Le texte poétique n’est pas sans référence, au contraire, il ouvre un monde, il propose des mondes possibles. Si le récit brise les cadres temporels, s’il suspend l’espace présent, c’est pour ouvrir en nous une autre temporalité, pour ouvrir un autre espace. Il ouvre ainsi un quasi–temps, un quasi–espace, des variations imaginatives qui sont des variations sur le monde et l’ouverture d’un autre monde, devant lui, devant nous. Toute intrigue ainsi est une problématique, une configuration possible de la question.
Et la littérature mêle différents procédés (historiographie, mythe, slogans, roman, dialogues, drames, psaumes, lois, proverbes, prophétie, poèmes, lettres, etc.) qui sont autant de manières de rapporter les sujets au temps et à l’espace, au monde, d’essayer leurs relations mutuelles, autant de manières de « composer la question ».
Commentant Heidegger, Ricoeur écrit : »comprendre un texte ce n’est pas trouver un sens inerte qui y serait contenu, c’est déployer la possibilité d’être indiquée dans ce texte »(Du texte à l’action p.91). La compréhension est d’abord une manière d’habiter, une manière d’être. Et c’est pourquoi il parle de refiguration du monde :
« le postulat sous–jacent à cette reconnaissance de la fonction de refiguration de l’oeuvre poétique en général est celui d’une herméneutique qui vise moins à restituer l’intention de l’auteur en arrière du texte qu’à expliciter le mouvement par lequel un texte déploie un monde en quelque sorte en aval de lui–même (…) Je n’ai cessé, ces dernières années, de soutenir que ce qui est interprété dans un texte, c’est la proposition d’un monde que je pourrais habiter et dans lequel je pourrais projeter mes pouvoirs les plus propres. Dans La Métaphore vive, j’ai soutenu que la poésie, par son muthos, re–décrit le monde. De la même manière, je dirai dans cet ouvrage que le faire narratif re–signifie le monde dans sa dimension temporelle, dans la mesure où raconter, réciter, c’est refaire l’action selon l’invite du poème »[31].
7.3) Du texte à l’augmentation des capacités de sentir et d’agir
Dans son ouvrage intitulé Du texte à l’action, Ricoeur montre comment l’on passe du texte à l’action, par le biais de l’imagination d’un autre monde possible, et d’une imagination qui prépare un pouvoir–faire. C’est l’imagination qui permet de passer du discours à l’acte parce que la fiction ne se borne pas à redécrire la réalité (fonction théorique), elle refait le monde de l’action (fonction pratique). Par ailleurs l’action est semblable au texte, parce que l’un et l’autre s’extériorisent dans des traces, s’autonomisent par rapport à l’auteur ou l’agent, ne se bornent pas à refléter une situation mais la modifient et ouvrent un monde : « le faire fait que la réalité n’est pas totalisable ».
Plus, la refiguration poétique est aussi éthique, et ne laisse pas le lecteur intact. Sa subjectivité est elle-même mise en suspens par son exposition au texte, lequel fraye en lui de nouvelles possibilités d’agir et de sentir: « la lecture m’introduit dans les variations imaginatives de l’ego »[32].
_______________
Textes & Exercices 7 :
Texte 26 : Ralph Waldo Emerson, La confiance en soi, Paris : rivages, 2000, p.85 sq.
Croire en votre propre pensée, croire que ce qui est vrai pour vous au plus profond de votre cœur est vrai pour tous les hommes — là est le génie (…) La voix de l’esprit étant si familière à chacun, le plus grand mérite que nous reconnaissions à Moïse, Platon et Dante est de n’avoir fait aucun cas des livres et des traditions et d’avoir dit non ce que pensaient les hommes mais ce qu’eux-mêmes pensaient. L’homme devrait apprendre à détecter et à observer cette lueur qui, de l’intérieur, traverse son esprit comme un éclair, plus qu’il ne prête attention à l’éclat qui brille au firmament des poètes et des sages. Et pourtant, sans lui prêter attention, il écarte cette pensée, qui est la sienne. En toute œuvre de génie nous reconnaissons des pensées que nous avons écartées (…) La vertu la plus prisée est le conformisme. Elle n’a qu’aversion pour la confiance en soi.
Textes 27 : Frédéric Nietzsche, Le gai savoir, fin de l’aphorisme n°2 et aph. n°11.
Je veux dire ceci : que la plupart des gens ne trouvent pas méprisable de croire telle ou telle chose et d’agir d’après elle sans avoir pesé le pour et le contre, sans avoir pris une conscience sûre de ses suprêmes raisons d’agir, sans même s’être donné la peine de s’enquérir de ces raisons ; les hommes les plus doués et les femmes les plus nobles font encore partie de ce grand nombre. Qu ‘importent bonté, et finesse, et génie, si l’homme de ces vertus tolère dans son coeur la tiédeur de la foi, la tiédeur du jugement, si le besoin de la certitude n’est pas son plus profond désir, sa plus intime nécessité s’il n’y voit pas ce qui distingue les esprits supérieurs des autres! J’ai trouvé chez des gens pieux une haine de la raison dont je leur ai été reconnaissant : cette haine trahissait du moins leur mauvaise conscience intellectuelle! Mais se trouver planté au milieu de cette rerum concordia discors, de cette merveilleuse incertitude, de cette multiplicité de la vie, et ne pas interroger, ne pas frémir du désir et de la volupté de s’enquérir, ne pas même haïr celui qui le fait, peut-être s’en moquer à s’en rendre malade, voilà ce que je trouve méprisable, et c’est ce mépris que je cherched’abord en chacun de nous : je ne sais quelle folie me persuade toujours que tout homme, étant homme, le possède. C’est là ma façon d’être injuste.
La Conscience. ‑ La conscience est la dernière phase de l’évolution du système organique, par conséquent aussi ce qu’il y a de moins achevé et de moins fort dans ce système. C’est du conscient que proviennent une foule de méprises qui font qu’un animal, un homme périssent plus tôt qu’il ne serait nécessaire, « en dépit du destin », comme Homère disait. Si le lieu des instincts, ce lieu conservateur, n’était pas tellement plus puissant que la conscience, s’il ne jouait pas, dans l’ensemble, un rôle de régulateur, l’humanité succomberait fatalement sous le poids de ses jugements absurdes, de ses divagations, de sa frivolité, de sa crédulité, en un mot de son conscient : ou plutôt il y a fort longtemps qu’elle n’existerait plus sans lui! Tant qu’une fonction n’est pas mûre, tant qu’elle n’a pas atteint son développement parfait, elle est dangereuse pour l’organisme : c’est une grande chance qu’elle soit bien tyrannisée! La conscience l’est sévèrement, et ce n’est pas à la fierté qu’elle le doit le moins. On pense que cette fierté fait le noyau de l’être humain ; que c’est son élément durable, éternel, suprême, primordial! On tient le conscient pour une constante! on nie sa croissance, ses intermittences! On le considère comme « l’unité de l’organisme »! On le surestime, on le méconnaît ridiculement, ce qui a eu cette conséquence éminemment utile d’empêcher l’homme d’en pousser le développement trop hâtivement. Croyant posséder la conscience, les hommes se sont donné peu de mal pour l’acquérir ; et aujourd’hui ils en sont toujours là! C’est encore une tâche éminemment actuelle, que I’œil humain commence même à peine à entrevoir, que celle de s’incorporer le savoir, de le rendre instinctif chez l’homme; une tâche qu’aperçoivent seuls ceux qui ont compris que jusqu’ici l’homme n’a incorporé que l’erreur, que toute notre conscience se rapporte à elle.
Texte 28 : Hannah Arendt. “ Qu’est-ce que l’autorité ”, dans La crise de la culture, Paris : Gallimard, Folio essais, p.161-162.
Pourtant la relation entre auctor et artifex n’est aucunement la relation (platonicienne) entre le maître qui donne des ordres et le serviteur qui les exécute. La caractéristique la plus frappante de ceux qui sont en autorité est qu’ils n’ont pas de pouvoir. Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit. « tandis que le pouvoir réside dans lepeuple, l’autorité appartient au Sénat ». Parce que l’«autorité», l’augmentation que le Sénat doit ajouter aux décisions politiques, n’est pas le pouvoir, elle nous paraît insaisissable et intangible, ayant à cet égard une ressemblance frappante avec la branche judiciaire du gouvernement de Montesquieu, dont il disait la puissance « en quelque façon nulle », et qui constitue néanmoins autorité dans les gouvernements constitutionnels. Mommsen l’appelait « plus qu’un conseil et moins qu’un ordre, un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage»; cela signifie que « la volonté et les actions d’un peuple sont, comme celles des enfants, exposées à l’erreur et aux fautes et demandent donc une « augmentation et une confirmation de la part du conseil des anciens ». Le caractère autoritaire de l’«augmentation » des anciens se trouve dans le fait qu’elle est un simple avis, qui n’a besoin pour se faire entendre ni de prendre la forme d’un ordre, ni de recourir à la contrainte.
Texte 29 : Paul Ricoeur, Du texte à l’action, Paris Seuil 1986, p.114–117.
C’est, semble‑t‑il, le rôle de la plus grande partie de notre littérature de détruire le monde. Cela est vrai de la littérature de fiction ‑ conte, nouvelle, roman, théâtre ‑, mais aussi de toute la littérature qu’on peut dire poétique, où le langage semble glorifié pour lui‑même aux dépens de la fonction référentielle du discours ordinaire.
Et pourtant, il n’est pas de discours tellement fictif qu’il ne rejoigne la réalité, mais à un autre niveau, plus fondamental que celui qu’atteint le discours descriptif, constatif, didactique, que nous appelons langage ordinaire. Ma thèse est ici que l’abolition d’une référence de premier rang, abolition opérée par la fiction et par la poésie, est la condition de possibilité pour que soit libérée une référence de second rang, qui atteint le monde non plus seulement au niveau des objets manipulables, mais au niveau que Husserl désignait par l’expression de Lebenswelt et Heidegger par celle d’être‑au‑monde.
C’est cette dimension référentielle absolument originale de l’œuvre de fiction et de poésie qui, à mon sens, pose le problème herméneutique le plus fondamental. Si nous ne pouvons plus définir l’herméneutique par la recherche d’un autrui et de ses intentions psychologiques qui se dissimulent derrière le texte, et si nous ne voulons pas réduire l’interprétation au démontage des structures, qu’est‑ce qui reste à interpréter? Je répondrai : interpréter, c’est expliciter la sorte d’être‑au‑monde déployé devant le texte.
Nous rejoignons ici une suggestion de Heidegger concernant la notion de Verstehen. On se rappelle que, dans Sein und Zeit, la théorie de la « compréhension » n’est plus liée à la compréhension d’autrui, mais devient une structure de l’être‑au‑monde; plus précisément, c’est une structure dont l’examen vient après celui de la Befindlichkeit; le moment du « comprendre » répond dialectiquement à l’être en situation, comme étant la projection des possibles les plus propres au cœur même des situations où nous nous trouvons. Je retiens de cette analyse l’idée « de projection des possibles les plus propres » pour l’appliquer à la théorie du texte. Ce qui est en effet à interpréter dans un texte, c’est une proposition de monde, d’un monde tel que je puisse l’habiter pour y projeter un de mes possibles les plus propres. C’est ce que j’appelle le monde du texte, le monde propre à ce texte unique.
Le monde du texte dont nous parlons n’est donc pas celui du langage quotidien; en ce sens, il constitue une nouvelle sorte de distanciation qu’on pourrait dire du réel avec lui‑même. C’est la distanciation que la fiction introduit dans notre appréhension de la réalité. Nous l’avons dit, un récit, un conte, un poème ne sont pas sans référent. Mais ce référent est en rupture avec celui du langage quotidien; par la fiction, par la poésie, de nouvelles possibilités d’être‑au‑monde sont ouvertes dans la réalité quotidienne; fiction et poésie visent l’être, non plus sous la modalité de l’être‑donné, mais sous la modalité du pouvoir‑être. Par là même, la réalité quotidienne est métamorphosée à la faveur de ce qu’on pourrait appeler les variations imaginatives que la littérature opère sur le réel.
Se comprendre devant l’œuvre
Je voudrais considérer une quatrième et dernière dimension de la notion de texte, en montrant que le texte est la médiation par laquelle nous nous comprenons nous‑même. Ce quatrième thème marque l’entrée en scène de la subjectivité du lecteur. Il prolonge ce caractère fondamental de tout discours d’être adressé à quelqu’un. Mais, à la différence du dialogue, ce vis‑à‑vis n’est pas donné dans la situation de discours, il est, si je puis dire, créé, instauré, institué par l’œuvre elle‑même. Une œuvre se fraye ses lecteurs et ainsi se crée son propre vis‑à‑vis subjectif.
On dira que ce problème est bien connu de l’herméneutique la plus traditionnelle : c’est le problème de l’appropriation (Aneignung) ou de l’application (Anwendung) du texte à la situation présente du lecteur. C’est bien ainsi que je le comprends aussi; mais je voudrais souligner combien ce thème est transformé lorsqu’on l’introduit après les précédents.
D’abord, l’appropriation est dialectiquement liée à la distanciation caractéristique de l’écriture. Celle‑ci n’est pas abolie par l’appropriation, elle en est au contraire la contrepartie. Gràce à la distanciation par l’écriture, l’appropriation n’a plus aucun des caractères de l’affinité affective avec l’intention d’un auteur. L’appropriation est tout le contraire de la contemporanéité et de la congénialité; elle est compréhension par la distance, compréhension à distance.
Ensuite, l’appropriation est dialectiquement liée à l’objectivation caractéristique de l’œuvre; elle passe par toutes les objectivations structurales du texte; dans la mesure même où elle ne répond pas à l’auteur, elle répond au sens; c’est peut‑être à ce niveau que la médiation opérée par le texte se laisse le mieux comprendre. Contrairement à la tradition du Cogito et à la prétention du sujet de se connaître lui‑même par intuition immédiate, il faut dire que nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d’humanité déposés dans les œuvres de culture. Que saurions‑nous de l’amour et de la haine, des sentiments éthiques et, en général. de tout ce que nous appelons le soi, si cela n’avait été porté au langage et articulé par la littérature? Ce qui parait ainsi le plus contraire à la subjectivité, et que l’analyse structurale fait apparaître comme la texture même du texte, est le medium même dans lequel seul nous pouvons nous comprendre.
Mais surtout l’appropriation a pour vis‑à‑vis ce que Gadamer appelle « la chose du texte » etque j’appelle ici « le monde de l’œuvre ». Ce que finalement je m’approprie, c’est une proposition du monde; celle‑ci n’est pas derrière le texte, comme le serait une intention cachée, mais devant lui, comme ce que l’œuvre déploie, découvre, révèle. Dès lors, comprendre, c’est se comprendre devant le texte.Non point imposer au texte sa propre capacité finie de comprendre, mais s’exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste, qui serait la proposition d’existence répondant de la manière la plus appropriée à la proposition de monde. La compréhension est alors tout le contraire d’une constitution dont le sujet aurait la clé. Il serait à cet égard plus juste de dire que le soi est constitué par la « chose » du texte.
Il faut sans doute aller plus loin encore : de la même manière que le monde du texte n’est réel que dans la mesure où il est fictif, il faut dire que la subjectivité du lecteur n’advient à elle-même que dans la mesure où elle est mise en suspens, irréalisée, potentialisée, au même titre que le monde lui‑même que le texte déploie. Autrement dit, si la fiction est une dimension fondamentale de la référence du texte, elle n’est pas moins une dimension fondamentale de la subjectivité du lecteur. Lecteur, je ne me trouve qu’en me perdant. La lecture m’introduit dans les variations imaginatives de l’ego. La métamorphose du monde, selon le jeu, est aussi la métamorphose ludique de l’ego.
Textes 30 : Paul Ricoeur, texte final de Histoire et vérité (Paris : Le Seuil, 1964, p.360) ; et texte final du chapitre sur le travail de la ressemblance dans La métaphore vive (Paris : Le Seuil, 1975, 310-311).
C’est donc le caractère originaire de l’affirmation qui est en jeu. il me semble que si cette voie parait bien souvent barrée c’est parce qu’on se donne au départ une idée étroite et pauvre de l’être, réduit au statut de la chose, du donné brut, ‑ ou de l’essence, elle‑même grossièrement identifiée à quelque paradigme im muable et sans relations, comme l’Idée platonicienne interprétée par les Amis des Formes » que Platon précisément combat dans le Sophiste. Ce point est clair chez Sartre : c’est sa notion de l’être en soi, qui sert de repoussoir à, sa notion du néant, qui est trop pauvre et déjà chosifiée (…) Sans doute est‑ce le mérite des philosophies de la négativité depuis Hegel de nous avoir remis sur le chemin d’une philosophie de l’être qui devra décrocher de la chose et de l’essence. Toutes les philosophies classiques sont à des degrés divers des philosophies de la forme, que ce soit de la forme comme Idée. ou comme substance et quiddité. La fonction de la négation est de rendre difficile la philosophie de l’être, comme Platon, le premier, l’a reconnu dans le Sophiste : « l’être et le non‑être nous embarrassent également ». Sous la pression du négatif, des expériences en négatif, nous avons à reconquérir une notion de l’être qui soit acte plutôt que forme, affirmation vivante, puissance d’exister et de faire exister. Laissons une dernière fois la parole à, Platon. par la bouche de l’Etranger du Sophiste : « Eh quoi, par Zeus! nous laisserons‑nous si facilement convaincre que le mouvement, la vie, l’âme, la pensée n’ont réellement point de place au sein de l’être universel, qu’il ne vit ni ne pense, et que, solennel et sacré, vide d’intellect, il reste là, planté, sans pouvoir bouger? ‑ L’effrayante, doctrine que nous accepterions là, étranger. »
La convergence, entre les deux critiques internes, celle de la naïveté ontologique et celle de la démythisation, aboutit ainsi à réitérer la thèse du caractère « tensionnel » de la vérité métaphorique et du « est » qui porte l’affirmation. Je ne dis pas que cette double critique prouve la thèse. La critique interne aide seulement à reconnaître ce qui est assumé et à quoi est commis celui qui parle et qui emploie métaphoriquement le verbe être. En même temps, elle souligne le caractère de paradoxe indépassable qui s’attache à un concept métaphorique de vérité. Le paradoxe consiste en ceci qu’il n’est pas d’autre façon de rendre justice à la notion de vérité métaphorique que d’inclure la pointe critique du « n’est pas » (littéralement) dans la véhémence ontologique du « est » (métaphoriquement). En cela, la thèse ne fait qui tirer la conséquence la plus extrême de la théorie de la tension; de la même manière que la distance logique est préservée dans la proximité métaphorique, et de la même manière que l’interprétation littérale impossible n’est pas simplement abolie par l’interprétation métaphorique mais lui cède en résistant ‑, de la même manière l’affirmation ontologique obéit au principe de tension et à la loi de la « vision stéréoscopique ». C’est « cette constitution tensionnelle du verbe être qui reçoit sa marque grammaticale dans « l’être‑comme » de la métaphore développée en comparaison, en même temps qu’est marquée la tension entre le même et l’autre dans la copule relationnelle.
Quel est maintenant le choc en retour d’une telle conception de la vérité métaphorique sur la définition même de la réalité? Cette question qui constitue l’horizon ultime de la présente étude fera l’objet de la prochaine enquête. Car il appartient au discours spéculatif d’articuler, avec ses ressources propres, ce qui est spontanément assumé par ce conteur populaire qui, selon Roman Jakobson « marque » l’intention poétique de ses récits en disant Aixo era y ne era
Exercices
- Pourquoi Ricoeur refuse-t-il que la fiction soit sans rapport avec la réalité?
- Trouvez un « mythe » qui se prête au genre d’histoire de la réception que propose Jauss pour Iphigénie, et racontez la brièvement.
- Texte 28 : en quoi l’autorité (ce qui est autorisé à autoriser) est-elle fondamentale pour l’herméneutique comme institution de la différence des générations, comme droit de réinterpréter à notre tour, et comme capacité à s’effacer pour laisser place aux suivants ?
- Quel rapport voyez-vous entre l’autorité et la confiance en soi dont parle Emerson ?
- « Croyant posséder la conscience, les hommes se sont donnés peu de mal pour l’acquérir ». Comparez cette phrase de Nietzsche (texte 27) avec celle–ci de Descartes : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils n’en ont ».
- Comparez le texte final de Histoire et vérité (Paris : Le Seuil, 1964) et le texte final du chapitre sur le travail de la ressemblance dans La métaphore vive (Paris : Le Seuil, 1975). Contre quoi Ricoeur se débat-il ? Que propose-t-il ?
Quatrièmes éléments.
La question de la méthode et L’horizon philosophique
Au commencement de la philosophie se trouve l’interrogation, et à chaque recommencement, de Platon à Descartes et Husserl. Peut-on alors dire que le commencement de la philosophie soit aussi l’oubli de cette interrogation[33]? En tous cas l’interrogation philosophique se présente historiquement sous des styles très divers, dialogiques, aporétiques (de a-porie, impasse), critiques, ironiques, etc. Dans ces leçons nous allons l’examiner comme une discipline à la fois critique et dialogique de la pensée. On la verra à l’oeuvre respectivement chez Kant et chez Hegel, mais aussi chez Tillich. C’est que la critique tient à la capacité proprement pluraliste à distinguer les questions, à les désintriquer, à faire voir la discontinuités des problèmes (à ne pas les amalgamer). Et que la circularité de la question et de la réponse fournit une méthode systématique pour élaborer des corrélations (par ex. chez Tillich entre culture et religion) et percevoir la dialectique des philosophies, dont chaque problématique est en même temps la résolution d’un problème et la formulation d’une interrogation ultérieure.
Leçon 8
Kant et la critique des régimes de discours
8.1) La critique
L’analyse critique des problématiques repose sur la capacité à distinguer les différentes questions plus ou moins implicites auxquelles répondent les discours en présence. Or nulle part ce geste critique n’est aussi net et puissant que chez Kant. Pour sortir de l’alternative entre dogmatisme et scepticisme quant aux pouvoirs de la raison, il pluralise celle–ci et montre qu’il y a plusieurs types de jugements. Le même énoncé n’a pas le même sens, la même valeur, le même type de vérité, de vérification ou de légitimité, selon qu’il répond à telle ou telle question, qui le qualifie comme énoncé cognitif, ou moral, ou esthétique, etc. En distinguant la question « que puis–je savoir ? » de la question « que dois–je faire ? » ou de la question « que puis–je espérer ? »[34], la critique kantienne marque les limites entre différentes sortes de jugement : chacun a sa validité ou son sens, mais aucun ne peut s’autoriser à annexer les autres, et de telles prétentions dogmatiques ne pourraient que se renvoyer les unes les autres au scepticisme.
Cette « critique », cette séparation des questions, permet de résoudre une foule de problèmes philosophiques qui étaient simplement engendrés par leur confusion, par leur dialogue de sourds. Le premier problème auquel Kant répond est celui de l’antinomie entre la science et la morale, entre détermination physique et liberté éthique: comment penser ensemble Newton et Rousseau? En outre Kant était tenu de prendre part dans un débat où les champions des Lumières, de la raison et de la science, étaient accusés de prétendre démontrer Dieu, de le réduire dogmatiquement à leur système, tandis que les champions du piétisme, d’une religion du coeur, étaient accusés d’enthousiasme, de superstition, et de prendre toutes leurs intuitions pour des réalités divines. Kant essaye de montrer que l’on ne peut pas tout réduire à un problème de savoir, ni de foi, ni de devoir, ni d’espérance, etc. Pour cela, il faut séparer l’expérience objective, champ de la connaissance possible (Critique de la raison pure théorique), et la liberté subjective, champ de la responsabilité éthique (Critique de la raison pratique).
8.2) Le « vrai » problème
Reste alors ce qui pour le kantisme est le « vrai » problème, le problème soulevé par la critique: c’est le problème de l' »unité » du monde ainsi divisé, Comment faire le « passage » entre nature et liberté ? C’est dans cette intersection entre deux questions, entre deux régimes de jugements bien distincts et bien établis, que se tiennent quelques jugements mixtes. Jetant un pont entre les deux mondes (celui des objets et celui des sujets), les jugements esthétiques, téléologiques (jugements de finalité), politiques, théologiques, forment quatre tentatives de réponses à la question de l’unité du monde: « que puis–je espérer ? » Par exemple le sentiment esthétique du beau est quelque chose comme l’affleurement de la liberté dans le monde physique, comme une sensation libre.
Parmi les auteurs récents, on retrouve chez L.Wittgenstein cette discipline critique destinée à résoudre ou plutôt à dissiper les fausses questions, pour faire place aux vraies, ainsi que ce sens de l’irréductible pluralité des questions qui, de manière implicite, gouvernent le « régime » des phrases, le jeu de langage employé[35].
_______________
Textes & Exercices 8 :
Texte 31 : Emmanuel Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? Paris : Vrin, 1971, début du chap.3.
Hommes de grand talent, vous qui avez des vues si larges ! J’honore votre talent, et j’affectionne votre sentiment de l’humanité. Mais avez‑vous bien songé à ce que vous faites, et où la raison se verra entraînée par vos disputes ? Sans doute, vous désirez que la liberté de penser soit maintenue intacte : sans elle, en effet, c’en serait bientôt fait des libres élans de votre génie lui‑même. Voyons ce qui doit naturellement suivre de cette liberté de penser, si le genre de méthode dont vous avez commencé de (vous servir) se généralise.
A la liberté de penser s’oppose, / en premier lieu, la contrainte civile. On dit, il est vrai, que la liberté de parler ou d’écrire peut nous être ôtée par une puissance supérieure, mais non pas la liberté de penser. Mais penserions‑nous beaucoup, et penserions‑nous bien, si nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec d’autres, qui nous font part de leurs pensées et auxquels nous communiquons les nôtres ? Aussi bien, l’on peut dire que cette puissance extérieure qui. enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leurs pensées, leur ôte également la liberté de penser ‑ l’unique trésor qui nous reste encore en dépit de toutes les charges civiles et qui peut seul apporter un remède à tous les maux qui s’attachent à cette condition.
En second lieu, la liberté de penser est prise au sens où elle s’oppose à la contrainte exercée sur la conscience (Gewissenszwang). C’est là ce qui se passe lorsqu’en matière de religion en dehors de toute contrainte externe, des citoyens se posent en tuteurs à l’égard d’autres citoyens et que, au lieu de donner des arguments, ils s’entendent, au moyen de formules de foi obligatoires et en inspirant la crainte poignante du danger d’une recherche personnelle, à bannir tout examen de la raison grâce à l’impression produite à temps sur les esprits.
En troisième lieu, la liberté de penser signifie que la raison ne se soumette à aucune autre loi que celle qu’elle se donne à elle‑même. Et son contraire est la maxime d’un usage sans loi de la raison ‑ afin, comme le génie en fait le rêve, de voir plus loin qu’en restant dans les limites de ses lois. Il s’ensuit comme naturelle conséquence que, si la raison ne veut point être soumise à la loi qu’elle se donne à elle‑même, il faut qu’elle s’incline sous le joug des lois qu’un autre lui donne ; car sans la moindre loi, rien, pis même la plus grande absurdité (Unsinn) ne pourrait se maintenir bien longtemps (sein Spiel lange treiben). Ainsi l’inévitable conséquence de cette absence explicite de loi dans la pensée ou d’un affranchissement des restrictions imposées par la raison, c’est que la liberté de penser y trouve finalement sa perte. Et puisque ce n’est nullement la faute d’un malheur quelconque, mais d’un véritable orgueil, la liberté est perdue par étourderie (verscherzt) au sens propre de ce terme.
La marche des choses est approximativement la suivante. Le génie se complaît d’abord dans son audacieux élan, après avoir rejeté le fil par lequel la raison le conduisait autrefois. Bientôt il charme aussi les autres par des sentences impérieuses et de brillantes promesses; il semble s’être enfin placé sur le trône qu’une raison lourde et pesante ornait si mal, sans toutefois cesser d’en tenir le langage. Nous autres, en hommes du commun, nous appelons « enthousiasme » (Schwärmerei) la maxime dès lors admise de l’invalidité (Ungültigkeit) d’une raison souverainement législatrice ; mais ces favoris de la bonne nature (la nomment) : « illumination » (Erleuchtung). Mais cependant, comme une confusion de langage doit bientôt naître parmi eux, puisque seules les prescriptions de la raison sont universellement valables et que chacun s’abandonne maintenant à sa propre inspiration, ces inspirations intérieures doivent finalement aboutir à des faits garantis par des témoignages extérieurs et par des traditions, qui au commencement étaient encore choisies mais qui avec le temps (sont devenues) des sources (Urkund) obligatoires. En un mot, il doit en sortir l’entier asservissement de la raison aux faits, c’est‑à‑dire : la superstition, car celle‑ci se laisse tout au moins réduire à une forme de légalité et de ce fait à un état d’équilibre.
Textes 32 : Emmanuel Kant, Critique de la Faculté de juger, Paris : Vrin 1974, p.41 (Introduction), et 130 (§41).
Le concept de liberté ne détermine rien par rapport à 1a connaissance théorique de la nature, et de même le concept de la nature ne détermine rien par rapport aux lois pratiques de la liberté et il n’est pas possible, dans cette mesure, de jeter un pont d’un domaine à l’autre. – Mais si les principes de détermination de la causalité suivant le concept de liberté (et la règle pratique qu’il contient) ne sont pas constatés dans la nature et si le sensible ne peut pas déterminer le supra sensible dans le sujet, l’inverse est pourtant possible (non sans doute par rapport à la connaissance de la nature, mais cependant par rapport aux conséquences qu’a le premier sur cette dernière) et déjà contenu dans le concept d’une causalité par liberté, dont l’effet doit se produire dans le monde conformément à ses lois formelles, bien que le mot cause employé pour le supra‑sensible signifie seulement la raison <Grund> qui détermine la causalité des choses de la nature à un effet qui soit conforme à leurs propres lois naturelles, mais en accord cependant aussi avec le principe formel des lois rationnelles; on ne peut certes apercevoir la possibilité de ceci , mais on peut réfuter d’une façon satisfaisante l’objection d’après laquelle une prétendue contradiction s’y trouverait.
Un homme abandonné sur une île déserte ne tenterait pour lui-même d’orner ni sa hutte, ni lui-même ou de chercher des fleurs, encore moins de les planter pour s’en parer; ce n’est que dans la société qu’il lui vient à l’esprit de n’être pas simplement homme, mais d’être aussi à sa manière un homme raffiné (c’est le début de la civilisation); on considère ainsi en effet celui qui tend et est habile à communiquer son plaisir aux autres et qu’un objet ne peut satisfaire, lorsqu’il ne peut en ressentir la satisfaction en commun avec d’autres <in Gemeinschaft mit anderen>. De même chacun attend et exige de chacun qu’il tienne compte de cette communication universelle en raison d’un contrat originaire pour ainsi dire, qui est dicté par l’humanité elle-même; et sans doute il ne s’agit au début que de choses attrayantes, par exemple des couleurs pour se peindre (le rocou chez les Caraïbes, le cinabre chez les Iroquois), ou des fleurs, des coquillages, de plumes d’oiseaux de belle couleur, et avec le temps ce sont aussi de jolies formes (comme celles des canots, des vêtements, etc.), qui ne procurent aucun contentement, c’est-à-dire aucune satisfaction de jouissance qui furent dans la société importantes et liées à un grand intérêt; jusqu’à ce que la civilisation enfin parvenue au plus haut point fasse de ces formes presque le but essentiel d’une inclination raffinée et n’accorde de valeur aux sensations que dans la mesure où elles peuvent être universellement communiquées; et alors, même si le plaisir, que chacun peut retirer d’un tel objet, est insignifiant et ne possède en lui-même aucun intérêt remarquable, I’idée de sa communicabilité universelle en accroît presqu’infiniment la valeur.
Textes 33 : Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico–philosophicus, Paris : Gallimard 1961 (coll.TEL) p.105–106–107.*
6.4321 ‑ Les faits n’appartiennent tous qu’au problème, non à sa solution.
6.44 ‑ Ce qui est mystique, ce n’est pas comment le monde, mais le fait qu’il est..
6.45 ‑ Contempler le monde sub specie aeterni, c’est le contempler en tant que totalité, mais totalité limitée. Le sentiment du monde en tant que totalité limitée constitue l’élément mystique.
6.5 ‑ Uns réponse qui ne peut être exprimée suppose une question qui elle non plus ne peut être exprimée. L’énigme n’existe pas. Si une question se peut absolument poser, elle peut aussi trouver sa réponse.
6.51 – Le scepticisme n’est pas réfutable, mais est évidement dépourvu de sens s’il s’avise de douter là où il ne peut être posé de question. Car le doute ne peut exister que là où il y a une question; une question que là où il y à une réponse, et celle‑ci que là où quelque chose peut être dit.
6.52 ‑ Nous sentons que même si toutes les possibles questions scientifiques ont trouvé leur réponse, nos problèmes de vie n’ont pas même été effleurés. Assurément il ne subsiste plus alors de question; et cela même constitue la réponse.
6.521 ‑ La solution du problème de la vie se remarque à 1a disparition de ce problème. (N’est‑ce pas là la raison pour laquelle des hommes pour qui le sens de la vie est devenu clair au terme d’un doute prolongé n’ont pu dire ensuite en quoi consistait ce sens?)
6.522 ‑ Il y a assurément de l’inexprimable. Celui‑ci se montre, il est l’élément mystique.
6.53 ‑ La juste méthode de philosophie serait en somme la suivante : ne rien dire sinon ce qui se peut dire, donc les propositions des sciences de la nature ‑ donc quelque chose qui n’a rien à voir avec la philosophie ‑ et puis à chaque fois qu’un autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer qu’il n’a pas donné de signification à certains signes dons ses propositions. Cette méthode ne serait pas satisfaisante pour l’autre ‑ il n’aurait pas le sentiment que nous lui enseignons de la philosophie ‑ mais elle serait la seule rigoureusement juste.
6.54 ‑ Mes propositions sont élucidantes à partir de ce fait que celui qui me comprend les reconnaît à la fin pour des non‑sens, si, passant par elles, ‑ sur elles ‑ par‑dessus elles, il est monté pour en sortir. Il faut qu’il surmonte ces propositions; alors il acquiert une juste vision du monde.
7. ‑ Ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
Texte 34 : Pierre Bayle, article « Manichéens » du Dictionnaire Historique et critique, Paris : Ed.Sociales 1974, p.101.*
L’homme est méchant et malheureux ; chacun le connaît par ce qui se passe au‑dedans de lui et le commerce qu’il est obligé d’avoir avec son proche. Il suffit de vivre cinq ou six ans pour être parfaitement convaincu de ces deux articles ( … ) On s’est toujours choqué que sous un Dieu tout parfait les méchants prospèrent et les gens de bien soient dans l’oppression mais, à mon sens, on devrait être plus surpris de ce qu’aucun homme n’a jamais été exempt de péché et d’afflictions sous un Dieu qui n’a qu’à dire la parole et, tout aussitôt, les hommes seraient saints et heureux.
Texte 35 : Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de théodicée Paris : Garnier Flammarion 1969, p.44.*
J’ai trouvé le moyen, ce me semble, de montrer le contraire d’une manière qui éclaire et qui fait que l’on entre en même temps dans l’intérieur des choses. Car ayant fait de nouvelles découvertes sur la nature de la force active et sur les lois du mouvement, j’ai fait voir qu’elles ne sont pas d’une nécessité absolument géométrique, comme Spinoza paraît l’avoir cru ; et qu’elles ne sont pas purement arbitraires non plus, quoique ce soit l’opinion de M. Bayle et de quelques philosophes modernes ; mais qu’elles dépendent de la convenance, comme je l’ai déjà remarqué ci‑dessus, ou de ce que j’appelle le principe du meilleur ( … ) où je mettais déjà en fait que Dieu ayant choisi le plus parfait de tous les mondes possibles, avait été porté par sa sagesse à permettre le mal qui y était annexé, mais qui n’empêchait pas que, tout compté et rabattu, ce monde ne fût le meilleur qui pût être choisi.
Texte 36 : Emmanuel Kant, « Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine », les deux Remarques.
Voici donc le résultat de cet exposé des débuts de l’histoire humaine : le départ de l’homme du paradis que la raison lui représente comme le premier séjour de son espèce, n’a été que le passage de la rusticité d’une créature purement animale à l’humanité, des lisières où le tenait l’instinct au gouvernement de la raison, en un mot de la tutelle de la nature à l’état de liberté. La question de savoir si l’homme a gagné ou perdu à ce changement ne se pose plus si l’on regarde la destination de son espèce qui réside uniquement dans la marche progressive vers la perfection. Peu importent les erreurs du début lors des essais successifs entrepris par une longue série de générations dans leur tentative pour atteindre ce but. Cependant, cette marche, qui pour l’espèce représente un progrès vers le mieux, n’est pas précisément la même chose pour l’individu. Avant l’éveil de la raison, il n’y avait ni prescription ni interdiction, donc aucune infraction encore ; mais lorsque la raison entra en ligne et, malgré sa faiblesse, s’en prit à l’animalité dans toute sa force, c’est alors que dut apparaître le mal ; et, qui pis est, au stade de la raison cultivée, apparut le vice, totalement absent dans l’état d’ignorance, c’est‑à‑dire d’innocence. Le premier pas, par conséquent, pour sortir de cet état, aboutit à une chute du point de vue moral ; du point de vue physique la conséquence de cette chute, ce furent une foule de maux jusque là inconnus de la vie, donc une punition. L’histoire de la nature commence donc par le Bien, car elle est l’œuvre de Dieu ; l’histoire de la liberté commence par le Mal, car elle est l’œuvre de l’homme. En ce qui concerne l’individu qui, faisant usage de sa liberté, ne songe qu’à soi‑même, il y eut perte lors de ce changement; en ce qui concerne la nature, soucieuse d’orienter la fin qu’elle réserve à l’homme en vue de son espèce, ce fut un gain. L’individu a donc des raisons d’inscrire à son compte comme sa propre faute tous les maux qu’il endure et tout le mal qu’il fait; mais en même temps, comme membre du Tout (d’une espèce), il a raison d’admirer et d’estimer la sagesse et la finalité de l’ordonnance.
De cette façon, on peut aussi accorder entre elles et avec la raison les affirmations qui furent si souvent dénaturées et en apparence contradictoires du célèbre J.‑J. Rousseau. Dans ses ouvrages sur l’Influence des Sciences et sur l’Inégalité des hommes, il montre très justement la contradiction inévitable entre la civilisation et la nature du genre humain en tant qu’espèce physique, où chaque individu doit réaliser pleinement sa destination ; mais dans son Émile, dans son Contrat Social, et d’autres écrits, il cherche à résoudre un problème encore plus difficile : celui de savoir comment la civilisation doit progresser pour développer les dispositions de l’humanité en tant qu’espèce morale.
Remarque finale
L’homme qui pense éprouve un chagrin capable de tourner à la perversion morale; chagrin que l’homme qui ne pense pas ignore totalement. Le premier est en effet mécontent de la Providence qui préside de haut à la marche de l’Univers, lorsqu’il dénombre les maux qui pèsent si lourdement sur l’espèce humaine, sans qu’il y ait, semble‑t‑il, l’espoir d’une amélioration. Or il est de la plus haute importance d’être satisfait de la Providence (même si elle nous a tracé sur notre monde terrestre une voie très pénible), et pour garder courage au milieu des difficultés, et pour nous empêcher de rejeter notre faute propre sur le destin, en perdant ainsi de vue notre propre faute qui pourrait bien être la seule cause de tous ces maux, et en négligeant en retour le remède: notre amélioration personnelle.
Il faut l’avouer: les plus grands maux qui accablent les peuples civilisés nous sont amenés par la guerre, et à vrai dire non pas tant par celle qui réellement a lieu ou a eu lieu, que par les préparatifs incessants et même régulièrement accrus en vue d’une guerre à venir. C’est à cela que l’État gaspille toutes ses forces, tous les fruits de la culture qui pourraient être utilisés à augmenter encore celle‑ci ; on porte en bien des endroits un grave préjudice à la liberté, et les attentions maternelles de I’État pour des membres pris individuellement se changent en exigences d’une dureté impitoyable, légitimées toutefois par la crainte d’un danger extérieur. Mais cette culture, l’étroite union des classes dans la communauté en vue de l’accroissement mutuel de leur bien‑être, la population, et qui plus est, ce degré de liberté persistant, même en dépit des lois restrictives, est‑ce que tout cela subsisterait, si cette crainte constante de la guerre n’amenait de force chez les chefs de l’État la considération envers l’Humanité? Il suffit de considérer la Chine qui, par sa situation même, peut bien redouter à la rigueur quelque attaque imprévue, mais d’aucun ennemi puissant, et où, de ce fait, toute trace de liberté a disparu. ‑ Donc au degré de culture auquel est parvenu le genre humain, la guerre est un moyen indispensable pour la perfectionner encore ; et ce n’est qu’après l’achèvement (Dieu sait quand) de cette culture qu’une paix éternelle nous serait salutaire et deviendrait de ce fait possible. Nous sommes donc sur ce point bien responsables des maux à propos desquels nous élevons des plaintes si amères ; et le texte sacré a tout à fait raison de représenter la fusion des peuples en une société et leur libération complète du danger extérieur lors des tout premiers débuts de leur développement, comme un obstacle à toute culture plus élevée, et comme l’engloutissement dans une incurable corruption.
Exercices
- Qu’est-ce pour vous que le scepticisme ?
- Allez chercher dans un bon dictionnaire ou une encyclopédie la présentation de Husserl ; pourquoi Descartes est-il pour lui si important ?
- « Nous ne lui donnerons pas le nom pompeux d’ontologie mais celui d’une simple analytique de l’entendement pur » Pourquoi cette remarque de Kant dans la Critique de la raison pure est-elle comique ? Que veut-il dire ?
- Pouvez-vous appliquer le geste « critique » au désaccord qui oppose Bayle et Leibniz sur la question de la théodicée ?
- Si le « beau » est un mixte de nature et de liberté, essayez de penser en quoi le politique et en quoi le religieux sont également à cheval entre deux ordres de discours.
Leçon 9
Hegel et la dialectique Tillich et la corrélation
9.1) la dialectique hégélienne
G.W.F. Hegel pense la dialectique comme l’issue à la séparation kantienne entre les « Lumières » de la raison, et la « nuit » de la piété. Il s’agit de sortir de l’enfermement de l’objet dans l’objectif, du sujet dans le subjectif. Hegel montre comment la liberté doit se représenter (et donc s' »aliéner ») dans des lois pour se réaliser, comment le rationnel doit se faire réel pour que le réel devienne rationnel; se perdant pour se trouver, le sujet se fait objet, l’infini se fait fini, l’absolu se fait relatif, la parole se fait chair.
La dialectique hégélienne met donc en oeuvre un autre style de questionnement, plus proche de la différence problématologique[36] que la critique kantienne. Transcrite en termes de question-réponse, l’idée est qu’une réponse qui refuse de se laisser interroger, qui veut rester elle–même réponse, devient une pure tautologie, ne se maintenant qu’en répétant une question qui pourtant s’annule en elle. En ce sens–là la dialectique montre la bifurcation entre une réponse littérale qui s’arrête, et une réponse qui rentre dans la négativité, et qui porte en elle (et comme dans les douleurs de l’enfantement) la question nouvelle, et donc aussi la prochaine bifurcation. Cette dialectique suppose deux interlocuteurs: le sujet qui se situe au plan de la réponse première, et celui qui se situe au plan de la question. Dans ce dédoublement de la conscience, ce n’est pas la conscience qui reste certaine de sa réponse univoque, mais c’est celle qui porte le sens de la question, c’est à dire en un sens de sa propre mort, qui seule peut ouvrir à la possibilité d’une réponse effective, qui comprenne la réponse et la question, l’affirmation première et sa négation. On relève ainsi deux processus caractéristiques et indissociables.
Le premier processus caractéristique de la dialectique, c’est le travail de la « négativité », par lequel le même énoncé, le même contenu propositionnel, sans modification sémantique (c’est le même « sème »), est dans l’énoncé initial le lieu de la réponse et dans le second celui de la question. La question seconde n’est que la répétition de la réponse première, sous un autre point de vue que celui de la première question. L’interrogation développe ainsi en pleine pâte de l’affirmation première le levain d’une négation qui était en germe dans son unilatéralité même.
Dans le deuxième processus, le trait caractéristique de la dialectique est cette assimilation, ce dépassement de la question initiale, cette « aufhebung » par laquelle la question précédente est non pas abolie, niée, mais accomplie et comme surmontée dans la réponse (on ne répète pas la question dans la réponse). Ce dépassement, caractéristique de la réponse comme réponse, est essentiel pour comprendre comment une réponse peut s’autonomiser par rapport à sa question initiale, s’en détacher et acquérir sa dynamique propre.
Entre les deux styles de questionnement que nous venons d’évoquer le différend est profond. Une pensée de style dialectique reprochera à la critique de coincer la philosophie sous un ciel fixe de questions séparées et invariantes. Une pensée de style critique reprochera à la dialectique de faire une histoire romantique assez géniale (typique des grands universitaires allemands classiques), mais en occultant par excès de synthèse les discontinuités et les ruptures entre les problématiques.
9.2) Symbole et corrélation chez Tillich
Pour Tillich, la circularité de la question et de la réponse fournit une méthode systématique pour élaborer la corrélation entre culture et religion. Qu’est ce qu’un symbole ? Le sens ou la force d’un symbole dépend de la manière dont il répond (ou correspond) à une situation. « Au moment où cette situation intérieure du groupe par rapport au symbole a cessé d’être réelle, ce symbole meurt. »(les soldats de Verdun ne comprennent pas). Cette conception de la culture et du symbole se retrouve dans la méthode de corrélation qu’il applique à la théologie :
« Le système qui suit tente d’utiliser la méthode de corrélation comme moyen d’unir message et situation. Il cherche à établir une corrélation entre les questions sous–jacentes à la situation et les réponses implicites du message. Il ne tire pas les réponses des questions comme le fait une théoloqie apologétique qui veut se suffire à elle–même. Mais il n’élabore pas des réponses sans les relier aux questions comme le fait une théologie kérygmatique qui veut se suffire à elle–même. Il établit une corrélation entre questions et réponses, situation et message, existence humaine et manifestation divine. »[37]
On retrouve cette corrélation dans l’histoire qu’il propose des formes de courage et des formes d’angoisse. Une période se caractérise en effet par une angoisse qui lui est spécifique. L’Antiquité est hantée par l’angoisse de la mort, à laquelle répond une prédication de la Résurrection. Mais la « résurrection » renvoie à une tout autre question qui est celle de la damnation. Et plus on répétait l’antique réponse, plus l’angoisse augmentait. C’est cette angoisse, qui domine la fin de l’âge médiéval, que Luther a affronté courageusement et à laquelle il a répondu par la prédication de la « grâce ». Avec la Réforme, on sort du cercle mort–résurrection pour entrer dans le cercle culpabilité–grâce ; on change de monde de langage, d’univers symbolique. Mais la « grâce » soulève une tout autre question qui est celle du vide et de l’absurde, parce qu’elle désenchante le monde naturel, parce qu’elle sépare notre existence de notre essence, de notre nature, et en fait une « facticité »: nous sommes superflus.
Sur ces différents exemples, on peut percevoir la dialectique des philosophies, dont chaque problématique est en même temps la résolution d’un problème et la formulation d’une interrogation ultérieure, et comprendre les grandes dialogiques qui traversent l’histoire des mentalités (un type de courage répond à une forme d’angoisse mais en soulève une autre) ou celle des rationalités (une forme de rationalité intègre un irrationnel mais s’adosse à un autre irrationnel).
_______________
Textes & Exercices 9 :
Texte 37 : Jean-Jacques Rousseau, Préface au Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes (Paris : Nathan 1981, p.40).
Car ce n’est pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme, et de bien connaître un état qui n’existe plus, qui i n’a peut‑être point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Il faudrait même plus de philosophie qu’on ne pense à celui qui entreprendrait de déterminer exactement les précautions à prendre pour faire sur ce sujet de solides observations; et une bonne solution du problème suivant ne me paraîtrait pas indigne des Aristotes et des Plines de notre siècle. Quelles expériences pour parvenir à connaître l’homme naturel et quels sont les moyens de faire ces expériences au sein de la société ?
Texte 38 : Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Livre III, chapitre 15, Paris : 10/18 p.115.
La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée, est nulle. (…) La loi n’étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que, dans la puissance législative, le Peuple ne peut être représenté ; mais il peut et doit l’être dans la puissance exécutive, qui n’est que la force appliquée à la loi.
Texte 39 : Karl Marx, Manuscrits de 44, Paris : Ed.Sociales 1972, p.100.
Toutes ces conséquences se trouvent dans cette détermination : l’ouvrier est à l’égard du produit de son travail dans le même rapport qu’à l’égard d’un objet étranger. Car ceci est évident par hypothèse : plus l’ouvrier s’extériorise dons son travail, plus le monde étranger, objectif, qu’il crée en face de lui, devient puissant, plus il s’appauvrit lui‑même et plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. (…)
Dans le cadre de la propriété privée, les choses prennent une signification inverse. Tout homme s’applique à créer pour l’autre un besoin nouveau pour le contraindre à un nouveau sacrifice, le placer dans une nouvelle dépendance et le pousser à un nouveau mode de jouissance et, par suite, de ruine économique. Chacun cherche à créer une force essentielle étrangère dominant les autres hommes pour y trouver la satisfaction de son propre besoin égoïste. Avec la masse des objets augmente donc l’empire des êtres étrangers auquel l’homme est soumis et tout produit nouveau renforce encore la tromperie réciproque et le pillage mutuel. L’homme devient d’autant plus pauvre en tant qu’homme, il a d’autant plus besoin d’argent pour se rendre maître de l’être hostile, et la puissance de son argent tombe exactement en raison inverse du volume de la production, c’est‑à‑dire que son indigence augmente à mesure que croit la puissance de l’argent. ‑ Le besoin d’argent est donc le vrai besoin produit par l’économie politique et l’unique besoin qu’elle produit.
Texte 40 : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La phénoménologie de l’esprit, Paris : Aubier 1977, tome 1 p.164 sur la peur.
b) ‑ (LA PEUR.) Nous avons vu seulement ce qu’est la servitude dans le comportement de la domination. Mais la servitude est conscience de soi, et il nous faut alors considérer ce qu’elle est en soi et pour soi‑même. Tout d’abord, pour la servitude, c’est le maître qui est l’essence ; sa vérité lui est donc la conscience qui est indépendante et est pour soi, mais cette vérité qui est pour elle n’est pas encore en elle‑même. Toutefois, elle a en fait en elle‑même cette vérité de la pure négativité et de l’être-pour‑soi; car elle a fait en elle l’expérience de cette essence. Cette conscience a précisément éprouvé l’angoisse non au sujet de telle ou telle chose, non durant tel ou tel instant, mais elle a éprouvé l’angoisse au sujet de l’intégralité de son essence, car elle a ressenti la peur de la mort, le maître absolu. Dans cette angoisse, elle a été dissoute intimement, a tremblé dans les profondeurs de soi‑même, et tout ce qui était fixe a vacillé en elle. Mais un tel mouvement, pur et universel, une telle fluidification absolue de toute subsistance, c’est là l’essence simple de la conscience de soi, l’absolue négativité, le pur être‑pour‑soi, qui est donc en cette conscience même. Ce moment du pur être‑pour‑soi est aussi pour elle, car, dans le maître, ce moment est son objet. De plus, cette conscience n’est pas seulement cette dissolution universelle en général; mais dans le service elle accomplit cette dissolution et la réalise effectivement. Enservant, elle supprime dans tous les moments singuliers son adhésion à l’être‑là naturel, et en travaillant l’élimine.
Texte 41 : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La phénoménologie de l’esprit, Paris : Aubier 1977, tome 2 p.133-135 sur la Terreur.
Ce mouvement est donc l’action réciproque de la conscience sur soi‑même, dans laquelle elle ne laisse rien se détacher d’elle sous la figure d’un objet libre passant en face d’elle. Il en résulte qu’elle ne peut parvenir à aucune oeuvre positive, ni aux œuvres universelles du langage et de l’effectivité, ni aux lois et aux institutions universelles de la liberté consciente, ni aux opérations et aux oeuvres de la liberté voulante. ‑ L’œuvre à laquelle la liberté prenant conscience de soi pourrait parvenir consisterait en ceci : comme substance universelle, elle se ferait objet et être.
Cette conscience de soi, au surplus, ne se laisse pas frustrer ‑ de l’effectivité par l’image de l’obéissance à des lois données par elle qui lui assigneraient une partie du tout, et par sa représentation dans la législation et l’opération universelle, ‑ elle ne se laisse pas frustrer de l’effectivité consistant à donner elle‑même la loi et à accomplir non une œuvre singulière, mais l’oeuvre universelle même, car là où le Soi est seulement représenté et présenté idéalement, il n’est pas effectivement; où il est par procuration il n’est pas.
Si dans cette oeuvre universelle de la liberté absolue, considérée comme substance étant là, la conscience de soi singulière ne se trouve pas, aussi peu elle se trouve dans les opérations propres et les actions individuelles de la volonté de cette liberté Pour que l’universel parvienne à une opération, il est nécessaire qu’il se concentre dans l’Un de l’individualité et place à la tête une conscience de soi singulière; c’est en effet dans un Soi qui est un que la volonté universelle est volonté effective; toutefois tous les autres singuliers sont ainsi exclus du tout de cette opération et y participent seulement dans une mesure limitée; de cette façon l’opération ne serait pas opération de la conscience de soi universelle effective. ‑ La liberté universelle ne peut donc produire ni une oeuvre positive ni une opération positive; il ne lui reste que l’opération négative; elle est seulement la furie de la destruction.
Texte 42 : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La phénoménologie de l’esprit, Paris : Aubier 1941–1977, Préface, tome 1 p.29.
La mort, si nous voulons nommer ainsi cette irréalité, est la chose 1a plus redoutable, et tenir fermement ce qui est mort, est ce qui exige la plus grande force. La beauté sans force hait l’entendement, parce que l’entendement attend d’elle ce qu’elle n’est pas en mesure d’accomplir. Ce n’est pas cette vie qui recule d’horreur devant la mort et se préserve pure de la destruction, mais la vie qui porte la mort, et se maintient dans la mort même, qui est la vie de l’esprit. L’esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se retrouver soi‑même dans l’absolu déchirement. L’esprit est cette puissance en n’étant pas semblable au positif qui se détourne du négatif, (comme quand nous disons d’une n’est rien, ou qu’elle est fausse, et que, débarrassé alors d’elle, nous passons sans plus à quelque chose d’autre), mais l’esprit est cette puissance seulement en sachant regarder le négatif en face, et en sachant séjourner près de lui. Ce séjour est le pouvoir magique qui convertit le négatif en être.
Texte 43 : Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris : Gallimard (Idées) p.35-37, les trois métamorphoses.
C’est trois métamorphoses de l’esprit que je vous nomme : comment l’esprit devient chameau, et lion le chameau et, pour finir, enfant le lion.
Pesantes sont bien des choses pour l’esprit, pour le robuste esprit, dont les reins sont solides, et qu’habite le respect ; c’est du pesant et c’est du plus pesant que se languit sa robustesse. Quelle chose est pesante ? ainsi questionne l’esprit aux reins solides ; de la sorte il s’agenouille comme fait le chameau, et veut sa bonne charge. Quelle est la plus pesante chose, ô vous les héros, ainsi questionne l’esprit aux reins solides, afin que sur moi je la prenne et de ma robustesse m’éjouisse ? N’est‑ce ceci : soi‑même s’abaisser pour faire mal à son orgueil ? Pour moquer sa sagesse faire briller sa folie ? Ou ceci : de sa cause se, séparer lorsqu’elle célèbre sa victoire? De hautes cimes gravir pour tenter même le tentateur ? Ou ceci : de glands et d’herbes de connaissance faire sa nourriture et, par amour de la vérité, en son âme souffrir la faim? Ou ceci : être malade et chez eux renvoyer les consolateurs, avec des sourds nouer amitié, lesquels jamais n’entendent ce que tu veux ? Ou ceci : dans une eau sale descendre, si c’est l’eau de la vérité, et froides grenouilles et crapauds brûlants de soi point n’écarter ? Ou ceci : aimer nos contempteurs et au spectre tendre la main lorsqu’il nous veut effrayer ? Tout cela, qui est le plus pesant, sur lui le prend l’esprit aux reins solides ; de même que le chameau, sitôt chargé, vers le désert se presse, ainsi se presse l’esprit vers son désert.
Mais dans le désert le plus isolé advient la deuxième métamorphose : c’est lion ici que devient l’esprit. De liberté il se veut faire butin et dans son propre désert être son maître. Son dernier maître il cherche là; de lui se veut faire ennemi, et, de son dernier dieu; pour être le vainqueur, avec le grand dragon il veut lutter. Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut plus nommer maître ni dieu ? “Tu‑dois”, ainsi se nomme le grand dragon. Mais c’est “Je veux” que dit l’esprit du lion. “Tu‑dois” lui barre le chemin, étincelant d’or, bête écailleuse, et sur chacune des écailles, en lettres d’or, brille “Tu‑dois!” De millénaires valeurs scintillent ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons : “toute valeur des choses ‑ étincelle sur moi.Déjà fut toute valeur créée, et toute valeur créée ‑ voilà ce que je suis. En vérité, de “Je veux” il ne doit point y avoir!”. Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est‑il besoin du lion dans l’esprit ? Ne suffit donc la bête aux reins solides, qui se résigne et qui respecte? Créer des valeurs neuves – le lion lui‑même encore ne le peut, mais se créer liberté pour de nouveau créer, ‑ voilà ce que peu la force du lion. Se créer liberté, et un saint Non même face au devoir; pour cela, mes frères, il est besoin du lion. A de nouvelles valeurs se donner droit ‑ telle est la prise la plus terrible pour un esprit docile et respectueux. En vérité c’est là pour lui une rapt et l’affaire d’une bête de proie. Comme son plus sacré jadis il aimait le “Tu‑dois”; encore même dans le plus sacré il ne peut trouver à présent que délire et arbitraire s’il doit à son amour ravir sa liberté: du lion il est besoin pour un tel rapt.
Mais dites, mes frères, que peut encore l’enfant que ne pourrait aussi le lion? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur encore se fasse enfant? Innocence est l’enfant, et un oubli et un recommencement, un jeu, une roue qui d’elle-même tourne, un mouvement premier, un saint dire Oui. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d’un saint dire Oui; c’est son vouloir que veut à présent l’esprit, c’est son monde que conquiert qui au monde est perdu. C’est trois métamorphoses de l’esprit que je vous ai nommées : comment l’esprit devient chameau, et lion le chameau et, pour finir, enfant le lion. Ainsi parlait Zarathoustra.
Texte 44 : Friedrich Niezsche, La généalogie de la morale, avant dernier § de la 3ème dissertation sur l’idéal ascétique.
Pour poser la question en toute rigueur: qu’est‑ce qui a donc remporté victoire sur le Dieu chrétien ? La réponse se trouve dans mon Gai savoir: « C’est la moralité chrétienne elle‑même, la notion de véracité comprise avec une rigueur croissante, la délicatesse de la conscience chrétienne affinée par le confessionnal, traduite et sublimée jusqu’à être transformée en conscience scientifique, en honnêteté intellectuelle à tout prix. Considérer la nature comme si elle était une preuve de la bonté et de la haute garde de Dieu; interpréter l’histoire à l’honneur d’une raison divine, comme preuve constante d’un ordre moral universel et d’une téléologie morale universelle; interpréter ses propres expériences de la vie, ainsi que le firent assez longtemps les hommes pieux, comme si tout n’y avait été pensé et disposé que pour le salut de l’âme comme si tout n’y était que volonté et signe de Dieu: voilà qui est désormais dépassé, contre quoi s’élève la conscience, et qui passe du point de vue de toute conscience délicate pour inconvenant, déloyal, pour du mensonge, du féminisme, de la faiblesse, de la lâcheté, ‑ c’est en cette rigueur, si ce doit être en quelque chose, que nous sommes justement de bons Européens et les héritiers de la plus longue et de la plus téméraire victoire sur soi qui fût remportée par l’Europe »… Toutes les grandes choses vont d’elles‑mêmes à leur perdition par un acte d’autodestruction: ainsi le veut la loi de la vie, la loi de la nécessaire “victoire sur soi” inhérente à l’essence de la vie, ‑ c’est toujours sur le législateur que finit par retomber l’arrêt: patere legem, quam ipse tulisti. C’est ainsi que le christianisme en tant que dogme aété ruiné par sa propre morale; c’est ainsi que le christianisme doit aller maintenant à sa ruine en tant que morale aussi, nous nous tenons sur le seuil de cet événement. Après avoir tiré conclusion sur conclusion, la véracité chrétienne parvient enfin à sa conclusion la plus lourde de conséquences, sa conclusion contre elle‑même; c’est ce qui se produira quand elle posera la question: «Que signifie toute volonté de vérité ? »… Et je touche là de nouveau à mon problème, à notre problème, chers amis inconnus (‑ car je ne me connais encore aucun ami): quel sens notre être aurait‑il dans sa totalité, si ce n’est qu’en nous cette volonté de vérité est parvenue à prendre conscience d’elle‑même en tant que problème ?… Dès lors que la volonté de vérité devient consciente d’elle‑même ‑ il n’y a pas de doute à ce sujet ‑ la morale est ruinée: c’est le grand spectacle en cent actes qui demeure réservé aux deux prochains siècles de l’Europe, spectacle entre tous le plus effrayant, le plus lourd de problèmes et peut‑être aussi le plus riche d’espoirs…
Texte 45 : Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, 3ème dissertation §15.
Le prêtre ascétique doit être pour nous le sauveur prédestiné, le pasteur et le défenseur du troupeau malade : c’est ainsi seulement que nous pourrons comprendre sa prodigieuse mission historique. La domination sur ceux qui souffrent, voilà le rôle auquel le destine son instinct, il y trouve son art spécial, sa maîtrise, sa manière de bonheur. Il faut qu’il soit malade lui-même, il faut qu’il ait une affinité foncière avec les malades, avec les déshérités pour pouvoir les entendre (…) Il apporte avec lui le baume et le remède, sans doute ! mais il a besoin de blesser avant de faire le médecin ; tout en calmant alors la douleur que cause la blessure, il empoisonne en même temps la blessure .
Textes 46 : Paul Tillich, Le courage d’être, Tournai : Casterman 1967, p.51 et 71.
C’est cette situation qui pousse le sujet anxieux à se donner des objets de crainte. L’angoisse s’efforce de se changer en crainte, parce que celle‑ci peut se rencontrer avec le courage. Il est impossible à un être fini d’affronter l’angoisse nue pendant plus d’un instant. Ceux qui ont eu l’expérience de tels moments, comme par exemple quelques mystiques dans leurs visions de la « nuit de l’esprit », ou un Luther sous le poids des assauts démoniaques, ou un Nietzsche‑Zarathoustra dans l’expérience du « grand dégoût », ont parlé de son inimaginable horreur. On esquive d’ordinaire cette horreur en transformant l’angoisse en crainte de quelque chose, quelle qu’elle soit. L’esprit humain n’est pas seulement, comme l’a dit Calvin, une fabrique permanente d’idoles, il est aussi une fabrique permanente de crainte : la première pour échapper à Dieu, la seconde pour éviter l’angoisse. Et il y a une relation entre les deux, car faire face au Dieu qui est vraiment Dieu veut dire faire face aussi à la menace absolue du non‑être.
Il est remarquable que les trois grandes périodes d’angoisse se situent chacune à la fin d’une époque. L’angoisse qui, sous ses différentes formes, est virtuellement présente en tout individu se généralise chaque fois que les structures familières de sens, de pouvoir, de croyance et d’ordre se désagrègent. Ces structures, aussi longtemps qu’elles gardent leur force, maintiennent l’angoisse prisonnière à l’intérieur d’un système protecteur de courage par participation. L’individu qui participe aux institutions et aux manières de vivre d’un tel système n’est pas libéré de ses angoisses personnelles, mais il a les moyens de les surmonter par des méthodes bien connues. Mais dans les périodes de grands changements ces méthodes n’opèrent plus. Les conflits qui surgissent entre l’ancien système qui essaye de se maintenir, ‑ souvent avec des moyens neufs, ‑ et le nouveau qui dépouille l’ancien de son pouvoir intrinsèque, engendrent l’angoisse sous toutes ses formes.
Texte 47 : Michel Serres, « le savoir, la guerre et le sacrifice », in Critique n°367-Déc.1977, p.1070-1071.
Je crois que nos sociétés sont très vieilles, je parle des sociétés européennes. Qu’elles sont toujours structurées, en profondeur, un peu de la même manière qu’aux moments très anciens de leur formation. Georges Dumézil a découvert cette organisation, constante sur une aire étendue, de l’Oural à l’Irlande, de l’Inde à la Scandinavie. Elle présente trois fonctions: celle de Jupiter, prêtre et juge, celle de Mars le guerrier, celle de Quirinus, le producteur. On voit partout, dans les textes, dans les institutions, et dans les habitudes, des restes, marques et traces, de l’antique partage. Lorsqu’est né le savoir positif, exact, rigoureux, les mathématiques, la physique etc… est né, en même temps un pouvoir : un pouvoir technologique, la promesse d’une possession et d’une maîtrise du monde, et un pouvoir politique, la possibilité d’une domination des hommes, d’une domination nouvelle, autrement que par la terreur mythique, la force armée, ou l’économie de la production, autrement mais aussi par récupération totale des trois fonctions. Car le savoir donnait lui‑même lieu à une nouvelle psychagogie, à une autre pédagogie, à une puissance accrue, à une économie plus féconde. L’apparition, l’émergence de ce nouveau pouvoir se produisaient au sein de sociétés depuis longtemps stabilisées par le partage tri-fonctionnel : Jupiter, Mars, Quirinus. Tant que le groupe des savants ne fut par trop nombreux, tant que le rôle social, économique et politique de la science ne fut que marginal, le problème de l’attribution d’un pouvoir n’eut pas à se poser. On vit le savant serviteur de Mars, comme Archimède au siège de Syracuse, on le vit aux côtés du tyran, comme Platon lui-même chez Denys, on le vit glisser de fonction à fonction, indépendant et « libre » parce que d’importance médiocre et momentanée. Au contraire, dès que la modernité voit la science grecque pure descendre du ciel sur la terre, s’occuper de la chute des corps, c’est‑à‑dire de balistique, de boulets de canon. de conduite des eaux et de technologie, le problème, grave, apparaît, du logement du groupe des savants dans l’espace socio-politique déjà partagé depuis des millénaires. Une quatrième fonction cherchait sa place parmi les trois autres. D’où les réactions de rejet, l’affaire Bruno, l’affaire Galilée, l’affaire Spinoza, les affaires de la grande encyclopédie. Le nouveau pouvoir menaçait dans son existence et sa place la première fonction, celle de Jupiter, qui était la seule des trois à détenir un savoir archaïque. Et celle‑ci se défendait. Réciproquement, le nouveau pouvoir, aveugle sur ses objectifs, se trouvait entraîné, par la lutte elle‑même, à ne faire que revendiquer la place de son adversaire, sans jamais chercher à savoir si ce lieu traditionnel était adéquat ou propre à son activité. Manquant d’un site original, il tentait d’occuper un terrain déjà reconnu et marqué. A partir de la révolution industrielle et surtout à partir de l’Ecole française, issue de la Révolution et de la grande encyclopédie, dates où les savants se rapprochent, en groupe et comme tel, du niveau de la décision politique, la bataille n’a plus qu’une issue : le remplacement des prêtres par les nouveaux clercs. L’idéologie scientifique se substitue à l’idéologie religieuse. Quand deux éléments sont substituables, en laissant sauf l’état des choses, on dit avec raison qu’ils sont identiques.
Exercices
- Dans l’interminable débat entre Hegel et Kant, avez-vous envie de prendre partie, dans quel sens et pourquoi ? Où chacun d’eux est-il le plus fort ?
- En quoi Rousseau est-il un auteur « critique » ?
- Que pensez-vous de ce que Hegel écrit de la mort ?
- Prenez les textes 38,39 et 41, et cherchez à établir entre eux une « dialogique ».
- Les textes de Nietzsche présentent à chaque fois une sorte de « dialectique ». Pouvez vous les expliciter ?
- Paul Tillich affirme que le stoïcien est le véritable adversaire du chrétien : qu’en pensez–vous ?
- Par quel travail passe-t-on de la résurrection à la damnation ? en quoi est-ce « le même énoncé » ?
- En suivant les indications de M.Serres, que se passe-t-il pour la religion au moment de la Réforme ?
Reprise des questions sur l’ensemble des textes :
-
- Essayez d’exprimer en une phrase ce dont il est question dans chacun de ces textes, et quel en est le « domaine ». Essayez d’exprimer par un schéma et quelques mots la « problématique » que chacun de ces textes construit (la manière dont les notions sont opposées, corrélées, mises en analogie ou en série, etc). Notez en passant les concepts, les petits modèles d’analyse, les formulations, dont vous pensez qu’ils vous seront utiles (et que vous gardez dans votre « boîte à outils »).
- Tentez de vous exercez, avec un ami, à la reconnaissance de textes dont vous auriez caché la signature. Un autre bon exercice consiste à se pénétrer d’un ou deux textes d’un auteur, et de tenter de rédiger un petit texte « à la manière de… ».
2. Dissertations
Voici quelques recommandations élémentaires pour faire une dissertation. Mais il n’y a pas de modèle, pas de théorie à la hauteur de l’exercice pratique (un peu comme on apprend à nager), et c’est en le faisant qu’on apprend à le faire. Relisez le texte sur la confiance en soi de Emerson ; c’est ce plaisir que vous devez éprouver et faire sentir que vous éprouvez. Ne vous cachez pas derrière une culture philosophique, pensez tranquillement par vous-même.
- Le sujet donne déjà des informations, un début de problématique, une manière de poser la question. Notez-les.
- Tentez de revenir de là à la question qu’il pose ainsi, aux questions implicites qu’il contient ou à celles qu’il soulève, bref aux différentes « pointes » du sujet. Tournez-le sous ses jours les plus surprenants. L’introduction est destinée à fomuler cette surprise avant que d’annoncer les grandes lignes de votre plan.
- Jetez sur une feuille le maximum d’idées ayant trait au sujet, sous tous ces aspects, et espacez-les sur le même plan pour les avoir ensemble sous les yeux.
- Allez à la recherche d’informations sur le sujet, lisez (dico —mais ne commencez pas par des plates définitions juxtaposées, cela tue le mouvement— histoire de la philo et textes de philosophes, romans, théâtre , parlez avec des amis, etc.)
- Colorez ce qui vous paraît faire partie du même ensemble.
- Tracez un plan, un itinéraire, dans lequel vous devez ménager des surprises, des détours, des retournements. Il faut chercher la ligne de plus haute problématicité, qui donne le texte le plus vivant. N’hésitez pas à ne pas tenir compte de tout ce que vous avez trouvé si c’est trop éloigné, trop tiré par les cheveux
- Essayez d’autres plans avant de vous arrêter à celui qui vous semble le meilleur, c’est à dire qui épouse le mieux le contenu de ce que vous sentez que vous avez à dire. Le plan n’est pas un moule extérieur (sur une pensée mollusque) c’est la découverte que vous faites de l’ordre et de la cohérence intime de votre pensée, du fait qu’elle est articulée.
- Ne rédigez pas entièrement au brouillon, sauf l’introduction. Rédigez directement d’après un plan détaillé (pour trois heures, une heure de plan et deux heures de rédaction définitive, par exemple). Laissez-vous éventuellement porter par les embarras (que vous pouvez raconter, essayer d’analyser) ou les nouvelles idées rencontrées au cours de votre rédaction.
- La conclusion (pas obligatoire, car parfois on s’arrête simplement sur une dernière interrogation) revient sur les principales questions soulevées, pour manifester que l’on sait que l’on n’a pas répondu à tout, mais qu’on a quand même clarifié ou déplacé une ou deux questions.
Parmi les sujets suivants, vous pouvez en choisir un pour une dissertation rédigée (faites–la en temps limité: 3h, et d’une longueur limitée : 4000 signes ou 700 mots), soit proposez cinq plans de dissertation (pas plus de 30mn de travail pour chaque plan).
- « Après moi le déluge ».
- Nietzsche écrit : « les pensées les plus précieuses apparaissent à la fin, mais les pensées les plus précieuses ce sont les méthodes ». Qu’en pensez–vous ?
- Une thèse qui pourrait être soutenue par plusieurs argumentations contradictoires peut–elle être soutenue par l’une de ces argumentations ?
- La Parole, l’Ecriture, le Silence.
- Le sommeil, est-ce le contraire de la pensée ?
- Dieu peut–il « vouloir » quelque chose ?
- La conjugalité est-elle compatible avec la filiation ?
- On fait souvent l' »historique » d’une question : pourrait–on en faire la « géographie »?
- « Les dieux sont morts. Oui, ils sont morts de rire en entendant l’un d’eux dire qu’il était le seul ». Que pensez–vous de cette phrase de Nietzsche ?
- « Il se pourrait, créatures terrestres qui avons commencé d’agir en habitants de l’univers, que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c’est à dire de penser et d’exprimer, ce que nous sommes cependant capables de faire » (Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, prologue). Qu’en pensez-vous ?
- La fin du monde.
- Marcel Gauchet parle du Christianisme comme de « la religion de la sortie de la religion »; pourrait–on parler du « savoir de la sortie du savoir », et quelle en serait la figure ?
- Le temps, le moi, et l’autre.
- « Tout mal commis par l’un est mal subi par l’autre. Faire le mal, c’est faire souffrir autrui. La violence ne cesse de refaire l’unité entre mal moral et souffrance ». Que pensez–vous de cette proposition de P.Ricoeur ?
- « La douceur évangélique ».
- Kierkegaard écrit : « Comment la médiocrité interprète la Bible. Elle interprète sans cesse les paroles du Christ, tant et si bien qu’elle en tire ce qui la caractérise, la banalité sans nul accent spirituel —dès lors toute difficulté étant écartée, elle est tranquillisée et se prévaut des paroles du Christ. Il échappe complètement à la médiocrité qu’ainsi surgit une nouvelle difficulté, la plus ridicule que l’on puisse imaginer (…) comment expliquer que Christ ait pu être crucifié, car en ce monde de la banalité on n’a pas coutume de ounir de mort la pratique de banales remarques» (Remarques brèves dans « l’instant », Œuvres éd. de l’Oronte tome 19, p.215). Réagissez avec sincérité.
- Le possible comme catégorie technique et comme catégorie éthique.
- La réalité est–elle, finalement, ce qu’il y a de mieux ?
- Quel courage « répondra » à l’angoisse de l’absurde ?
Exemples (ce ne sont pas des modèles, mais pour donner une idée de ce que je demande ici —en effet une dissertation classique, cinq fois plus longue que ce genre de petit essai, doit se faire avec de véritables notes en bas de page et une structure plus détaillée) :
Le sommeil, est-ce le contraire de la pensée ?
Les philosophes sont souvent perçus comme de pures consciences, toujours claires et toujours actives, et Kant remerciait Hume de l’avoir réveillé de son « sommeil dogmatique ». Prenant le contrepied d’une telle idée, je proposerai ici un éloge du sommeil, et plus précisément un éloge de la pensée rapportée au sommeil —soit dans une opposition bien rythmée, soit dans l’existence certaine d’une pensée en dormant. Ne faut-il pas s’endormir sur une question, la laisser travailler en dormant, pour pouvoir faire cette expérience si bien décrite par Platon, qu’
« Ainsi donc, chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant telles choses qu’il se trouve ne pas savoir, des pensées vraies concernant ces choses mêmes qu’il ne sait pas. Et à présent, ces pensées, elles viennent de se lever en lui, à la manière d’un rêve »[38].
Car si je dis éloge du sommeil, évidemment nous sommes tous d’accord. Qui ferait l’éloge de l’insomnie? Et pourtant nous avons apparemment perdu le secret du sommeil, comme nous avons perdu le secret de l’action éveillée. En même temps peut-être, puisque simultanément il nous faut autant de drogue et d’adjuvants pour le moindre repos comme pour le moindre effort. Pour suppléer aux deux millions de boîtes de somnifères consommées chaque mois dans notre pays (et nous jetons la pierre à notre jeunesse désemparée ou à nos coureurs cyclistes!) je pourrais faire un éloge moral du sommeil, en faire un art, une sagesse, une religion. Mais je ferais alors ce que Nietzsche, au début de son Ainsi parlait Zarathoustra, reproche aux professeurs de vertu: de faire de la morale un traité du bien-dormir. On dort mieux si on n’a pas tué, si on n’a pas volé, si on est réconcilié avec son adversaire, si on ne fait pas des acrobaties pour tromper son voisin avec sa femme, etc. Il faut cependant accorder à son professeur de sommeil un grain de sagesse: on a parfois des motifs d’insomnie qu’il vaut mieux avoir résolus avant de se coucher. L’insomnie n’est-elle pas l’indice de celui ou celle qui n’a pas la conscience tranquille, qui est trop occupé par la conscience qu’il a de lui-même?
Pas toujours. Le philosophe Emmanuel Lévinas, dans De l’existence à l’existant, parle au contraire de l’insomnie comme d’un envahissement par le bruissement de l’être d’où l’on ne peut se retirer ni s’absenter, même en se mettant en boule dans un coin: on veille pour rien, sans objet, mais sans véritable conscience non plus, roulant sans fin dans une sorte de présence où rien ne passe. Cela, direz-vous, mais c’est le bonheur, si vraiment enfin tout est présent! Quand on pense à tout, d’ailleurs, le plus souvent on s’endort heureux; et plus généralement quand on pense on s’endort assez vite. Mon conseil pour dormir, pour autant que penser ne soit pas penser à une chose mais au moins à deux en même temps: non pas de ne penser à rien, de faire le vide (aussitôt rempli par le bruissement dont parle Lévinas), mais au contraire de penser à tout. Car précisément c’est parce qu’on est conscient, parce qu’on pense, et plus bêtement parce qu’on a une certaine activité cérébrale que l’on dort. Ce qui peut nous sortir de l’insomnie anxieuse comme de l’activisme fébrile et vain, c’est ce rythme. Jamais il ne pourra être vigilant, celui que l’on a tenu sans cesse sur le qui-vive pour des riens, et que l’on a empêché de dormir, dans une mobilisation et une conscientisation de tous les instants qui finit par le laisser incapable d’une véritable action éveillée. Et jamais il ne pourra s’endormir, se laisser gagner par une bienheureuse fatigue, celui que l’on occupe tellement qu’il n’a plus de marge d’action à lui, qui lui donnerait le sentiment que sa fatigue est bien la sienne, qu’il est fatigué par son action propre. Et les deux processus se renforcent, car celui qui a peur de se réveiller, de se réveiller vraiment, on comprend qu’il ait peur de s’endormir.
Plus il y a conscience claire et active, plus il y a tranquillement sommeil. Les lichens dorment probablement assez peu. Les poissons déjà davantage, quoique d’un sommeil tout autre que le nôtre. Arthur Schopenhauer, qui fut le maître de Nietzsche, estime que les grands génies ont besoin d’une quantité de sommeil inhabituellement importante, un peu comme les enfants dont l’intelligence se forme. C’est dire si la pensée ne s’oppose pas au sommeil : elle lui est corrélative… Mais pour accepter cela, encore faut-il ne pas avoir peur du sommeil, de l’ensommeillement; ne pas avoir peur de perdre le maîtrise de nos expressions faciales, de perdre le fil de cette continuité narrative par laquelle nous nous assurons, parfois à bon compte, que nos existences sont bien uniques de bout en bout, bien individuées, bien clairement et distinctement nôtres. Dans le sommeil tout cela est bien moins clair. Schopenhauer pensait que dans le sommeil nous sommes au plus proche du noyau de notre être, de ce noyau de désir et de vouloir-vivre par lequel nous poursuivons le désir de nos prédécesseurs, et par lequel nous comprenons et participons de tout ce qui, proche ou lointain, enfants, génies, poissons, lichens, désire être. Cet éloge-là du sommeil nous le rend bien plus attendrissant que les vertus couronnées de pavot dont Nietzsche montrait le ridicule, et qui font du sommeil le lieu où nous croyons enfin être définitivement à l’abri de la rumeur du monde. Seul est bon à prendre la sommeil où nous ouvrons la fenêtre à cette rumeur, pour nous oublier en elle, et simplement y songer un peu.
La conjugalité est-elle compatible avec la filiation ?
La famille se trouve placée devant un problème particulièrement délicat et difficile: comment articuler conjugalité et filiation? D’une part nous avons l’exigence d’établir une véritable égalité des sexes, et d’autre part celle de respecter une irréductible différence de génération. C’est peut-être la difficulté de la famille aujourd’hui, ce qui en fait un lieu « tragique », que de parvenir à nouer conjugalité et filiation, tant chacun de ces liens a son génie propre, sa symbolique spécifique, et tant l’une suppose le travail de la symétrie quand l’autre voudrait la prise en compte de l’assymétrie. Cela supposerait de distinguer et d’articuler deux dimensions de l’institution, l’une horizontale, dans le conflit possible et l’alliance toujours à réinterpréter, et l’autre verticale, dans la durée et la protection du « petit » que demande la filiation.
La première pose le mariage comme une alliance entre individus égaux, où la conjugalité n’est plus subordonnée à la filiation, mais peut être vécue comme une sincérité, une fidélité, un plaisir libres. Cette libre-alliance brise l’assujetissement des femmes à leur rôle dans l’économie de la filiation. C’est ce que chantait le grand Milton dans son plaidoyer pour le divorce, et les cultures protestantes ont souvent bataillé en ce sens. Pour aller jusqu’au bout de cette grande idée il faut refuser la séparation entre des passions désinstituées et une institution matrimoniale utilitaire, qui pareillement nient le temps et la possibilité des conflits conjugaux; et proposer le mariage comme institution du sentiment, comme acte civil qui institue l’égalité et fait de l’amour une courtoisie, une capacité poétique à se fixer des règles et à les réinterpréter à deux au long de la vie.
Peut-on cependant, à l’inverse d’une tradition millénaire, subordonner entièrement le lien de filiation, qui n’est pas un contrat, au lien d’égale et libre-conjugalité? Un enfant n’est-il qu’un adulte miniature, auquel on demande de « consentir »? C’est ici qu’apparaît la seconde dimension de toute institutionalité, qui tient à la génération, à la durée qui précède et excède le consentement individuel: car la filiation doit être « autorisée », comme une juste dissymétrie des droits et devoirs. La justice ici travaille à contresens de l’ordinaire: elle doit interdire la symétrie, rappeler la différence des générations. La tradition catholique a une grande culture de ce type d’institutionalité. C’est cette institution de la filiation qui permettra d’échapper à l’alternative ruineuse entre la réduction de la généalogie à la génétique, et sa dissolution dans le modèle du libre-consentement.
Ce que je me demande, c’est comment nouer l’autonomisation du sujet que suppose la conjugalité, et l’institution de la filiation. Car ce qui est délicat, c’est qu’il faut faire place ici à la différence des sexes, et là à l’égalité des personnes. Car les adultes sincères et consentants sont aussi des êtres fragiles et dissymétriques, portant dans leurs amours la trace de leur enfance. Et que sont des enfants qui jamais n’en viendraient à s’émanciper, à prendre leur autonomie? Ce que je vois, c’est la complicité vicieuse entre le rêve d’une Autorité qui tient ses ouailles en enfance, et le triomphe des petits sujets-rois qui font tous leurs caprices et ne sont même plus des individus. Ce que je voudrais, c’est la corrélation vertueuse entre une institution qui sache faire place à l’autonomisation des sujets, et des sujets qui sachent venir d’une enfance et s’inscrire dans la génération, c’est à dire dans un monde plus durable qu’eux-mêmes. Et ce que je décris c’est peut-être l’idée d’une conjonction oecuménique où nous avons encore beaucoup à apprendre les uns des autres.
Plaidoyer pour l’indulgence philosophique
Pendant que j’écris ces lignes, des milliers de lycéens planchent sur leur copie de philo du baccalauréat. Pour ma part, je pense en ce moment beaucoup à eux. Non pour compatir à leur peine, mais pour me réjouir de toutes les pensées qui sont en train d’éclore. J’en ai le sentiment et presque la sensation, comme si chacune de ces idées émettait une onde de joie spécifique. D’abord oui parce qu’une idée est toujours un joie, joie de pousser plus loin et d’aller voir de l’autre côté, joie de revenir au même mais tout autrement, joie de voir une différence là où on mélangeait tout, joie de voir une ressemblance où l’on n’en avait jamais vu. Ensuite parce qu’un être qui pense, en tant qu’il pense, est heureux. Si seulement on pouvait ne jamais perdre ce contentement d’être simplement et tranquillement au bonheur de sa propre pensée ! Oser suivre docilement son plaisir de penser, et ne pas céder sur ce plaisir ! Enfin parce qu’on ne peut penser sans désirer partager ses idées, et que les pensées demandent à être communiquées, à être partagées. Comme toutes les joies, elles sont communicatives, et le plaisir de penser est indissociable du plaisir de « communiquer son plaisir aux autres », comme le dit Kant dans sa Critique de la faculté de juger. On voudrait alors s’adresser au monde entier, et pour Kant, la civilité « exige de chacun qu’il tienne compte de cette communication universelle en raison d’un contrat originaire pour ainsi dire, qui est dicté par l’humanité elle-même » et elle « n’accorde de valeur aux sensations que dans la mesure où elles peuvent être universellement communiquées ».
C’est justement pourquoi la pensée est toujours un peu tremblante, car la communication d’une joie n’est pas imposable à autrui. Elle dépend de la manière dont l’autre va la recevoir. Mon plaisir de pensée dépend du plaisir de l’autre à la partager. On peut ne pas parvenir à partager un tel plaisir, et sentir que l’idée qui vient de faire notre bonheur ne dit rien à celui ou celle à qui on voulait la partager. Quelle déception alors, quelle tristesse, quelle haine peut-être ! Mais la civilité, la civilisation, c’est justement aussi l’acceptation que l’on ne puisse pas forcer quelqu’un à avoir du plaisir. Cette prise en compte des difficultés qu’il y a à penser ensemble, à partager les idées, détermine justement un élargissement des capacités de communiquer. Elle nous fait mieux accepter de participer aux pensées des autres, de les saluer au moins, même si on ne sait pas encore si leurs bonheurs sont compatibles ou non avec les nôtres. Elle nous amène à nous y prendre mieux pour faire part de notre propre plaisir de penser, sans bouder notre plaisir mais sans vouloir en faire une vanité, un objet d’envie, ni d’approbation unanime. Et ce travail de la pensée et de l’imagination sera toujours au foyer de la communauté humaine, rien jamais ne pourra le faire à notre place.
Telle est la grandeur de la dissertation philosophique, de donner à chacun l’occasion d’éprouver ce plaisir. Un plaisir libérateur de confiance en sa propre pensée, un plaisir assez civil pour se confier au jugement des autres. Et un bon sujet est comme la règle ingénieuse d’un jeu d’échecs ou de cartes, ayant incorporé assez d’expériences pour libérer un vrai espace d’improvisation. Lorsqu’on creuse soi-même ses propres questions, en élargissant le cercle, on découvre aussi peu à peu que l’on peut en faire le tour, que ce n’est pas un horrible infini ; on découvre que personne n’est définitivement plus avancé que les autres, et on se sent soudain contemporain. C’est une injustice révoltante que cette occasion ne soit pas donnée bien plus tôt, et à tous les écoliers. C’est aussi une injustice terrible, que cette loterie par laquelle les lycéens tombent sur un « bon » ou un « mauvais » prof, puisque la philo ne dure qu’une année —et encore nous avons de la chance en France, c’est l’un de nos luxes. La classe de philo peut alors n’être plus qu’un vaccin, après lequel on sera définitivement immunisé aux idées philosophiques, insensible et comme amputé d’une forme essentielle de plaisir. Mais ce qui me révolte le plus, c’est d’imaginer d’avance la pluie de mauvaises notes en philo au baccalauréat, de jugements persifleurs sabrant les copies. Sans chance de recommencer, sans encouragement à poursuivre. Et si le baccalauréat est l’un de nos rites de passage, alors la fréquente sévérité des correcteurs (j’en ai été) est comme un rite d’excision. C’est une pratique qui ne stérilise sans doute pas la philosophie, mais en ôte le plaisir, la saillie, la pointe subversive et vivante, l’un des seuls trésors qui nous restent, le simple plaisir de penser.
Cinquièmes éléments.
Poétique de l’interrogation
Du questionnement comme technique et méthode pour approcher les situations ou les textes, on arrive ainsi à de tout autres rivages, plus méditatifs, où l’interrogation pure et presque poétique fait le chemin vers un autre monde, un autre sujet. À plusieurs reprises nous avons vu à l’oeuvre ce « travail », au sens d’un enfantement, qui fait de la problématisation une métaphorisation, et de la métaphorisation une problématisation. Mais ce n’est pas le même travail qui s’opère dans les figures qui problématisent le sujet et dans celles qui problématisent le monde. Nous voudrions esquisser ce double travail de l’humour qui se rapporte à soi et de l’ironie qui porte sur un monde. Car ce n’est pas le même cercle, celui au milieu duquel on s’avance pour faire son numéro et chercher à dévoiler « qui » on est, et celui par lequel on se tient ensemble à distance d’une question où chacun s’oublie.
Sur ce chemin qui ne se sépare pas de sa vérité (l’interrogation fraye un passage de la méthode à la vérité par la reconnaissance de l’ignorance), nous pouvons suivre le travail de deux dialogueurs: Socrate et Jésus. Ce n’est pas un hasard si l’un et l’autre répondent souvent par des questions. Mais ce sont des questions qui accouchent l’interlocuteur et qui enfantent un autre monde.
Leçon 10
Rhétorique, herméneutique, poétique le travail de la métaphore
Entre ces trois grandes disciplines, il y a des différences et des recoupements. Les différences sont ainsi exposées par Ricoeur :
« La rhétorique reste l’art d’argumenter en vue de persuader un auditoire qu’une opinion est préférable à sa rivale. La poétique reste l’art de construire des intrigues en vue d’élargir l’imaginaire individuel et social. L’herméneutique reste l’art d’interpréter les textes dans un contexte distinct de celui de leur auteur et de leur auditoire initial, en vue de découvrir de nouvelles dimensions de la réalité »[39].
La métaphore est, conjointement avec l’interrogation, l’un des moyens de penser le recoupement de ces disciplines. Ricoeur présente la métaphore vive (pas les métaphores sédimentées et usuelles comme le temps c’est de l’argent, mais par exemple « le temps est un mendiant » de Shakespeare) comme une prédication impertinente, c’est à dire une attribution qui crée une tension entre des sphères sémantiques qui résistent à leur rapprochement. Or, tout se passe comme si l’impertinence la plus vive était ce qui réinterprète le plus vivement la tradition la plus endormie, la plus enfoncée sous la sédimentation des usages ordinaires. C’est ici le propre de la refiguration du monde dont nous avons parlé. Les créations les plus inédites rouvrent les métaphores les plus archaïques. Et la vivacité d’une question peut réveiller une question que l’on croyait depuis longtemps résolue et révolue.
Or on peut penser la métaphore vive en termes de question et de réponse, et la vivacité de la métaphore comme le choc dans le même énoncé entre des propositions de monde plus ou moins incompatibles. Ce choc « suspend » le sens ordinaire des termes dans l’énoncé, et oblige l’imagination sémantique à faire des rapprochements inédits. Cela évoque aussi Wittgenstein s’étonnant que la signification puisse en quelque sorte agir à distance, que l’usage d’un mot puisse être étendu à ce qui lui ressemble, et que cela soit compris.
La métaphoricité tient à cette compossibilité de « mondes » hétérogènes dans un autre monde, plus « tensif » peut–être mais aussi plus réel. On peut ainsi parler d’une référence tensive, où la métaphore répare en quelque sorte la perte de singularité occasionnée dans le langage par l’attribution de prédicats. La condensation en un seul énoncé métaphorique de plusieurs énoncés tient suspendue la question de savoir si les deux mondes évoqués sont ou non compossibles. Mais il y a alors un travail de la référence, où le questionnement (qui, quoi) relance sans cesse l’identification du référent, ou sa réidentification dans des mondes différents.
La rhétorique des accords et des différends entre contemporains, l’herméneutique de la réinterprétation des traces laissées par les prédécesseurs, sont ici toutes les deux comme débordées par une poétique.
On a vu que l’interprétation ne peut pas s’installer sans reste dans un projet d’explicitation des questions implicites: on ne peut pas thématiser toutes les problématiques de précompréhension qui se trouvent en arrière de nos usages. Il y a des métaphores déposées, toute une épaisseur de préfiguration où le langage se confond avec l’affectif et le corporel, et qu’on ne peut pas entièrement expliciter.
C’est probablement ce qui fait la réserve de Ricoeur envers l’entreprise de Habermas: on doit accepter l’existence d’expériences, de questions, de convictions non explicitables entièrement et qui résistent dans la même proportion à l’argumentation. Il y a me semble–t–il un second motif, c’est que la mimésis poétique, à la différence de l’argumentation rhétorique qui s’adapte aux présuppositions de son auditoire, ne vise pas moins qu’à remanier et à bouleverser ces présupposés, cette préfiguration:
« La conversion de l’imaginaire, voilà la visée centrale de la poétique. Par elle, la poétique fait bouger l’univers sédimenté des idées admises, prémisses de l’argumentation rhétorique. Cette même percée de l’imaginaire ébranle en même temps l’ordre de la persuasion… »(L2 p.487).
Si la visée poétique est de changer le monde, elle ne peut le faire que parce que les attentes propres du texte et son monde viennent bouleverser, suspendre et réorienter les attentes préalables du lecteur, qui change ainsi de monde. Mais comment est-ce possible ? Peut-on changer de monde ?
Leçon 11
Socrate et Jésus selon Kierkegaard.
Voici deux incontestables « auteurs » qui n’ont pas laissé d’écrits. Où donc est leur oeuvre? On pourrait pointer de nombreuses ressemblances, et autant de différences profondes entre Socrate et Jésus, mais l’un et l’autre pratiquent l’ironie en questionnant davantage qu’ils ne répondent. Et l’un et l’autre sont morts de telle sorte qu’une apparence de justice s’est déchirée. Parmi les premiers témoins, enfin, deux ont commencé par trahir.
11.1) Socrate:
a) L’ironie et le dialogue socratique :
L’ironie socratique ne peut être séparée de celle de Platon, car c’est du même mouvement que l’on peut lire dans le dialogue Hippias majeur (où Platon est encore très proche de Socrate) :
« Hippias : — Ce qu’est le beau, je vais lui répondre et je ne risque pas d’être jamais réfuté par lui ! À parler franc, une belle jeune fille, sache le bien, voilà qui est beau ! Socrate : — Belle réponse, par le Chien, Hippias, (…) mais mon bonhomme demandera alors « et une belle marmite, n’est-ce pas une belle chose ? » Hippias : — qu’est-ce que cet homme (…) qui sur un si noble sujet use de termes aussi vils ? Socrate : —c’est comme ça qu’il est, Hippias, pas distingué, vulgaire au contraire, n’ayant d’autre souci que celui du vrai » (Hippias maj, 288)
Et dans le dialogue Le Parménide (bien après la mort de Socrate), où Platon fait dialoguer le vieux sage Parménide et le jeune Socrate qui vient d’exposer sa théorie des idées :
« Parménide —Tu crois donc qu’il y aurait des idées en soi du juste, du bon, etc. ? Socrate —Oui. —Et tu crois aussi qu’il y aurait des idées de choses comme le poil, la poussière, la saleté ? —Certes non ! —C’est que tu es encore un peu jeune, Socrate, reprit Parménide… » (Le Parménide, 130-c).
Cette ironie se manifeste par un retournement de la situation :
« Il est possible en effet que nous ne sachions ni l’un ni l’autre rien de beau ni de bon. Mais lui il croit qu’il en sait, alors qu’il n’en sait pas, tandis que moi, tout de même que en fait je ne sais pas, pas davantage je ne crois que je sais ! J’ai l’air en tout cas d’être plus sage que lui au moins sur un petit point, celui–là précisément : que ce que je ne savais pas, je ne croyais pas non plus le savoir ! (…) Peu s’en fallut que ceux qui avaient la plus belle réputation ne fussent à mon avis ceux qui manquaient le plus de sagesse, alors que d’autres qui passaient pour valoir moins étaient des hommes convenablement doués sous le rapport du bon jugement »[40].
L’ironie socratique est cette puissance qui transmute la réponse en question et la question en réponse. Avec ce double déplacement c’est le monde entier qui tremble et se dédouble entre un monde apparent et un monde réel. L’ironie détruit le monde de l’apparence. Mais quel est cet autre monde? Quel est le sujet capable de résister (ou d’apparaître) à (ou avec) cette destruction?
b) L’anamnèse; quand interroger c’est savoir :
Ce qui résiste à la destruction, ou ce qui apparait au terme de ce terrible travail de l’interrogation, c’est un soudain ressouvenir, une « réminiscence ». Nous nommerons ainsi ces moments surprenants où nous nous disons, dans le sentiment pourtant d’une certitude toute simple et toute neuve: « ça, je le savais! » Même un enfant esclave (le comble de la supposée ignorance) peut « reconnaître » la suite des opérations qui constituent le théorème de Pythagore:
« Ainsi donc, chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant telles choses qu’il se trouve ne pas savoir, des pensées vraies concernant ces choses mêmes qu’il ne sait pas. Et à présent, ces pensées, elles viennent de se lever en lui, à la manière d’un rêve » (Ménon 85–c).
La réminiscence est ce point où l’ignorance est le lieu du savoir; ce point où la question est assez précisée, assez claire, pour être déjà une réponse.
c) Y–a–t–il un objet du dialogue ?
On dira que l’objet du dialogue c’est l' »idée » (de beauté, de justice, de vertu, de multiplicité et d’unité, mais pourquoi pas aussi de poil, de crasse, de boue, etc). Remarquons tout de suite, contre un certain platonisme scolaire, que les idées ne sont pas des réalités séparées (quelque part dans un « monde des idées ») mais des identités sémantiques, des significations invariantes (substituables). Les idées répondent à un problème qui n’est pas métaphysique mais métalinguistique:
« Quel que soit l’objet dont on délibère, un unique point de départ permet de s’en bien tirer : c’est obligatoirement de savoir ce qu’est l’objet sur lequel on délibère ; autrement, c’est forcé, on manque complètement le but (…) se figurant le savoir, ils ne se mettent pas en peine d’un accord au point de départ de la recherche et, à mesure qu’ils y avancent, comme de juste ils le paient, puisqu’ils ne s’accordent ni avec eux–mêmes ni entre eux ! » (Le Phèdre 237–c).
L’idée, en ce sens, c’est simplement la question : de quoi parle–t–on? Quelque belle que soit une réponse, elle est rapportée à son usage: à quelle question répond–elle exactement? La dialectique met l’interrogation au centre du cercle. Et rien ne justifie jamais l’arrêt du dialogue, sinon la lassitude ou la politesse.
11.2) Jésus:
Jésus n’est pas qu’un maître ni tout à fait sceptique ni tout à fait cynique du dialogue et de l’entretien socratique, où la mise en scène et en question des interlocuteurs les oblige et les autorise à changer de point de vue, et où l’interrogation ne met fin à la croyance en ce monde que pour accoucher d’un monde autrement crédible. C’est tout autant : 1) Un rabbin talentueux, interprète très singulier de la Loi de Moïse, exigeant la justice totale pour chacun, et manifestant que sur les bords la Loi ne répond pas à toutes les questions. 2) Un chorégraphe organisant ses déplacements dans l’espace et le temps comme une liturgie, et dont la biographie est déjà une légende dorée, un parcours d’étapes sur le chemin de la vie. 3) Un homme divin, un thaumaturge, un guérisseur, capable de faire des miracles, de faire faire l’inattendu, de délivrer du mal. 4) Un Messie, stratège libérateur d’Israël et chassant les marchands du Temple, mais qui se laisse juger et condamner sans appeler les armées célestes, et ses troupes se dispersent consternées. 5) Un moraliste subtil, tendre et cynique, un fabuliste familier et drôle dont les propos de table indiquent la sagesse du Royaume de Dieu, son éblouissante proximité. Ici je m’attarderai avec Kierkegaard sur la première figure.
a) L’interrogation retournée, et la réponse suspendue :
Le travail de retournement opéré par l’ironie socratique se retrouve dans les ironies de Jésus, qui sont fréquentes. En Jean 9 (39–40), l’évangéliste met en scène un Jésus qui répond à des Pharisiens (ne pas oublier que les pharisiens sont, comme les sophistes pour la philosophie, un type, une posture dans le discours —nous sommes tous pharisiens comme nous sommes tous sophistes) :
« je suis venu en ce monde pour que voient ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugle. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent et lui dirent : « sommes-nous des aveugles nous aussi ?» Si vous étiez des aveugles, vous seriez sans péché ; mais vous dites : nous voyons! Ainsi votre péché demeure » (9, 39–40).
Dans l’épisode de l’impôt dû à César (Mt 22, 15–22), où Jésus répond à une question par une autre question, il déplace la question. Ce faisant, il brise la problématique entière des Pharisiens et des Hérodiens qui cherchaient à le prendre au piège: il brise leurs « arrières–pensées », il répond à leur murmure (Jn, 6 41–61). C’est aussi ce que l’on trouve en Luc 14 (1–6) :
«il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit : « lequel d’entre vous, si son fils ou son bœuf vien tà tomber dans un puit, ne l’en tireras aussitôt, le jour du Sabbat ? » Et à cela ils furent incapables de rien répliquer »
Si le questionnant se retrouve questionné, c’est parce que l’ironie de Jésus radicalise sa question même qui était jusque là une question positive, une question mûe par le savoir de la réponse: Jésus retourne à l’interlocuteur sa propre interrogation mais dénudée, il le renvoie à un silence perplexe. On pourrait dire que Jésus le renvoie, dépouillé de réponse, à sa responsabilité infinie.
b) La parabole, où le Royaume est celui qui..:
Ce qu’on trouve dans toutes les paraboles, c’est une mise en scène de situations ordinaires, qui est en même temps une intrigue du Royaume de Dieu. C’est un homme qui.., et un homme qui.., et si on va jusqu’au bout de cette mise en scène, comme dans la parabole du Samaritain, les interlocuteurs sont placés devant une question du type : « lequel est celui qui..? ». La réalité désignée par ces paraboles est d’abord celle des interlocuteurs placés par le scénario devant un appel et un choix. Jésus laisse l’interlocuteur sans réponse, ou plutôt avec une réponse figurée, une réponse qui l’interroge et le place en position de responsabilité. Comme si la réalité la plus ordinaire pouvait être « levée » par une réalité seconde qui est la réalité du Royaume de Dieu. La parabole fait voir/agir un invisible.
c) L’enfantement d’un monde :
Comme le montre Erich Auerbach dans sa Mimésis, il y a dans les Evangiles un mélange des genres ; et ce mélange permet de représenter ce qui n’était pas représentable, de briser la clôture du monde « présentable » pour atteindre un réel moins présentable, comme c’est le cas comme dans toutes les grandes oeuvres littéraires (Shakespeare ou Proust par exemple). Les conversations de Jésus sont trop individualisées pour la Loi, trop intériorisées pour les Prophéties ; et parmi les genres hellénistiques, elles sont trop simples et concrètes pour être Tragiques, trop graves pour être Comiques. Le reniement de Pierre, cette tragédie mais qui arrive à un analphabète, ce drame mais si banal, ne peut être raconté qu’après Jésus. Or c’est l’interrogation qui permet d’articuler ces différents modes. Non pas un interrogation pour savoir ni pour savoir si l’autre sait. Mais une interrogation qui engendre chez l’interlocuteur, chez le lecteur, quelque chose comme le sentiment que ce vieux monde désenchanté peut–être réenfanté; quelque chose comme le sentiment qu’un enfant peut y naître.
11.3) Itinéraire de Kierkegaard
Kierkegaard s’est fait connaître comme un intellectuel brillant, et séducteur. Mais quand il rompt ses fiançailles avec Régine Ølsen (voir la Reprise —« seul l’amour selon la reprise est le véritable amour ») quand il rompt avec l’Église luthérienne officielle (voir L’instant et le texte 47*), tout le monde s’écarte de lui avec frayeur.
Le problème de Kierkegaard peut être raconté comme une incessante quête de soi « devant Dieu ». Cette question centrale, « qui suis–je? », « qui dites–vous que je suis? », que suis–je en vérité, là où je ne peux plus mentir, « devant le Seigneur », vient briser toute identification. Devant Dieu, le Moi est encore un non–Moi, un masque. Mais on pourrait aussi raconter l’itinéraire de Kierkegaard comme la suite des réponses possibles à la question: « suis–je le Socrate dont la chrétienté a besoin? » Pour ce parcours sur le questionnement comme méthode, le Socrate dont parle ici Kierkegaard ressemble à Jean–Baptiste et semble dire : « préparez les chemins du Seigneur »[41].En fait il fait le vide (ibid.p.43) ne prend rien au sérieux que le rien (ibid.p.244), et par lui l’ironie devient la voie; « non pas la vérité, mais la voie » (ibid.p. 295). C’est en Jésus seul que la voie même est la vérité (Jean 14, 6). D’où l’importance décisive, pour son enquête même, du rapport exact entre Socrate et Jésus.
Or voici comment S.Kierkegaard comprend le Socrate qui corrompt la jeunesse: « la vie de la famille n’avait à ses yeux aucune validité. Pour lui, l’État et la famille étaient une somme d’individus: c’est pourquoi il entretenait avec les membres de l’État et de la familles mêmes relations qu’avec les individus, toutes autres lui étant indifférentes »[42]. Socrate défend pourtant la justice, en « citoyen métaphorique ». En effet, sous les contraintes du dialogue, qui brise l’identification du sujet à son grand discours, le sujet est en même temps lui–même et autre chose que lui–même, son double c’est à dire son adversaire; à partir de l’aporie qui a brisé le discours premier auquel il s’identifiait, il est l’idée dont il est en quête[43], il est la question qui lui permet de « traverser » divers discours, et de se « tenir » dialectiquement. L’idéal du sage devient alors de se tenir tout seul, même si l’on n’est soutenu par rien que la question même[44]. Par rien d’autre que l’humour de la question. Or cet humour même montre que l’on n’est pas sage tout seul, mais devant autrui, ou se retournant rougissant vers lui, comme incertains de nous-mêmes.
Dans les Miettes philosophiques, sous le nom de Johannes Climacus, il part de la proposition que « l’ignorant qui pose la question ne sait même pas ce qui l’amène à la poser », et demande « à quel point la vérité peut–elle s’apprendre »? La relation de maître à disciple peut être la relation socratique du maître qui interroge et éprouve ainsi la cohérence et la « responsabilité » des réponses, et du disciple qui est accouché de la vérité qu’il ne savait pas porter en lui. Devant celui qui nous interroge, à travers nos variations mêmes nous sommes conduits à un minimum de non–contradiction et de cohérence.
Le drame tient au fait que notre réponse (aussi cohérente et responsable soit–elle devant sa question) soulève des interrogations autres, et devant lesquelles elle se défait. Le sujet ainsi ne peut plus tirer de lui–même le minimum de cohérence qui en ferait un individu, un indivisible; il ne peut plus se « tenir » debout tout seul. Mais pour Kierkegaard, dans le rapport à Jésus, le disciple n’a pas de vérité en lui : il est amené à rompre avec les vérités qu’il croyait porter, à se vider de lui–même, et à naître à nouveau en acceptant de recevoir d' »en haut » une interrogation qui révèle en lui une dette irrémédiable, et fait de lui un enfant.
Leçon 12
La passion du questionnement et l’enfantement du monde
Kierkegaard fait donc de l’interrogation cette ironie ou cet humour qui vient soulever le discours, et faire que la même proposition qui répondait à une question « engendre » elle-même la possibilité d’une autre. C’est ce moment transversal de « problématologisation » qui concerne la métaphore. En effet, entre le stade où la réponse est pleinement l’assertion d’un monde possible où la question première trouvait sa réponse, et le stade où la nouvelle question est formulée clairement dans sa demande de réponse et dans sa visée d’un autre monde possible, il y a une sorte de travail considérable pendant lequel la proposition est en même temps réponse et question. Déjà la réponse n’est plus considérée littéralement comme réponse; elle n’est réponse que dans un sens figuré. Mais elle n’est pas encore reformulée comme une question littérale et explicite; la question n’y est que figurée. Autrement dit, entre une réponse qui était pleinement l’assertion d’un monde qui réponde à la question initiale, et une nouvelle question qui doit trouver sa réponse dans un autre monde possible, il y a un travail de deuil et d’enfantement. Voici ce qu’écrit Kierkegaard:
« l’ironie ne concerne plus tel ou tel phénomène particulier, être–de– fait isolé, mais la vie toute entière est devenue étrangère au sujet ironique qui, à son tour, devient étranger à la vie ; comme la réalité n’a plus de valeur aux yeux de ce dernier, il devient, dans une certaine mesure, irréel lui aussi. Il faut tout d’abord donner ici au mot « réalité » le sens de réalité historique, c’est à dire de réalité donnée à une époque précise et dans certaines conditions (…) Nous remarquons ici une contradiction par où passe le monde en évolution. La réalité donnée à une époque précise vaut pour la génération et pour les individus qui la composent ; or, à moins de dire que le monde a cessé de se développer, il faut qu’une autre réalité supplante la première et la supplante à travers les individus, la génération, et par eux. Ainsi pour la génération contemporaine de la Réforme, le catholicisme était la réalité donnée ; mais en même temps cette réalité n’était plus valable comme telle. Nous avons là deux réalités qui s’affrontent. C’est là l’aspect profondément tragique de l’histoire universelle. Un individu peut avoir une place justifiée dans cette histoire universelle et peut, en même temps, venir mal à propos (…) Tout évènement semblable qui fait date dans l’histoire comporte deux mouvements remarquables. D’une part nous avons le principe nouveau qui doit se faire jour, de l’autre, le principe ancien qu’il faut rejeter. Le premier cas nous met en présence de l’individu prophétique qui devine au loin l’obscur et vague contour de l’idée nouvelle. L’individu prophétique ne possède pas le principe à venir, il le pressent seulement. Il ne saurait l’imposer ; mais il est aussi perdu pour la réalité à laquelle il appartient »[45].
Ce que l’on sent à travers la pratique de l’interrogation, c’est aussi bien cet accouchement, cette « maïeutique » de la responsabilité du sujet, que la métaphorisation de la réalité donnée. Grosse d’une question, la réponse est travaillée par l’enfantement de ce monde (cf.Leçon 3 sur l’enfance). Ce faisant elle accentue l’excommunication; on peut même dire que pour s’effectuer, elle « doit » se faire excommunier, disparaître de la communication ordinaire afin d’ouvrir un autre espace de communication, un autre monde: il faut bien que ce monde exclue celui qui n’en parle pas le langage, pour que celui-ci prouve que son langage est bien un « monde » possible, une terre et un ciel nouveaux.
Ainsi l’enfantement du monde ne se contente pas de dénoncer le monde comme mauvais ou pourri ! Il suppose finalement d’approuver le monde comme cet intervalle qui s’étend entre plusieurs points de vue, et qu’explorent nos conversations. C’est Hannah Arendt qui est allée le plus loin dans cette conception du monde comme ce qui « s’étend entre les hommes ». Elle reproche aux hommes de notre temps de faire trop facilement usage de la faculté de se retirer du monde, car
« Avec chaque retrait de ce genre, se produit une perte en monde presque démontrable; ce qui est perdu, c’est l’intervalle spécifique et habituellement irremplaçable qui aurait dû se former entre cet homme et ses semblables »[46].
Cet intervalle irremplaçable, on peut aussi l’appeler l’amitié et la cité humaine, qui reposent sur la capacité à partager le malheur et la joie, à partager le monde où nous nous trouvons.
« On le sait, les anciens pensaient qu’une vie humaine ne peut se passer d’amis, et même qu’une vie sans amis ne vaut pas vraiment la peine d’être vécue. L’idée qu’on a besoin de l’aide d’amis dans l’infortune intervenait peu dans cette opinion; au contraire, ils pensaient plutôt qu’il ne peut y avoir de bonheur pour un humain si un ami ne le partage pas. Il y a là sans doute quelque chose de comparable à la maxime selon laquelle ce n’est que dans l’infortune qu’on reconnaît ses vrais amis, mais ceux que nous tenons pour nos vrais amis sans en être instruits par le malheur sont plutôt ceux à qui nous n’hésitons pas à montrer notre bonheur, et sur qui nous comptons pour partager notre joie (…)
Il paraît évident que partager de la joie est absolument supérieur de ce point de vue, à partager de la souffrance. C’est la joie, et non la souffrance, qui est loquace, et le véritable dialogue humain diffère de la simple discussion, en ce qu’il est entièrement pénétré du plaisir que procure l’autre et ce qu’il dit -la joie, pour ainsi dire, en donne le ton ».[47]
C’est que, comme elle l’écrit dans son livre principal :
« C’est par la parole et l’action que nous nous insérons dans le monde humain, et cette insertion est comme une seconde naissance dans laquelle nous confirmons et assumons le fait brut de notre apparition physique originelle. Cette insertion ne nous est pas imposée, comme le travail par la nécessité, nous n’y sommes pas engagés par l’utilité, comme pour l’œuvre. Elle peut être stimulée par la présence des autres dont nous souhaitons peut-être la compagnie, mais elle n’est jamais conditionnée par autrui ; son impulsion vient du commencement venu au monde à l’heure de notre naissance, et auquel nous répondons en commençant du neuf de notre propre initiative »[48].
1. Questions sur l’ensemble des textes du Cours:
Essayez d’exprimer en une phrase ce dont il est question dans chacun de ces textes, et quel en est le « domaine ».
Essayez d’exprimer par un schéma et quelques mots la « problématique » que chacun de ces textes construit (la manière dont les notions sont opposées, corrélées, mises en analogie ou en série, etc).
Notez en passant les concepts, les petits modèles d’analyse, les formulations, dont vous pensez qu’ils vous seront utiles (et que vous gardez dans votre « boîte à outils »).
2. Commentaires de textes :
Prenez l’un de ces textes, et « dégagez l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée »:
Après avoir approché les textes par les questions ci–dessus, il s’agit, dans l’étude ordonnée, de décomposer le texte dans ses thèmes essentiels, et de recomposer ces thèmes dans une totalité « fonctionnelle », mais sans suivre forcément l’ordre de la rédaction du texte (pour ne pas faire de la paraphrase).
Chaque texte mérite son approche spécifique : n’étouffez pas le texte sous vos questions ou vos grilles de lecture a priori, faites–LE parler.
La question proposée, résolue ou soulevée par le texte, appelle une méditation qui soit la vôtre : n’étouffez pas votre propre pensée, osez dire JE.
Ne mélangez pas les deux discours, et précisez à chaque fois qui parle, l’auteur du texte ou vous–même.
Vous pouvez rédiger un commentaire de texte (faites–le en temps limité: 3h et d’une longueur limitée : 4000 signes ou 700 mots), soit proposez sans le rédiger le plan de trois de ces commentaires (pas plus de 30mn de travail par plan).
3. Dissertations :
Parmi les sujets suivants, vous pouvez en choisir un pour une dissertation rédigée (faites–la en temps limité: 3h, et d’une longueur limitée : 4000 signes ou 700 mots), soit proposez trois plans de dissertation (pas plus de 30mn de travail pour chaque plan). Voir les conseils pour la dissertation à la fin des quatrièmes éléments.
Peut–on savoir ce qu’on fait ?
Qu’est-ce qu’être contemporains ?
« Le sage est citoyen de l’univers » (Diogène).
« À chaque jour suffit sa peine » (Mt)
« La liberté est laissée à toutes nations de se faire telles loix qu’ils adviseront leur être expédientes, lesquelles néanmoins soient compassées à la reigle éternelle de charité » Quels sont les rapports entre éthique et politique, selon ce texte de Calvin, et selon vous ?
« La volonté en se représente pas » (Rousseau, Le Contrat social)
« Qu’est-ce que les Lumières? La sortie par l’homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable? » (Kant).
« Une obligation de jouir est une évidente absurdité » (Kant, Critique du jugement , §4 note 1).
« Un homme abandonné sur une île déserte ne tenterait pour lui-même d’orner ni sa hutte, ni lui-même ou de chercher des fleurs, encore moins de les planter pour s’en parer » (Kant Critique du jugement §41).
« Tout malentendu résulte de la parole, en ce sens que, dans la conversation surtout, elle implique une comparaison » (Kierkegaard, « les lis des champs et les oiseaux du ciel », L’éternité dans le temps)
« Les pensées les plus précieuses apparaissent à la fin, mais les pensées les plus précieuses ce sont les méthodes » (Nietzsche)
« Il fallait qu’une solution gigantesque trouve un problème gigantesque à résoudre » (G.Simmel, Michel-Ange)
« Dans les faits, ce sont les causes des conflits, la haine et la violence, la misère et la convoitise, qui sont véritablement l’élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l’une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare, et une voie qui mènera à une sorte d’unité » (G.Simmel, Le conflit)
« On ne peut contenter tout le monde »
« Il faut imaginer Sisyphe heureux » (Camus)
« Je ne veux pas le savoir »
« Nécessité n’a pas de loi »
« Pourquoi moi? »
Concept et image.
Le bruit.
4. Exercices de lecture comparée :
Comparez cet énoncé d’Aristote : « Toute activité tend vers un bien », et celui–ci de Spinoza : « Chaque chose s’efforce, autant qu’elle le peut, de persévérer dans son être ».
« La justice qui a commencé par dire : « tout peut être payé, tout doit être payé », est une justice qui finit par fermer les yeux et par laisser courir celui qui est insolvable, –elle finit, comme toute chose excellente en ce monde, par se détruire elle–même. Cette autodestruction de la justice, on sait de quel beau nom elle se pare –elle s’appelle la grâce, elle demeure, comme l’on pense, le privilège des plus puissants, mieux encore son « au–delà » de la justice ». Expliquez et discutez cette affirmation de Nietzsche.
Tentez un dialogue entre ce texte d’Aristote : « Tout Etat, ainsi que nous le savons, est une société, et l’espoir d’un bien est son principe, comme de toute association, car toutes les actions des hommes ont pour fin ce qu’ils estiment un bien (…) Se suffire à soi–même est un but auquel tend toute production de la nature et cet état est aussi le plus parfait. Il est donc évident que toute Cité correspond à cette visée, et que l’homme est naturellement fait pour la société politique. Celui qui, par son naturel, existerait sans aucune citoyenneté, serait un individu détestable, très au–dessus ou très au–dessous de l’homme (…) Aussi l’homme est–il un animal politique. » Et ce texte de Nietzsche : « Pour vivre seul il faut être une bête ou bien un dieu – dit Aristote. Il manque le troisième cas : il faut être l’un et l’autre, il faut être — philosophe… »
[1] Le banquet de Platon (et son fameux éloge du vin dans les Lois), et la « campagne des banquets » qui ébranla la monarchie de Juillet, en sont des variantes.
[2] Pour la prochaine édition je prépare des textes de Lévinas, StThomas, Bataille, Mauss, Calvin, Bergson, Freud, Spinoza, Hobbes, Machiavel, Luther, Epicure, Marc-Aurèle, et Husserl.
[3] Hans Georg Gadamer dans « itinéraire de Hegel », Critique n.413, oct.8l, p.888 (texte allemand paru à Frankfurt: Suhrkamp, 1979).
[4] Michel Meyer dans Logique langage et argumentation, Paris : Hachette, 1982, p.125.
[5] Dans Logique langage et argumentation, Paris : Hachette, 1982, p.132.
[6] Stanley Cavell, Les voix de la raison, Paris: Seuil, 1996, p.68.
[7] Questions de rhétorique Paris: Le livre de poche 1993, p.22-23.
[8] Ciceron, dans De l’invention, définit l’inventio, première partie de la rhétorique, comme l’art de dire ce qui fait question, ce qui en grec correspond à l’heuristique.
[9] Dans Logique langage et argumentation, Paris : Hachette, 1982, p.126.
[10] Gadamer, La philosophie herméneutique, Paris PUF 1996, p.117.
[11] Ricoeur, Du texte à l’action, Paris: Seuil, 1986, p.305 et 316.
[12] Lire Gaston Bachelard, « les rêveries vers l’enfance », in Poétique de la rêverie, Paris : PUF, 1964
[13] Exigence éthique et interprétation, Genève : Labor et Fides, 1984. Ce qu’il y a chez Calvin, c’est une subjectivisation qui est dans le même temps une responsabilisation, la constitution d’un sujet de lecture pour lequel la question de la vérité n’est pas celle de la vérité de « ce » qu’il lit, mais celle de la lecture qu’il en fait. Loin de chercher dans les figures de Marthe et Marie l’allégorie de deux modes de vie opposés, Calvin voit dans ce texte, à l’arrivée de Jésus, la modification du comportement de Marie, ordinairement semblable à celui de Marthe, et la non–modification du comportement de Marthe.
[14] Du texte à l’action, op.cit. p.77.
[15] M.Meyer, Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Le livre de poche, 1997, p.89
[16] J.P.Cometti, « Questionnement, langage et signification », in Argumentation et questionnement, sld Corinne Hoogaert, Paris: PUF, p.116.
[17] Northrop Frye, Le grand code, Paris: Seuil, 1984, p.27-28.
[18] « Tout conspire ».
[19] Questions de rhétorique, op.cit, p.97.
[20] P.Ricoeur, Le Juste, Paris: Esprit, 1995. p.192.
[21] Du texte à l’action, op.cit. p.48.
[22] « le texte compris en termes historiques est formellement dépossédé de la prétention à dire des choses vraies » (ibid. p.144).
[23] ibid. p.128 et 129. Le classique est marqué par « son caractère de préservation à travers la ruine du temps (…) ce qui du passé se conserve en tant que non passé » ( p.129).
[24] Platon et l’Europe, Lagrasse: Verdier, 1983, p.144–145.
[25] Ibid., p.98.
[26] Vérité et méthode op.cit. p.212-215-216.
[27] Du texte à l’action, op.cit. p.110.
[28] H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris: Gallimard/TEL, 1978, p.269.
[29] ibid. p.270-271.
[30] On se souvient que c’était la fonction attribuée au mythe par Patocka, et Jauss parle de la puissance étonnante du vieux mythe d’Iphigénie, « dont l’antique solution pose à l’homme, d’époque en époque, toujours des questions nouvelles » (ibid.p.265).
[31] Paul Ricoeur, Temps et Récit (tome 1) Paris Seuil 1984 p.122.
[32] C’est l’axe même de Soi-même comme un autre, où Ricoeur inverse la réduction phénoménologique. Qu’est ce que « se » reconnaître? Ce n’est pas trouver une identité invariante, mais déchiffrer une « ipséité » au travers des variations de l’identité.
[33] C’est ce qu’on a reproché tant à Platon qu’à Descartes. On peut au contraire montrer que chaque grande philosophie développe un style d’interrogativité qui lui est propre. Par ses paradigmes et ses mythes, par exemple, Platon inscrit le questionnement au cœur même de ses réponses, qui restent des ironies, des jeux, des exercices dialectiques. Et comme le dit Husserl, « quiconque veut vraiment devenir philosophe devra « une fois dans sa vie » se replier sur soi-même et, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu’ici et tenter de les reconstruire » (Méditations cartésiennes, Paris: Vrin, 1969, p.2).
[34] Critique de la raison pure, II/II.1 (de l’idéal du bien).
[35] Cette pluralisation des ordres de discours, à partir de Wittgenstein et de Kant, est le coeur du livre de Jean-François Lyotard sur Le Différend, Paris: Minuit, 1983.
[36] Gadamer rapproche la dialectique hégélienne et la logique de la question et de la réponse développée par Collingwood (PhH p.109-110).
[37] Tillich, introduction à la Théologie systématique.
[38] Platon, le Ménon 85–c.
[39] Lectures 2, Paris : Le Seuil, 1992 p.493-494.
[40] Apologie de Socrate 21.
[41] S.Kierkegaard, Le concept d’ironie, Paris : Ed. de l’Orante 1975, p.238–239.
[42] S.Kierkegaard, Le concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, op.cit. p.169.
[43] Jan Patocka écrit que le souci platonicien de l’âme est, sous l’exigence de ne pas se contredire, une montée vers la simplicité.
[44] V.Brochard, Les sceptiques grecs, Paris: Vrin, 1986, p.73, parlant de Pyrrhon; et S.Kierkegaard, op.cit.p.50, décrit avec Baur comment Socrate seul, à la fin du Banquet, se tient debout.
[45] S.Kierkegaard, Le concept d’ironie, ibid., p.234–239.
[46] H.Arendt, « De l’humanité en de sombres temps » in Vies politiques, Paris: Gallimard/TEL p.13. Dans cet intervalle, l’unité de la vérité doit rester soumise à la dualité de l’amitié, car c’est entre deux êtres qu' »un monde peut de nouveau naître » (p.91).
[47] Hannah Arendt, « De l’humanité en de sombres temps » in Vies politiques, Paris: Gallimard/TEL, p.24 et 34.
[48] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Lévy coll.Agora, 1983, p.233.
Olivier Abel
Pour les étudiants
